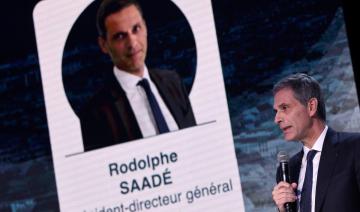PARIS: En célébrant le 1er janvier l'avènement d'une nouvelle décennie, qui pouvait imaginer ce que 2020 réservait au monde ?
En douze mois, le nouveau coronavirus a paralysé les économies, dévasté des communautés entières et mis sous cloche près de quatre milliards d'humains, confinés chez eux. L'année écoulée aura changé le monde comme aucune autre depuis une génération au moins, peut-être depuis la Seconde Guerre mondiale.
Plus de 1,6 million de personnes sont mortes. Au moins 72 millions ont contracté le virus du Covid (bilan probablement sous-estimé). Des enfants ont perdu leurs parents, des grands-parents ont été emportés, des conjoints endeuillés par la mort solitaire d'un proche, quand les visites à l'hôpital étaient jugées trop risquées en raison de la contagion.
«Cette expérience de la pandémie est unique dans la vie de chaque contemporain sur Terre», relève Sten Vermund, épidémiologiste spécialiste des maladies infectieuses et doyen de l'Ecole de santé publique de l'Université de Yale. «D'une façon ou d'une autre, chacun de nous a été impacté par elle» affirme-t-il.
Le Covid-19 n'est pas, de loin, la pandémie la plus mortelle de l'histoire. La peste bubonique au XIVème siècle a éliminé le quart de la population mondiale. Au moins 50 millions sont morts de la grippe espagnole en 1918-1919, 33 millions du Sida en 40 ans.
Mais pour contracter le coronavirus, il suffit de respirer au mauvais endroit au mauvais moment.
«Je suis arrivé aux portes de l'enfer et je suis revenu», résume Wan Chunhui, un Chinois survivant de 44 ans hospitalisé pendant 17 jours. «J'ai vu ceux qui n'avaient pu guérir et qui sont morts, ça m'a profondément marqué» ajoute-t-il.
L'ampleur du désastre est à peine imaginable quand, le 31 décembre 2019, les autorités chinoises annoncent 27 cas de pneumonie virale d’origine inconnue à Wuhan, dans le centre de la Chine.
Premier décès à Wuhan
Le lendemain, les autorités ferment le marché d'animaux vivants de Wuhan, considéré comme lié à l'apparition du virus.
Le 7 janvier, les responsables chinois annoncent qu'un nouveau virus a été isolé, baptisé 2019-nCov. Le 11, la Chine fait part du premier décès à Wuhan. En quelques jours, des cas apparaissent à travers l'Asie, en France, et aux Etats-Unis.
Fin janvier, les pays commencent à rapatrier leurs ressortissants de Chine. Les frontières commencent à se fermer et plus de 50 millions de résidents de la province de Wuhan, dans le Hubei, sont placés en quarantaine.
Les images d'un homme mort sur un trottoir de Wuhan, encore masqué, un sac plastique à la main, témoignent de la terreur qui s'est emparée de la ville, même si aucun responsable n'a jamais confirmé la cause exacte de son décès.
Quand le paquebot «Diamond Princess» accoste au Japon début février, plus de 700 passagers à son bord ont contracté le virus et 13 en sont morts.
L'horreur est devenue mondiale et la course au vaccin a déjà commencé. Une petite société allemande, BioNTech, met de côté ses recherches sur le cancer pour se concentrer sur un nouveau projet. Son nom: «Vitesse de l'éclair».
Le 11 février, l'OMS désigne le nouveau mal, appelé Covid-19. Quatre jours plus tard, la France annonce le premier décès enregistré hors d'Asie. L'Europe regarde avec horreur le nord de l'Italie devenir l'épicentre de la maladie sur le continent.
En mars Orlando Gualdi, maire du village de Vertova en Lombardie, où 36 décès sont enregistrés en 25 jours, confie son désarroi: «C'est absurde de voir qu'en 2020 il peut y avoir une pandémie pareille, pire qu'une guerre...».
L'Italie, puis l'Espagne, la France et la Grande-Bretagne décrètent le confinement. L'OMS déclare le Covid-19 comme pandémie. Les frontières des Etats-Unis, déjà fermées à la Chine, se ferment à la plupart des pays d'Europe. Pour la première fois en temps de paix, les Jeux Olympiques d'été sont ajournés.
Confinement
Mi-avril, 3,9 milliards de personnes, la moitié de l'humanité, vivent une forme ou une autre de confinement. De Paris à New York, de Delhi à Lagos et de Londres à Buenos Aires, le silence irréel des rues désertées n'est troublé que par les sirènes des ambulances qui rappellent que la mort rode.
Depuis des décennies, les scientifiques mettaient en garde contre le risque d'une pandémie mondiale sans être entendus. Désormais, même les pays les plus riches sont perdus face à l'ennemi invisible.
Dans une économie mondialisée, les chaînes d'approvisionnement à l'arrêt provoquent une ruée des consommateurs paniqués sur les rayons des supermarchés.
Le sous-investissement chronique dans les structures de santé publique est brutalement exposé avec des hôpitaux qui luttent pour maintenir à flots leurs unités de soins intensifs submergées. Des personnels sous-payés et débordés livrent bataille sans protection.
«J'ai eu mon diplôme en 1994, les hôpitaux publics étaient déjà complètement négligés» s'insurgeait en mai Nilima Vaidya-Bhamare, médecin à Bombay, dont le pays, l'Inde, est devenu le troisième le plus affecté. «Pourquoi fallait-il une pandémie pour réveiller les gens ?» demande-t-il.
À New York, la plus grosse concentration de milliardaires au monde, des personnels de santé sont vêtus de sacs poubelle en guise de protection. Un hôpital de campagne a été dressé au cœur de Central Park. Des fosses communes creusées sur Hart Island, au large du Bronx.
«On se croirait dans un film d'horreur», lance encore Virgilio Neto, le maire de Manaus, au Brésil. «On ne peut plus parler d'état d'urgence, c'est un état de calamité absolue». Les corps s'entassent dans des camions frigorifiques, attendant que les bulldozers creusent de gigantesques fosses communes.
Les entreprises ferment. Les écoles et les universités aussi. Les rencontres sportives sont annulées. Le trafic aérien civil est pratiquement suspendu, vivant la pire crise de son histoire. Les boutiques, bars, clubs, restaurants ferment leurs portes. En Espagne, le confinement est si sévère que les enfants ne peuvent sortir de chez eux. Les gens se retrouvent coincés, enfermés des semaines dans de minuscules appartements parfois.
Ceux qui le peuvent travaillent à domicile. Les visioconférences remplacent les réunions de travail, les voyages et les célébrations. Ceux dont la fonction exige leur présence jouent leur vie ou leur emploi. En mai, la pandémie a liquidé 20 millions de jobs aux Etats-Unis.
Violence et récession
La Banque Mondiale prévoit qu'en 2021, 150 millions de personnes pourraient plonger dans la grande pauvreté du fait de la récession. Les inégalités sociales qui se sont creusées au fil des années sont déjà plus criantes que jamais.
Embrassades, étreintes et même poignées de mains ne sont plus que des souvenirs. Les échanges se font à travers les masques et des parois de plexiglas.
La violence domestique explose, les problèmes psychologiques aussi. Alors que les citadins les plus aisés se réfugient dans leurs maisons secondaires ou à la campagne et que les gouvernements pataugent face à l'ampleur de la crise, la colère bout chez ceux qui restent enfermés en ville.
Les Etats-Unis, l'une des principales économies au monde mais sans couverture de santé universelle, deviennent rapidement le pays le plus touché (plus de 300.000 décès sont comptabilisés en fin d'année) mais le président Donald Trump a constamment balayé la menace, promouvant d'hypothétiques traitements comme l'hydroxychloroquine, ou même l'idée de se soigner à l'eau de javel...
En mai, le gouvernement américain lance l'Opération Warp Speed, allouant 11 milliards de dollars pour le développement d'un vaccin d'ici la fin de l'année. Trump l'évoque comme l'effort américain le plus massif depuis le développement de la bombe atomique pendant la Second Guerre mondiale.
Mais ni les riches ni les puissants ne peuvent acheter leur immunité et, en octobre, Trump est infecté comme, avant lui, le président brésilien Jair Bolsonaro en juillet. Le Premier ministre britannique Boris Johnson a passé trois jours en soins intensifs en avril.
L'acteur Tom Hanks et sa femme tombent malades. Cristiano Ronaldo, l'un des plus grands footballeurs de sa génération, le champion de tennis Novak Djokovic, ou encore Madonna, le Prince Charles et le Prince Albert II de Monaco sont testés positifs au Covid.
Alors que l’année touche à sa fin, les premiers vaccins arrivent sur le marché (trop tard cependant pour sauver Trump d'une défaite électorale face à Joe Biden en novembre).
Le géant pharmaceutique américain Pfizer, associé à BioNTech, annonce la mise au point d'un vaccin «efficace à 90%». Le marché s'envole et les gouvernements se précipitent pour assurer des stocks. Une semaine plus tard, l'américain Moderna renchérit en annonçant un vaccin efficace «à 95 %».
Guerre des vaccins
Les gouvernements se préparent à administrer des millions de doses en commençant par les personnes âgées, les personnels soignants et les catégories les plus vulnérables, avant d'étendre au reste de la population la vaccination, seul billet de retour possible à la normale.
En décembre, la Grande-Bretagne devient le premier pays occidental à autoriser le vaccin Pfizer/BioNTech, la Chine et la Russie ayant déjà entamé leurs campagnes avec leur propre vaccin.
Les Etats-Unis suivent bientôt et entament les vaccinations, l'Europe devait donner son feu vert à la fin du mois.
Avec les pays les plus riches qui se ruent pour constituer des stocks, 2021 devrait s'ouvrir sur une compétition internationale autour des vaccins: la Chine et la Russie vont se battre pour promouvoir les leurs, meilleur marché, principalement en Afrique et l'Amérique Latine.
Difficile à ce stade d'estimer les traces durables que laissera la pandémie sur les sociétés. Pour certains experts, il faudra peut-être des années avant de parvenir à une immunité de masse. D'autres parient sur un retour à la normale dès le milieu de l'année 2021.
Pour certains, la pandémie pourrait favoriser une approche plus flexible du télétravail, voire une relocalisation partielle des chaînes de production.
D'autres avancent que la crainte des rassemblements massifs aura de profondes conséquences sur les transports, le tourisme et les événements sportifs et culturels et le tourisme.
L'impact sur les libertés civiles est une autre source d'inquiétude. Selon les analystes de la Freedom House, la démocratie et les droits humains se sont déjà détériorés dans 80 pays, en réponse au virus.
À Yale, Sten Vermund dit d'ailleurs s'attendre à «des changements en profondeur de nos sociétés».
Si le télétravail devient la norme pour le tertiaire, que deviendra le marché immobilier en centre-ville? Les grands centres urbains vont-ils se dépeupler, perdre des habitants en quête d'espace et soucieux de s'épargner des transports bondés?
L'économie mondiale s'apprête à de nouveaux soubresauts: le Fonds monétaire international s'inquiète d'une récession pire que celle qui a suivi la crise financière de 2008. Mais pour beaucoup, la pandémie est surtout annonciatrice d'une catastrophe autrement plus durable et plus dévastatrice.
«Le Covid-19 est comme une grosse vague qui nous a frappés, mais derrière se profile le tsunami du changement climatique et du réchauffement de la planète», met en garde l'astrobiologiste Lewis Dartnell, auteur de «À ouvrir en cas d'apocalypse», encyclopédie du désastre et de la résilience.