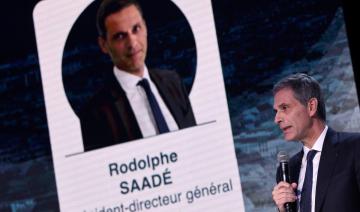Pourquoi un abécédaire?
ONG, contrefaçons, art, fraudes sociales, crédit à la consommation, transferts de fonds, or, hawala, bitcoin, chocolat, impôts, pétrole, cagnottes en ligne, [ac1] [D2] autant de mots qui ne présentent pas de liens en apparence. Et pourtant, les voici tous réunis dans un abécédaire consacré à la lutte contre le financement du terrorisme. Qui aurait pu croire, après les attentats du 11 septembre 2001, qu’un jour des biens de consommation constitueraient des outils de financement du terrorisme?
C’est pourtant à cela que ressemblent les nouveaux modes de financement de ce terrorisme low cost, opportuniste, évolutif, versatile aussi, mais toujours dévastateur. Les attentats d’aujourd’hui ne sont pas les attentats d’hier, leur logistique est plus simple, moins coûteuse et leur mode de financement n’a nul besoin d’être sophistiqué.
La création de l’État islamique dans les zones irako-syriennes a apporté, à partir de 2014, son lot de nouvelles pratiques de financement, dont certaines tout à fait nouvelles, déroutantes pour les États comme pour les institutions internationales, qui n’étaient préparés ni aux attaques ni à leurs ripostes.
La communauté internationale avait bien entendu identifié la lutte contre le terrorisme à travers les prismes militaires et géostratégiques. La question du financement du terrorisme comme sujet à part entière, autonome, est apparue tardivement à la suite des attentats du 11 septembre 2001. La pénalisation du financement du terrorisme date très précisément de la loi du 15 novembre 2001, loi votée, inutile de le dire, en réaction aux attentats précités.
L’article 421-2-2[1] du code pénal précise: «Constitue également un acte de terrorisme le fait de financer une entreprise terroriste en fournissant, en réunissant ou en gérant des fonds, des valeurs ou des biens quelconques ou en donnant des conseils à cette fin, dans l’intention de voir ces fonds, valeurs ou biens utilisés ou en sachant qu’ils sont destinés à être utilisés, en tout ou partie, en vue de commettre l’un quelconque des actes de terrorisme prévus au présent chapitre, indépendamment de la survenance éventuelle d’un tel acte.»
Si vous ne deviez ne retenir qu’une chose, c’est celle-ci: commettre un attentat coûte de moins en moins cher.
Des progrès spectaculaires ont été faits ces vingt dernières années en matière de lutte contre le terrorisme et son financement. Les nombreuses mesures, les contrôles prudentiels et de compliance ont singulièrement compliqué les activités illicites des terroristes, rendant les circuits financiers de plus en plus transparents et coordonnés. Mais il reste beaucoup à faire pour endiguer ce phénomène mutant et opportuniste.
Les terroristes utilisent les mêmes circuits que ceux de la criminalité organisée et de la délinquance financière: blanchiment d’argent, corruption, trafic de drogue ou d’êtres humains, trafic d’œuvres d’art, trafic d’armes, enlèvements, tout est bon pour que l’argent sale finance des actions terroristes.
Dans cette course folle, dopée par l’usage du numérique, des réseaux sociaux et des nouvelles technologies de l’information, le législateur va moins vite que le délinquant et marque un temps de retard dans sa réplique (voire deux).
La prise de Kaboul par les Talibans, en août 2021, la situation en Afrique de l’Ouest constituent sans doute les réservoirs les plus actifs de terroristes.
Ce livre sur le financement du terrorisme constitue une sorte d’aboutissement d’un travail que j’ai mené depuis plus de dix ans.
Depuis, le sujet n’a cessé d’être le fil rouge de mon activité parlementaire. En juin 2014, j’ai obtenu une commission d’enquête sur l’organisation et les moyens de la lutte contre les réseaux djihadistes en France et en Europe[2].
Cette commission fut suivie, en 2015, d’une mission d’information sur l’islam en France[3].
Il faut souligner le travail particulièrement sérieux accompli lors de ces deux missions, en coopération avec mon collègue André Reichardt, sénateur du Bas-Rhin.
Le lien entre la criminalité organisée et le financement du terrorisme était pour moi une évidence, confortée par mon travail au sein de l’Assemblée parlementaire de l’Otan. Le 30 octobre 2015, je déposais, en tant que vice-présidente de la Commission économique de l’Assemblée parlementaire de l’Otan, un rapport sur le financement du terrorisme[4].
Sept ans après ce rapport, vingt ans après les attentats du World Trade Center, il m’a semblé intéressant de faire un point d’étape sur la lutte contre le financement du terrorisme sous une forme originale, celle d’un dictionnaire, où chacun pourra trouver ce qu’il cherche grâce à un index thématique.
Le travail se veut pédagogique et référencé, sans être exhaustif. Ainsi, il ne prend pas en compte le financement étatique, que l’on peut considérer «en perte de vitesse» et qui renvoie à de nombreuses données diplomatiques et géopolitiques.
La prise de Kaboul par les Talibans, en août 2021, la situation en Afrique de l’Ouest constituent sans doute les réservoirs les plus actifs de terroristes. Les groupes armés qui sèment la peur et la mort doivent faire l’objet de toute notre attention. L’attentat au Burkina Faso du 26 décembre 2021 n’a fait que renforcer les craintes exprimées[5]. D’ailleurs, le rapport d’Europol 2021 «Terrorism situation and Trend report[6]» nous rappelle l’actualité de la menace terroriste, djihadiste et également des extrêmes, de droite ou de gauche, d’ethnonationalistes ou de séparatistes.
La guerre en Ukraine pourrait révéler de puissants réseaux de trafics d’armes.
Si vous ne deviez ne retenir qu’une chose, c’est celle-ci: commettre un attentat coûte de moins en moins cher.
Le coût de plus en plus faible des attaques terroristes, le terrorisme low cost et l’argent de plus en plus facile, voilà l’équation à laquelle la communauté internationale est confrontée. Assécher les circuits de financement du terrorisme constitue le point névralgique de la lutte contre le terrorisme. Endiguer les réseaux de financement du terrorisme, c’est aussi lutter contre la corruption, la fraude et l’évasion fiscale face à une communauté internationale souvent bien impotente malgré des progrès spectaculaires.
Agir aujourd’hui contre le financement du terrorisme doit demeurer une priorité.
À lire : https://www.lisez.com/livre-grand-format/abecedaire-du-financement-du-terrorisme/9782749174204