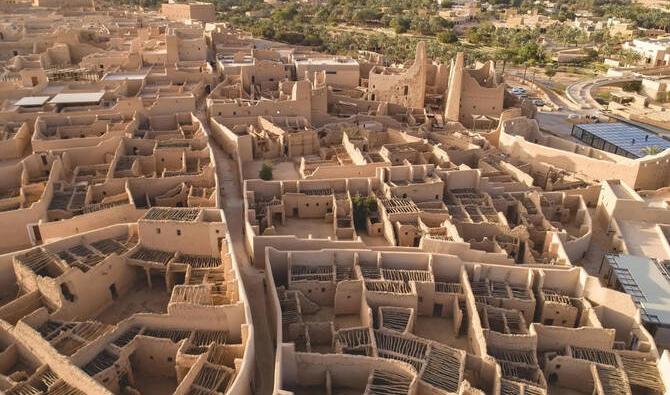BRUXELLES: La réforme du marché de l'électricité proposée par la Commission européenne garantirait des prix plus prévisibles aux producteurs et aux consommateurs, aidant à financer la transition énergétique, mais ne ferait pas disparaître la volatilité due aux hydrocarbures ni chuter immédiatement les factures, soulignent les acteurs du secteur.
La fin des flambées des cours?
Le plan ne modifie pas le fonctionnement du marché de gros de l'électricité, où les prix quotidiens sont déterminés par le coût de la dernière centrale utilisée pour équilibrer le réseau, principalement des centrales à gaz — les prix flambant donc à l'unisson des cours du gaz.
"Les signaux de prix sur ce marché ne changent pas (...) Ce système fonctionne très bien" et reste indispensable pour répondre aux pics de demande à l'échelle du continent, souligne Thomas Veyrenc, directeur de la stratégie du gestionnaire du réseau français RTE.
Faute d'empêcher la volatilité de court terme, la réforme entend amortir l'impact sur les revenus des producteurs et les tarifs des consommateurs, en les "lissant" par un recours accru aux contrats de long terme.
Les consommateurs pourraient profiter davantage des coûts bas des renouvelables et du nucléaire, et la garantie de revenus prévisibles encouragerait les investissements dans ces énergies décarbonées, réduisant progressivement l'influence du gaz sur les prix.
"La proposition est ciblée et équilibrée", établissant des instruments à long terme, "pièce manquante du système" mais sans abandonner "une approche axée sur le marché", se félicite Kristian Ruby, patron de la fédération de l'industrie électrique Eurelectric.
Des prix bas garantis aux consommateurs?
Bruxelles veut favoriser les contrats d'achat d'électricité à prix fixe entre producteur et consommateur, en enjoignant aux États d'apporter des garanties aux souscripteurs.
Les fournisseurs d'électricité au détail devraient se couvrir avec ces contrats long terme "pour atténuer leur surexposition à la volatilité": contrainte dénoncée par les intéressés, mais qui "contribuerait à stabiliser les prix pour les consommateurs", salue Monique Goyens, du Bureau européen des unions de consommateurs (BEUC).
Forcés de proposer aux clients des offres à prix fixe, les fournisseurs "seraient empêchés d'augmenter unilatéralement le prix des contrats", ajoute-t-elle.
Les entreprises énergivores pourraient "bénéficier de prix prévisibles sur dix ou quinze années", applaudit l'Union française des industries utilisatrices d'énergies (agroalimentaire, verre, métaux...).
Mais cela reste "insuffisant", tempère Axel Eggert, du lobby de la sidérurgie Eurofer: les contrats long terme ne sont pas déconnectés du marché court terme et "incapables d'apporter efficacement une solution structurelle" face à l'"urgence" de dégonfler des prix européens trop élevés, s'alarme-t-il.
Les négociations entre États de l'UE, divisés sur le nucléaire, rendent improbable tout impact sur les factures l'hiver prochain, mais la réforme "pourrait avoir un effet marqué assez rapidement pour les clients en quelques années", observe M. Ruby.
Pour autant, ces contrats à prix fixe risquent de bloquer des fournisseurs ou des consommateurs "à un niveau de prix élevé" pour des années sans pouvoir profiter ensuite d'éventuelles baisses des cours, avertit-il.
Un moteur du financement d'énergies vertes?
La Commission soutient l'usage de "contrats pour la différence" (CFD) à prix garanti par l’État: si le cours quotidien est supérieur au prix fixé, le producteur d'électricité reverse ses recettes excédentaires; dans le cas contraire, il perçoit une compensation de l’État.
Pour tout soutien public à de nouveaux investissements dans les renouvelables et le nucléaire, y compris dans des centrales existantes, les États seraient obligés de recourir aux CFD.
Les contrats long terme apportent "une solution liée à un besoin d'investissement" pour la transition énergétique, observe Michel Colombier, chercheur à l'IDDRI.
Ils vont "mécaniquement limiter le retour à des prix d'achat de 40 euros/MWh", qui empêchaient "les investissements nécessaires pour renouveler le parc fossile vieillissant et développer les options décarbonées", tandis que les CFD pourraient contribuer au financement du parc nucléaire français, développe-t-il.
De quoi libérer des investissements massifs? "Espérons-le! Mais actuellement, les États-Unis proposent un cadre extrêmement attractif, tandis que l'Europe entame un processus législatif long et compliqué", tempère Kristian Ruby.
Il dénonce aussi l'obligation de recourir aux seuls CFD, outil pas nécessairement adapté à toutes les tailles de projets.
Autres inconvénients: les CFD peuvent dissuader des investisseurs si ceux-ci misent sur une future inflation des prix et préfèrent attendre. De plus, l’État sert de garant, avec le risque d'un "impact budgétaire considérable", rappelle le think-tank Bruegel.