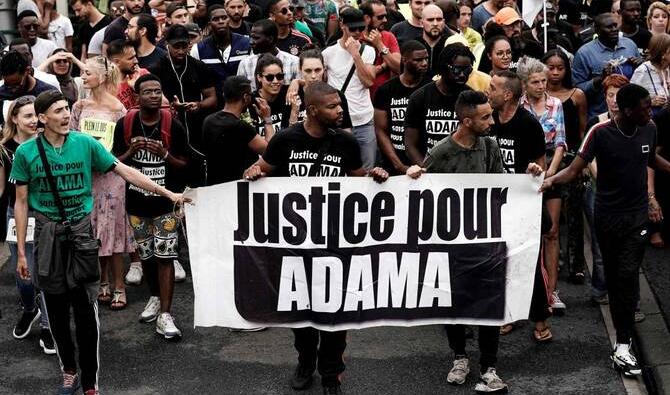SAVINES-LE-LAC: Le pays doit "avancer": Emmanuel Macron est retourné jeudi sur le terrain pour marteler que rien ne l'arrêtera dans sa volonté de réformes malgré la crise des retraites et les slogans hostiles qui l'ont accompagné dans les Hautes-Alpes.
Le chef de l'Etat était venu présenter le "plan Eau" du gouvernement sur les bords du lac de Serre-Ponçon, alors qu'il n'était pas retourné en région depuis le début de la crise hormis un déplacement en Charente sur la vaccination contre le papillomavirus fin février.
"Macron démission", "Emmanuel Macron on ne veut pas de toi chez nous": dès sa descente de voiture à Savines-le-Lac, le ton de la contestation contre la réforme des retraites, qui le vise de plus en plus personnellement, était donné.
Quelque 200 manifestants, tenus à distance par les gendarmes, ont entonné un concert de sifflets, sirènes et slogans peu amènes audibles jusqu'aux oreilles du président.
Ce dernier, entouré d'élus locaux au bord du lac, est resté impassible, prenant le temps de se faire expliquer la situation, de plus en plus critique en matière d'eau dans la région avec le réchauffement climatique.
"Il y a 200 manifestants: est-ce que ça veut pour autant dire que la République doit s'arrêter ? La réponse est non", a-t-il lancé, sans ciller, lors d'un échange avec la presse confirmé à la dernière minute.
Face au manque d'eau, l'agriculture devra «diminuer sa consommation», prévient une chercheuse
"La nature n'est plus capable d'encaisser des prélèvements toujours plus nombreux" et l'agriculture, qui représente 58% de la consommation d'eau en France, devra être plus économe, estime l'hydro-climatologue Agnès Ducharne, chercheuse au CNRS.
Quels sont les impacts du stockage d'eau destiné à l'irrigation (barrages, retenues collinaires, bassines)?
Quelle que soit la retenue, quand on retient l'eau, cela change le régime d'écoulement, le débit, qui varie selon les saisons. Dans le cas de l'irrigation agricole, 80% de l'eau est absorbée par la plante, qui produit de la biomasse et va rendre cette eau sous forme de vapeur d'eau (évapo-transpiration).
Cette eau est considérée comme consommée et pas seulement prélevée. Du point de vue du cours d'eau, c'est une perte.
On considère que la pratique d'irrigation, qui vise à réduire la sécheresse des sols, aggrave la sécheresse des nappes et diminue le débit des cours d'eau.
Les prélèvements, cumulatifs au gré des ouvrages qui s'ajoutent, conduisent à un assèchement des cours d'eau, des petites rivières jusqu'aux grands fleuves. C'est le cas pour le Colorado ou les rivières qui alimentaient la mer d'Aral. Cela a un impact direct sur l'agriculture. Par exemple dans la vallée du Nil où il n'y a plus d'inondation et où la terre est moins fertile.
Quel est l'impact spécifique des "méga-bassines", ces réservoirs controversés au coeur d'un violent conflit d'usage dans les Deux-Sèvres ?
Contrairement aux retenues collinaires, alimentées par les eaux de ruissellement, les méga- bassines, vastes trous bâchés, sont des ouvrages déconnectés du réseau hydrographique.
Elles sont remplies par pompage de la nappe phréatique. Le principe est de pomper en hiver, quand la nappe est la plus haute, pour utiliser l'eau l'été.
Ce pompage a une incidence sur le débit des cours d'eau, qui sont eux-mêmes alimentés par la nappe. Quand le niveau est trop bas pour maintenir les écosystèmes, on prend des mesures de restriction: c'est ce qu'on a connu l'été dernier avec la sécheresse, jusqu'à cet hiver.
La bassine vise à se substituer à la nappe, en stockant l'eau en surface: l'eau étant dans un ouvrage privé, elle échappera aux mesures de restriction. Mais même en hiver, y en aura-t-il assez?
Cela veut-il dire que ces bassines ne sont déjà plus une solution adaptée dans le contexte du changement climatique?
Pendant longtemps, on a pu se dire que la ressource, plus rare l'été, se renouvelait l'hiver. Mais nous voyons que la nature n'est plus capable d'encaisser des prélèvements toujours plus nombreux. Il y a un effet cumulatif.
Avec le changement climatique, le niveau des nappes va baisser et il est possible que même la substitution ne soit plus possible. On le voit déjà en Espagne, où les sécheresses sont fréquentes et où de nombreuses retenues artificielles sont vides.
C'est ce qu'on appelle la maladaptation. Deux erreurs sont commises en même temps: on augmente des périmètres de stockage en artificialisant des terres, en contradiction avec la politique de zéro artificialisation nette, et on augmente les périmètres irrigués. Entre 2010 et 2020, les surfaces irriguées en France ont augmenté de 15%.
Il y a des incitations de développement complètement contradictoires avec les limites physiques de l'environnement.
Il est nécessaire que l'agriculture la plus consommatrice d'eau diminue sa consommation. Cela remet en cause la place du maïs irrigué (culture gourmande en eau quand elle est la plus rare, en été, NDLR) et celle de l'élevage: les animaux sont destinataires du maïs et boivent beaucoup d'eau.
D'un point de vue climatique, il faut réduire l'élevage intensif. Il faut rééquilibrer le système par rapport à des ressources en eau qui vont continuer à diminuer.
«Se retrousser les manches»
Le déplacement avait lui-même été annoncé au dernier moment mercredi, y compris aux journalistes devant l'accompagner, comme pour mieux prévenir toute mobilisation. Et les contrôles de sécurité ont été démultipliés, avec barrages de gendarmes, pour empêcher tout manifestant d'approcher.
"En termes de sécurité, il faut faire quand même attention dans la période", glisse un ministre de premier plan pour justifier ces précautions.
Les membres du gouvernement ont d'ailleurs eu comme consigne de réduire leurs déplacements au strict nécessaire.
Le chef de l'Etat et sa Première ministre sont englués dans une crise politique et sociale depuis le vote au forceps de la réforme, qu'ils entendent maintenir envers et contre tout. Mais ils tentent de montrer qu'ils ne sont pas bunkérisés.
Elisabeth Borne effectuera aussi un déplacement vendredi dans la Nièvre, son premier en région depuis deux mois. Au programme, l'éducation, un des thèmes que l'exécutif entend porter, au plus près des préoccupations des Français, pour tenter de tourner au plus vite la page des retraites.
"Qu'est-ce que vous voudriez qu'ils fassent d'autre ? La Première ministre reste à Matignon, le président reste à l'Elysée et on ne parle d'aucun autre sujet en attendant la prochaine manif ? Non, bien sûr que non", insiste ce même ténor du gouvernement. "Les affaires continuent."
C'était aussi le plaidoyer d'Emmanuel Macron, qui a assuré, comme pour conjurer le sort, s'atteler à "des chantiers immenses". "On est en train de tous se retrousser les manches pour notre école, notre santé. On fait la transition écologique", a-t-il insisté.
Sainte-Soline: des « milliers de gens » étaient « simplement venus pour faire la guerre», affirme Macron
Des "milliers de gens" étaient "simplement venus pour faire la guerre" à Sainte-Soline, a affirmé jeudi Emmanuel Macron en déplacement dans les Hautes-Alpes pour présenter un plan visant à améliorer la gestion de l'eau.

"Vous avez des milliers de gens qui étaient simplement venus pour faire la guerre. C'est inacceptable", a déclaré le chef de l'Etat alors que la manifestation interdite, samedi, contre la méga-bassine de Sainte-Soline (Deux-Sèvres), a été ponctuée d'affrontements très violents entre militants et forces de l'ordre avec deux manifestants toujours dans le coma.
Le président a dénoncé "des scènes de violences inacceptables" du côté des manifestants. "Chez certains une forme d'habitude de la violence s'installe, il faut la combattre avec beaucoup de fermeté", a-t-il commenté, demandant à "toutes les forces politiques républicaines d'être parfaitement clair sur ce sujet".
De 6.000 à 8.000 personnes selon les autorités, 30.000 selon les organisateurs, ont manifesté samedi.
Dans deux rapports, préfecture et gendarmerie défendent une riposte ciblée et proportionnée face à 800 à 1.000 manifestants "radicaux".
La Ligue des droits de l'homme dénonce au contraire "un usage immodéré" de la force sur l'ensemble des manifestants, dès qu'ils ont approché la réserve d'eau. Les organisateurs ont dénombré 200 blessés, dont au moins une personne éborgnée en plus des deux manifestants dans le coma.
Les familles des deux hommes ont déposé plainte notamment pour "tentative de meurtre".
Pour le député Renaissance Gilles Le Gendre, "le président de la République peut se déplacer en France quand il veut, où il veut, c'est essentiel", et le "plan eau" un "excellent motif".
"C'est bien qu'il montre qu'il soit sur le terrain avant de partir" en Chine la semaine prochaine, abonde un cadre du parti présidentiel à l'Assemblée nationale. "On a entendu dans les manifestations, mais aussi chez nous, chez nos militants, qu'il ne s'occupait pas assez de nous et trop de l'étranger."
En quête désespérée d'alliés pour gouverner malgré l'absence de majorité absolue, Emmanuel Macron a assuré vouloir "continuer de travailler avec beaucoup de respect, de calme".
Filant la métaphore avec l'histoire de Savines, dont l'ancien village fut noyé pour permettre la construction d'une retenue d'eau, il a pointé du doigt tous ceux qui s'opposent au recul de l'âge légal de la retraite de 62 à 64 ans.
"Ceux qui expliquent à la Nation qu'il ne faut rien changer pour bien vivre, ce sont comme ceux qui auraient décidé il y a 62 ans ici de ne rien bouger", a-t-il lancé. "Nous ne serions sans doute pas là pour en parler. La terre serait sèche", a-t-il asséné.