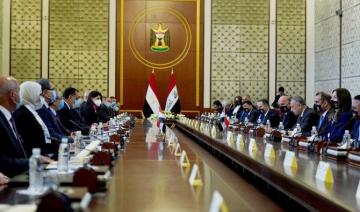DUIVEN: Il cherchait la sécurité, elle voulait la liberté. Des rêves pour lesquels ils ont tout risqué.
À l'automne 2015, leur petit Adam de quatre mois dans un porte-bébé, Ahmed et Alia, aujourd'hui 32 et 31 ans, ont fui l'Irak pour rejoindre le million de migrants qui s'embarquent alors vers les côtes européennes en quête d'une vie meilleure.
Ils ont frôlé la mort en mer, eu la sensation de perdre leur dignité sur la route des Balkans, vécu en clandestins, souffert la torturante attente du droit d'asile aux Pays-Bas, le nouveau pays qu'ils se sont choisi. Jusqu'au jour où ils ont glissé dans la serrure les clés de leur propre foyer.
Une famille parmi tant d'autres, rencontrée par une journée ensoleillée de septembre 2015 à Guevgueliya, frontière endormie de la Macédoine du Nord avec la Grèce. Ce jour-là, avec des centaines de Syriens, d'Afghans, d'Irakiens, hommes, femmes, enfants, vieillards, blessés, amputés, ils s'engouffrent dans le train qui leur fera traverser la Serbie, direction l'Union européenne.
Pendant cinq ans, une équipe texte, photo, vidéo de l'AFP les a suivis pas à pas, sur les rails, sur la route guidés par des trafiquants, dans un centre d'hébergement lugubre, jusqu'à l'aube de leur nouvelle vie à Duiven, petite ville de l'est des Pays-Bas.
Voici l'histoire d'Ahmed et Alia – qui préfèrent garder l'anonymat pour raisons de sécurité – depuis le soir où ils ont décidé de quitter ensemble Bagdad, après avoir survécu à un attentat.

(ARIS MESSINIS / AFP)
Ce jour d'août 2019, le téléphone sonne, Alia décroche et la nouvelle tombe: elle vient d'obtenir le statut de réfugiée aux Pays-Bas. Au bout du fil, l'avocat qui l'assiste dans ses démarches, confirme: dans la foulée, son mari et son fils auront automatiquement le droit d'asile.
Le rêve devient réalité
Pour toujours leur vie vient de changer. Le couple s'enlace, s'embrasse, Alia crie, pleure, rit en même temps. "C'était un moment de joie encore plus intense que notre mariage", se souvient la jeune femme aux yeux noisettes.
Les semaines qui suivent, la famille obtient ses cartes de séjour, permis de voyager. Ils ne sont plus illégaux. Ils ont le droit d'avoir un foyer, de gagner de l'argent, de respirer.
"Enfin on a pu avoir tout ce que l'on désirait", dit Ahmed, cheveux bruns gominés. "Une vie normale comme n'importe quelle autre famille aux Pays-Bas."
"J'ai vu la mort"
Partir. Cela s'est décidé après leur premier rendez-vous amoureux depuis leurs fiançailles en 2014. Ahmed a invité Alia à dîner dans un restaurant de Bagdad, Mr Chicken.
Quand soudain la bombe a explosé. Autour d'eux des clients sont tués, Alia blessée au visage en gardera des cicatrices.
"Ce jour-là, j'ai vu la mort. Si nous avions été assis à une autre table, nous n'aurions peut-être pas survécu", dit Ahmed.
A Bagdad, ils mènent la vie classique d'un jeune couple de la classe moyenne. Il tient un magasin de vêtements haut de gamme, elle est la fille d'un professeur de chimie à l'université, ils sont proches de leur famille, ont leur groupe d'amis.
"J'adore mon pays", dit le jeune homme en regardant des images de sa ville sur Snapchat. Mais "en Irak, quand tu pars travailler le matin, tu ne sais jamais si tu rentreras vivant le soir."
La naissance d'Adam en 2015 donne le départ. Ahmed vend sa boutique et les parts d'une propriété reçues en héritage pour financer "le voyage".
Ce n'est pas son premier exil. En 2006, au pic de la guerre civile en Irak, sa famille s'est réfugiée en Syrie. Ils sont revenus à Bagdad quand leur pays d'accueil a plongé à son tour dans la violence.
Ensuite, "année après année, la situation en Irak n'a cessé d'empirer, la corruption, les milices ont pris le pouvoir", dit-il. Puis l'Etat islamique, qui s'y est implanté en 2014, entraînant une nouvelle vague d'émigration.
Près de 89 000 Irakiens ont traversé la mer vers la Grèce et l'Italie en 2015, selon le Haut-commissariat de l'ONU aux réfugiés (HCR). L'année dernière, ils étaient plus de 238 000 réfugiés en Europe.
"On a été forcés d'émigrer, on n'a jamais eu le choix", dit Ahmed.

(ARIS MESSINIS / AFP)
Aujourd'hui, Alia, Ahmed et Adam vivent dans une petite maison de trois pièces aux tuiles de briques brunes avec un jardin, dans la ville arborée de Duiven, près de la frontière avec l'Allemagne.
"A la maison"
Ils ont repeint les murs en blanc, suspendu des rideaux roses et planté des tomates. A l'entrée, sur le paillasson, il est écrit: "A la maison".
"On l'a fait", sourit Ahmed, jean et veste en cuir, en sirotant un café au lait concentré sous les rayons du soleil automnal qui filtrent au travers des larges fenêtres du salon.
Depuis qu'ils ont le statut de réfugiés, ils perçoivent une allocation mensuelle de 1.400 euros et ont obtenu un prêt de 3.500 euros de la municipalité de Duiven pour arranger leur maisonnette. Désormais, ils paient un loyer, la sécurité sociale, l'assurance, l'électricité.
Deux fois par semaine, les parents prennent des cours de néerlandais. Le niveau de Ahmed reste basique, Alia se débrouille même si elle passe à l'anglais pour les longues conversations.
Leur fils aux boucles brunes se sent comme un poisson dans l'eau. A bientôt cinq ans, il jongle naturellement entre le néerlandais, l'arabe et l'anglais. Il dit qu'il est "moitié irakien, moitié néerlandais".
Tous les matins, il part à bicyclette vers l'école et quand le temps le permet, il tape le ballon dans un parc voisin. Ici, pas de bombes, les enfants peuvent jouer seuls.
Sa petite enfance est loin d'être conventionnelle mais il va bien, estime la directrice de son école Marike Ketelaars. "Adam est un enfant comme les autres. Il veut jouer dehors et se faire des copains."
Une fois le petit au lit, les parents regardent des séries sur Netflix comme "Game of Thrones" - en néerlandais, sous-titré arabe.
Des plaisirs simples qui, jusqu'à il y a peu, semblaient hors d'atteinte.
Tourments et douche froide
L'angoisse, la fatigue, la crainte d'être renvoyés à la case départ, jamais ils n'oublieront les tourments de leur odyssée pour arriver là.
Une fois arrivés en Grèce par la mer, les épreuves se sont enchaînées, à commencer par le passage de la frontière serbo-hongroise pour pénétrer dans l'UE. En cet automne 2015, la Hongrie y a érigé des barbelés pour contenir le flux ininterrompu de migrants arrivés par les Balkans. S'ils sont attrapés, ils seront parqués dans un camp de rétention.
Alia et Ahmed doivent mettre leur sort entre les mains d'un passeur qui, dans la nuit, les entraîne avec d'autres au milieu d'un champ où ils doivent échapper aux détrousseurs de migrants et aux policiers hongrois.
Dans l'avancée en silence, femmes et bébé au milieu du groupe, ils échappent de justesse à une embuscade, constate alors l'AFP qui les accompagne: émergés de l'ombre, des hommes en tenue de police se tiennent prêts à les attaquer. Des migrants brandissent des branches en guise de défense, les autres s'éparpillent. Alia est pétrifiée de peur. Les assaillants finalement disparaissent dans le noir. Sans doute des voleurs.
Les premiers pas dans cette UE qui les faisait rêver les désarçonnent. A Budapest, ni un hôtel ni même un bordel n'accepte de louer une chambre aux migrants qu'ils sont. Las, ils doivent faire dormir le bébé dans la rue.
En une semaine, leurs économies se sont évaporées.
L'arrivée aux Pays-Bas est un soulagement. Mais il ne dure pas.
Ils ont décidé d'y tenter leur chance sur la route, à la dernière minute, parce qu'ils y avaient de la famille. Mais l'accueil de leurs proches n'est pas à la hauteur de leurs attentes. Une "trahison" pour Ahmed qui se sent abandonné.
Il préfère ne pas s'étendre mais, dit-il, "cela a été la pilule la plus dure à avaler".
C'est le début d'une errance de quatre ans, pendant lesquels ils sont ballottés de camp en camp dont une ancienne prison pour femmes, d'une région à l'autre, perdus dans un labyrinthe de procédures administratives interminables.
En décembre 2015, quand l'AFP les retrouve, la famille vit dans un centre d'exposition reconverti en centre d'hébergement à Leeuwarden, dans le nord. Il habitent dans un box en contreplaqué sans porte ni plafond. "Ce n'est pas la vie, comment expliquer cela?", dit alors Ahmed. "C'est comme être un oiseau dans une cage."
Leur vie ne tient qu'au fil de l'espoir de se voir accorder le droit d'asile, sans quoi ils ne peuvent travailler, louer une maison, se projeter.
Mais deux fois on le leur refuse. Parce que, leur dit-on, Ahmed est revenu en Irak après son exil en Syrie, ce qui contredit les déclarations selon lesquelles il n'est pas en sécurité dans son pays. A chaque fois ils font appel, en vain.
Et ils touchent le fond. Pendant une année ils vivent dans la clandestinité, sans documents, contraints de mendier un lit chez des connaissances, avec le sentiment d'avoir perdu toute dignité
"Je ne pouvais rien faire qui implique de montrer ses papiers", raconte Ahmed. "On me regardait de haut, je valais moins que quiconque."
L'angoisse est telle qu'Alia en perd ses cheveux. "Par moments, c'était plus que je ne pouvais supporter", dit-elle.

Ahmed adore les Pays-Bas et le climat humide qui y règne. "C'est un pays verdoyant magnifique", s'enthousiasme-t-il en tirant sur une cigarette dans son jardin sous le crachin.
"En sécurité"
Peu à peu, le couple s'est approprié les codes du pays. Les courses dans un supermarché abordable du quartier, le pain et les épices arabes dans la ville voisine d'Arnhem.
En Irak, Alia laissait sa mère cuisiner pour toute la famille. Ici, elle apprend sur des tutos de Youtube à préparer des plats irakiens et néerlandais.
Malgré la pandémie de Covid-19 et l'isolement qui l'accompagne, le couple, plutôt sociable, a déjà noué des liens avec les parents d'élèves de l'école qu'ils saluent tous les matins d'un souriant "Goedemorgen" (bonjour).
Depuis leur installation aux Pays-Bas, ils ont bien essuyé des remarques racistes - du type "On fait peut-être ça chez vous mais pas chez nous". Mais "globalement les Néerlandais nous ont accueillis avec chaleur", dit Ahmed.
Encore ébahi de sa nouvelle vie dans ce pays, qui en 2015 a reçu 58.880 demandes d'asile selon le Service néerlandais de l'immigration et des naturalisations (IND), il lui arrive parfois de s'interroger. Cela valait-il vraiment la peine de se mettre en danger pour cet exil en Europe ? "C'est ici que nous avons décidé d'être chez nous", tranche-t-il.
"Libérée"
Aujourd'hui, Alia est une femme transformée, dynamique, sûre d'elle et de son avenir. Plus rien à voir avec celle qui doutait de leur choix de partir, qui se retranchait inquiète derrière son mari lorsque l'AFP l'a rencontrée sur la route des Balkans.
C'est elle qui finalement a obtenu le droit d'asile pour la famille. Contrairement à son mari, elle n'a jamais quitté l'Irak et à Bagdad elle a dû abandonner le lycée après avoir été menacée par des islamistes. Sa demande, appuyée par un avocat, a été acceptée.
Le moral perdu dans les premières années d'exil est revenu avec la rencontre d'un groupe de demandeurs d'asile vénézuéliens et d'une Polonaise. "Nous avons tout traversé ensemble, le pire et le meilleur", dit-elle. "Ils sont devenus ma nouvelle famille."
Avec eux, elle a commencé à voir le pays autrement, à sortir, à danser en discothèque, à s'amuser pour la première fois depuis longtemps.
Plus elle s'intègre dans le pays, plus la jeune femme, fan de pop arabe et de reggae latino, déploie ses ailes. Le contrat de location est à son nom, comme le compte en banque.
Souvent en jean, sweat et baskets, les cheveux bruns décolorés à la mode "tie and dye", elle savoure sa nouvelle vie dans un pays où les droits des femmes sont respectés, elle qui n'a jamais adopté les moeurs traditionnelles du Moyen-Orient.
"Ici, je suis libérée de tout cela."
"Tout est possible"
La nostalgie du pays la gagne parfois. Quand elle évoque sa famille en Irak elle a les larmes aux yeux. Mais aujourd'hui elle "n'a plus aucun regret" d'être partie.
Ce qui ne l'empêche pas de tenir à ses racines irakiennes et de vouloir les transmettre à son fils en lui susurrant des histoires de là-bas, en arabe. "Il va grandir ici mais il doit savoir d'où il vient."
Pour la suite, Ahmed veut passer son permis de conduire et ambitionne de lancer sa propre affaire, peut-être dans les transports. Dans quatre ans, dès qu'il y sera éligible, il fera une demande de nationalité néerlandaise. "Pour pouvoir exercer mes droits et responsabilités dans le pays qui nous a adoptés."
"La route est encore longue mais le pire est dernière nous", dit-il. "Maintenant, tout est possible."
Alia attend leur deuxième enfant. Un jour, comme ses parents, il deviendra un citoyen européen.