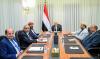PARIS: Jusqu’au bout, l’année 2020 est celle des contrariétés pour l’exécutif français, et tout particulièrement pour Emmanuel Macron. Le président français, connu pour sa volonté de tout maîtriser et qui se définit lui-même comme le «maître des horloges», s’est vu contraint de lâcher prise.
En effet, son action à la tête de l’État lui est désormais dictée par la pandémie de Covid-19, avec ses lourdes conséquences sanitaires et économiques, qui l’obligent à mettre de côté son calendrier de réformes pour se consacrer à la gestion de la crise multiple que connaît la France depuis la fin de l’hiver dernier.
Après une campagne de recommandations sanitaires, de distanciation sociale et de gestes barrières, la décision d’un premier confinement s’est imposée face à la propagation du virus à grande échelle.
Cette décision, annoncée par le président français au cours d’une allocution télévisée dans laquelle il a indiqué la France était en «état de guerre sanitaire», a mis l’économie en berne pendant un mois et vingt-cinq jours.
Du jour au lendemain, le pays est à l’arrêt, les Français confinés chez eux; l’activité économique et commerciale est limitée aux secteurs alimentaire et sanitaire.
Une colère sourde gronde chez les Français. Bien sûr, ils craignent le virus qui tue quotidiennement plusieurs centaines d’entre eux, mais ils éprouvent surtout une grande crainte pour leur survie financière.
Face à cette colère, l’exécutif se devait d’agir. Macron remonte alors au créneau pour annoncer que «personne ne sera laissé sur le carreau» et il dévoile une multitude de mesures urgentes destinées à soutenir aussi bien les plus démunis que les entreprises, dans le but d’éviter les faillites et les licenciements massifs.

À partir de là, la pandémie a pris le dessus, obligeant le président à mettre de côté sa politique de réforme et de rigueur et à ouvrir les vannes des caisses de l’État.
L’action gouvernementale, qui était jusqu’au début de l’année 2020 basée sur la nécessité de renouer avec la croissance, de réduire les dépenses publiques ainsi que la dette pour assainir les finances de l’État, n’était plus de mise.
Il fallait désormais rassurer les Français en luttant contre la Covid-19 et éviter l’effondrement économique du pays à coup d’aides financières, dont le coût avoisine déjà un milliard d’euros, destinées aux différents secteurs d’activité.
Ces dépenses exorbitantes ont permis d’atténuer l’ampleur des dégâts économiques. Ces derniers sont considérables, mais non définitifs, puisque la pandémie n’a pas encore dit son dernier mot.
Après un deuxième confinement imposé du 30 novembre au 15 décembre, la France, qui vit en ce moment sous le régime d’un confinement souple, s’achemine, selon les experts sanitaires, vers une troisième vague de Covid. Elle aurait lieu aux alentours du mois de janvier prochain.
Il est donc impossible pour le moment d’établir une évaluation précise de l’impact de la pandémie sur l’économie française. Cependant, les chiffres publiés par la Banque de France sont d’une grande éloquence. Selon elle, le PIB, qui devait progresser de 8,7%, a en réalité reculé de 11% jusqu’au mois de novembre.
Le chômage, quant à lui, bondira de 9 à 11%, selon la Banque de France, alors qu’un retour, timide, à la croissance n’est peut-être pas prévu avant la fin de l’année 2022.
Ces pronostics sont basés sur des données incertaines. Ainsi, on ignore si la troisième vague est évitable et si une campagne de vaccination sera susceptible de circonscrire la pandémie. Les velléités de réformes économiques et structurelles préconisées par M. Macron sont donc compromises dans le cadre de son mandat actuel.
Et, cerise sur le gâteau, la pandémie s’est attaquée au président en personne. Testé positif, il s’est isolé à la Lanterne (résidence présidentielle secondaire) en compagnie d’une équipe médicale, où il risque de rester confiné jusqu’à la fin de l’année. C’est dire si le vent a tourné.
Ce président à qui tout semblait réussir durant la première année de son mandat en est actuellement réduit à mener une politique qui est aux antipodes de son goût pour l’économie libérale et l’économie de marché. Et, comme si la crise sanitaire et la crise économique qui en découle ne suffisaient pas, Macron s’est trouvé confronté à une nouvelle vague terroriste qui a frappé la France aux mois de septembre et d’octobre, causant la mort de quatre personnes et réveillant les vieilles querelles sur les libertés, la laïcité et, bien sûr, sur la place de l’islam dans la République.
De la rue Nicolas Appert à Paris à la cathédrale de Nice, en passant par Conflans-Sainte-Honorine, les auteurs des attentats prétendaient agir pour défendre l’islam, malmené en France par les caricatures du Prophète. Une nouvelle fois stigmatisés, les Français musulmans se sont vus devant la nécessité de se démarquer des auteurs des attentats et de renouveler leur attachement à la République.
Mais les multiples condamnations qu’ils ont pu exprimer n’ont pas réussi à atténuer la réprobation, voire le rejet dont ils font l’objet dans certains milieux français qui ne se limitent plus, comme par le passé, à l’extrême droite. Car, au fil des années et des crises sociales, économiques et identitaires, une digue a sauté.
Ce président à qui tout semblait réussir durant la première année de son mandat en est actuellement réduit à mener une politique qui est aux antipodes de son goût pour l’économie libérale et l’économie de marché.
Arlette Khoury
Le rejet de l’autre en raison de sa confession ou de son ethnie n’est plus un tabou, mais une conviction assumée et relayée par les médias. La peur que suscite l’islam, souvent confondu avec l’islam politique, s’est ancrée dans l’esprit de nombreux Français.
Prônant un discours de fermeté, Macron et son équipe ont affiché leur volonté de se montrer intraitables avec ceux qui portent atteinte aux libertés publiques, tout en affirmant la suprématie de la laïcité, l’un des fondements de la République.
Ce discours mal compris et mal interprété a valu à Macron et à la France un vaste mouvement de protestations dans plusieurs pays arabo-musulmans ainsi que des campagnes de boycott des produits français.
Il a fallu que les responsables français déploient des trésors de diplomatie pour calmer le jeu et essayer de convaincre du fait que la laïcité n’est pas antinomique avec l’islam ni avec aucune autre religion.
Puis les esprits se sont apaisés. Mais, en l’absence de traitement de fond, la tension peut rejaillir à la moindre secousse.
Ce traitement de fond pourrait résider dans le plan de lutte contre le séparatisme soumis au Parlement le 8 décembre, après plusieurs mois de débats.
Intitulé «projet de loi confortant les principes républicains», ce plan a pour objectif de lutter contre l’islam radical et de répondre aux inquiétudes des Français concernant le terrorisme islamiste, exacerbées depuis les derniers attentats.
Ce plan comporte plusieurs volets et a pour objectif de réprimer la haine en ligne et d’appliquer des sanctions spécifiques dans ce domaine, par l’intermédiaire d’un pôle de magistrats spécialement dédié à ce genre de délit. Il consiste également à garantir la transparence des conditions de l’exercice du culte et de son financement. Il prévoit surtout de mettre fin à la formation des imams à l’étranger et de promouvoir leur formation en France.
Des conditions strictes seront imposées aux associations cultuelles qui sollicitent des aides publiques à travers une charte de la laïcité, et une surveillance étroite sera exercée sur l’enseignement dans les écoles sans contrat avec l’État. Les mesures seront adoptées pour garantir la neutralité dans les services publics et l’égalité homme/femme.
Ce plan consiste par ailleurs à œuvrer pour une cohésion nationale avec les quartiers défavorisés, à travers des mesures favorisant la qualité de l’enseignement et le désenclavement afin de mettre un terme au sentiment d’abandon qui pousse les jeunes vers les trafics en tout genre et la radicalisation.
Il est clair que si le président français et son équipe gagnent leur pari dans ce domaine, ils seront à même d’afficher une étoile à leur palmarès. Cette étoile sera d’autant plus importante à l’approche de l’élection présidentielle de 2022, au sujet de laquelle Macron refuse de se prononcer.
Dans un entretien récemment consacré aux questions que se posent les jeunes, il a déclaré d’une manière énigmatique: «Peut-être que je ne pourrai pas être candidat, peut-être que je devrai faire des choses dans la dernière année, les derniers mois…»
En effet, si le candidat Macron, qui avait pour objectif affiché de transformer la France par des réformes profondes, évalue le bilan du président Macron trois ans après son élection, il verra la France bel et bien transformée, mais pas par sa propre volonté. Il verra une France amoindrie, appauvrie et ralentie par les pires crises qu’elle a connues depuis la fin de la Seconde Guerre mondiale.