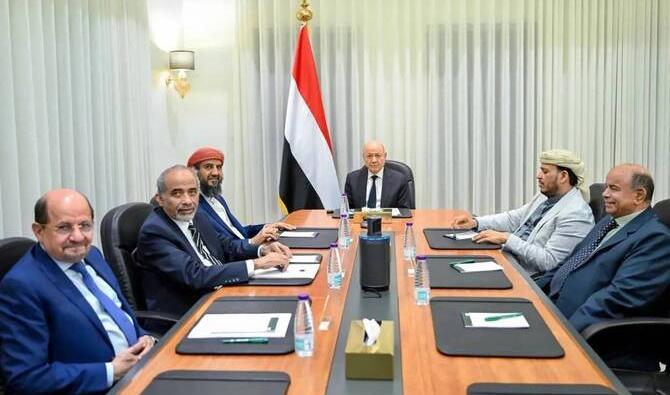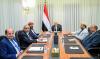PARIS: Riad Salamé a longtemps été perçu comme l’homme fort du Liban, le gardien, en quelque sorte, d’un modèle économique qui faisait des jaloux partout dans la région. Habile financier primé par les plus grandes institutions financières, garant de la stabilité de la livre libanaise depuis près de trente ans, le banquier a vu sa vie basculer avec le début de la révolte populaire en octobre 2019, et l’effondrement économique dans lequel s’est enlisé le Pays du Cèdre.
Depuis, Riad Salamé est sous le feu des critiques. On l’accuse notamment d’avoir fait vivre les Libanais dans une « bulle artificielle » et d’avoir fait mauvais usage de leur argent à travers des financements accordés à l’État, (mal) géré par une classe politique corrompue jusqu’à la moelle.
Dans une interview exclusive accordée à Arab News en français, Riad Salamé, gouverneur de la Banque du Liban (BDL), se défend de ces accusations, qu’il estime « injustes ». Il affirme notamment être en faveur de l’audit de la BDL par des experts de la Banque de France, une proposition du président français, Emmanuel Macron, en visite au Liban après l’explosion au port de Beyrouth, le 4 août dernier, afin de faire avancer les négociations avec le Fonds monétaire international (FMI).
« Un audit de la banque du Liban a été mené par deux firmes internationales, et cela depuis 1993, rappelle toutefois Riad Salamé. Les derniers rapports de cet audit ont été envoyés au FMI au début des négociations. Il faut donc savoir que cet audit international existe, pour dissiper tout doute sur la manière dont est gérée la Banque du Liban. Quant à la proposition que la Banque de France fasse un audit de la BDL, nous l’accueillons favorablement. La décision relève de la Banque de France, mais nous sommes prêts à accueillir ces experts quand ils le souhaitent. »
Il faut donc savoir que cet audit international existe, pour dissiper tout doute sur la manière dont est gérée la Banque du Liban. Quant à la proposition que la Banque de France fasse un audit de la BDL, nous l’accueillons favorablement. La décision relève de la Banque de France, mais nous sommes prêts à accueillir ces experts quand ils le souhaitent
Riad Salamé
Le 30 avril 2020, le gouvernement a annoncé un plan de relance et demandé une aide du Fonds monétaire international, duquel Beyrouth espère obtenir une aide d’environ 10 milliards de dollars. Le Liban a initié les négociations avec le fonds, mais près de trois mois plus tard, le processus est au point mort.
S’il admet que le Liban doit négocier avec le FMI, le gouverneur de la BDL souligne être en faveur d’« une implication du FMI au Liban, même si certains ont prétendu le contraire ». Pendant les négociations cependant, une commission parlementaire et le gouvernement ont divergé sur l'estimation des déficits publiques, de ceux de la Banque centrale et de ceux des banques : de 60 000 à 241 000 milliards de livres libanaises (soit des dizaines de milliards de dollars). Le FMI a alors réclamé une seule évaluation.

« L’approche que nous avons adoptée diffère de celle du plan gouvernemental, explique Salamé. Les différences proviennent essentiellement du fait que, dans notre approche, nous n’avons pas considéré qu’il fallait avoir des réductions sur les montants de la dette qui est en livres libanaises. Nous n’avons pas non plus pris en considération des différences sur le cours de change. En effet, la moitié des pertes imputées à la Banque centrale dans le plan gouvernemental proviennent du fait que le cabinet y fait varier le prix du dollar de 1 500 livres pour un dollar à 3 500. C’est cette perte-là que nous n’avons pas prise en compte. Les différences sont donc plutôt dues aux hypothèses de départ, sans compter des différences au sujet des dettes non performantes. »
« Notre objectif a été de réduire les pertes tout en restant transparents, mais il s’agissait surtout de réduire les contraintes que les Libanais doivent endurer à cause des réformes dues à la crise actuelle », affirme-t-il encore.
À la question de savoir pourquoi le FMI n’a pas accepté les chiffres de la BDL, Salamé justifie : « Le fonds a ses propres principes et concepts. […] Il nous les a exposés. Mais c’est aux Libanais de négocier maintenant, parce que l’objectif est réellement de pouvoir trouver une issue à la crise qui, pour le Liban, relève essentiellement d’un appui international. Et ce dernier n’aura pas lieu sans l’appui du Fonds monétaire ou sans accord politique. »
Des réformes qui tardent
Au fond du gouffre économique, le pays connaît depuis plusieurs mois une dépréciation inédite de sa monnaie, une flambée des prix, des licenciements à grande échelle et des restrictions bancaires draconiennes sur les retraits et les virements à l'étranger.
Accusé d’avoir « prêté » l’argent des déposants dans les banques à l’État, jugé incompétent et corrompu, Salamé se défend et affirme que la banque centrale « n’a pas pris l’argent des déposants. […] La BDL a essentiellement fait des prêts en livres libanaises, qui est une devise que la Banque centrale émet elle-même. Cela doit être clair. »
« Responsabiliser la Banque centrale comme un conduit entre les déposants, les banques et l’État ne relève pas de la réalité. Nous sommes capables d’imprimer des billets en livres libanaises, donc nul besoin d’utiliser l’argent des banques. Pour rappel, la plus grosse part de la dette que nous avons envers l’État est en livres libanaises. Vous me demanderez où sont donc parties les réserves du pays en devises étrangères… Sur les cinq dernières années, la balance courante a accusé un déficit cumulé de 56 milliards de dollars et le déficit budgétaire était de 25 milliards de dollars. Ce montant total de 81 milliards de dollars est le trou financier du Liban. Il n’est pas du tout lié à la Banque centrale, mais provient des chiffres de l’importation et du déficit du gouvernement », poursuit Salamé.
« Notre objectif a été de réduire les pertes tout en restant transparents, mais il s’agissait surtout de réduire les contraintes que les Libanais doivent endurer à cause des réformes dues à la crise actuelle »
Riad Salamé
Le gouverneur n’aurait-il pas dû alerter le gouvernement sur le danger du déficit, puisqu’il tenait les manettes financières du pays, alors qu’il avait rassuré les Libanais de nombreuses fois, répétant qu’il n’y avait pas lieu de s’inquiéter ? « À la banque centrale, tout était dans l’ordre, assure le gouverneur. Personnellement, je n’ai pas cessé de réclamer des réformes et une réduction des déficits à chacune de mes interventions – certaines avec vous d’ailleurs. Je déclarais que nous étions dans une situation où nous contrôlions la situation monétaire, mais je n’ai jamais rassuré sur l’état des finances publiques. J’ai répété et insisté sur le qu’il fallait adresser des réformes pour préserver la stabilité monétaire. Aux conférences de Paris 1, 2 et 3, ainsi qu’à la conférence Cedre, j’ai exigé qu’il y ait des réformes. »

Si le gouvernement libanais a adopté, fin avril, son plan de sauvetage économique pour relancer la croissance et assainir les finances publiques, les réformes, notamment dans le domaine de l'électricité, peinent à se concrétiser.
Sur ce plan, Riad Salamé tient à rappeler que la Banque centrale a prêté de l’argent à l’État « par obligation légale ». « Ce n’est pas comme si nous sommes allés chercher des placements avec l’État libanais, explique-t-il. En effet, l’article 91 du Code de la monnaie et du crédit oblige la Banque centrale à financer le gouvernement quand il le demande. Dans les budgets votés par les parlements en 2018, également, il nous a été demandé de prêter 6 milliards de dollars en livres libanaises, à un taux d’intérêt inférieur de 1 % aux taux d’intérêt pratiqués. En 2019, une autre loi a été promulguée pour que la BDL prête 3,5 milliards de dollars, en livres libanaises également et à 1% de taux d’intérêt. Quant au budget de 2020, une loi nous a demandé de rembourser les intérêts que nous percevons sur le portefeuille que nous avons avec l’État, et de rembourser aussi un trillion de livres libanaises. En d’autres termes, 3 milliards de dollars. Ce n’est pas réellement juste de dire que la Banque centrale et son gouverneur ont peint la vie en rose pour les Libanais. Je me demande s’il n’y a pas de mauvaises intentions derrière cette image qu’on essaie de nous coller… »
S’il accuse les gens au pouvoir d’avoir ces mauvaises intentions envers lui, Riad Salamé estime que c’est peut-être dû « à la politique locale ou pour des raisons idéologiques, ou par opportunisme », mais il révèle que « falsifier les réalités au cours des mois derniers » l’a vraiment « surpris ».
Concernant les reproches qu’on lui a adressés sur le fait d’avoir basé sa stratégie financière sur une gigantesque « pyramide de Ponzi » avec des ingénieries financières et des emprunts qui ont coûté cher au Liban, Salamé répond : « Quand vous regardez les transactions effectuées entre les banques et la Banque centrale, et les chiffres entre 2017 et juin 2020, vous constatez que la Banque centrale a émis des liquidités en devises au marché, aux banques et a également collecté des devises des banques. Vous serez surpris de constater que nous avons injecté des devises bien plus qu’on en a retiré : 11,5 milliards. »
"Je me demande s’il n’y a pas de mauvaises intentions derrière cette image qu’on essaie de nous coller… "
Riad Salamé
« L’argent des déposants est bien là »
Comment explique-t-il donc le fait que les banques n’ont plus d’argent ? « Cet argent est parti dans le déficit des balances commerciales. Ponzi ne serait pas fier de nous car, en principe, c’est la Banque centrale qui aurait dû en profiter s’il y avait vraiment un schéma de Ponzi », explique Salamé.
Et d’ajouter : « Il y a eu des chocs consécutifs qui ont mis sur les banques une pression qui a créé une panique chez les déposants, notamment la fermeture des banques en octobre pour un mois durant le début des manifestations. Cela a transformé l’économie libanaise en « cash economy ». Les gens ont perdu confiance dans le système. Puis la déclaration par le gouvernement que le pays n'était pas capable de rembourser les échéances de sa dette souveraine sur les eurobonds. J’étais personnellement contre et je l’ai exprimé officiellement ».
Le 7 mars, le Liban, qui croule sous une dette de 92 milliards de dollars (170% du PIB), a fait défaut sur une première tranche de sa dette, d'un montant de 1,2 milliard de dollars. Le 23 mars, il a annoncé qu'il ne paiera pas l'ensemble de ses bons du Trésor émis en dollars.

« Cela a malheureusement empêché le Liban d’avoir accès aux marchés internationaux et aux crédits bancaires internationaux, ce qui nous a handicapés, explique Salamé. Puis sont venus les effets de la Covid-19 et l’explosion du port. Dans tout cela, le système tient bon quand même. L’argent des déposants est bien là. Ils le retirent progressivement, investissent dans l’immobilier, et obtiennent des prêts. Il n’est pas vrai que l’argent a disparu. Le seul handicap concerne les transferts internationaux, et ceux-là se règleront une fois que les réformes seront faites et que la confiance sera rétablie. Et nous avons discuté de la finalité du plan du gouvernement. Nous sommes opposés au haircut (ponctions sur les dépôts) pour les déposants. Notre intention est que le déposant récupère son argent. Cela peut prendre du temps, mais il le récupèrera. Déjà, de nombreux déposants ont investi dans l’immobilier pour conserver la valeur de leurs dépôts. »

Toutefois, de nombreux Libanais se plaignent du fait que le haircut est appliqué de facto, puisque les déposants en dollars ne peuvent retirer qu’une somme limitée de leur argent et en livres libanaises, au taux de 3 800 livres pour un dollar, alors que le taux au marché noir oscille actuellement autour de 8 000 livres pour un dollar.
« C’est le marché qui décide cela, ainsi que le client, selon le gouverneur. Il n’y pas une loi qui soustrait l’argent des gens, et la différence est cruciale. Aujourd’hui, il est certain qu’il existe différents prix pour le dollar, mais le prix officiel ainsi que celui pratiqué pour les importations et celui du marché noir varient du fait qu’on est devenu une cash economy. Avec tous ces événements, il y a une pression certaine. L’explosion du 4 août a détruit de nombreuses maisons et les gens ont besoin de liquidités. D’autant que les commerçants n’acceptent que de l’argent liquide. Mais il n’y a pas de loi qui stipule cela. Ce que le marché décide est différent de ce que fait le législateur. »
Le 7 mars, le Liban, qui croule sous une dette de 92 milliards de dollars (170% du PIB), a fait défaut sur une première tranche de sa dette, d'un montant de 1,2 milliard de dollars. Le 23 mars, il a annoncé qu'il ne paiera pas l'ensemble de ses bons du Trésor émis en dollars.
Et de poursuivre : « Aujourd’hui, le cabinet pense créer un fonds pour y regrouper de l’immobilier et donner des certificats de devises à la Banque centrale émanant de ce fonds, ce qui pourra diminuer les pertes sans augmenter les dettes, et peut-être créer la symétrie nécessaire pour exécuter le plan. L’idée est encore récente, le ministre des Finances vient de l’exposer. »
Vers la fin des subventions ?
Il y a quelques jours, une source officielle à la Banque du Liban révélait à l’agence Reuters que la Banque du Liban ne pouvait assurer les subventions sur le carburant, les médicaments et le blé que pour trois mois, une déclaration que le gouverneur confirme.
« La BDL fait de son mieux, mais elle ne peut pas utiliser les réserves obligatoires des banques pour financer le commerce, affirme-t-il. Une fois que nous atteignons le seuil de ces réserves, nous sommes obligés de ne plus financer. Mais nous sommes en passe de créer d’autres moyens de financement, que ce soit à travers les banques ou à travers un fonds que nous avons mis en place à l’étranger, baptisé “Oxygen”. Mais la BDL n’est pas l’État, qui doit agir. On ne peut pas tout mettre sur le dos de la Banque centrale et lui reprocher ce qu’elle fait après coup. Nous avons exposé la situation bien à l’avance. Que les responsables prennent les mesures nécessaires. »
Interrogé sur les montants colossaux sortis du Liban par les banquiers et les politiques avant le 17 octobre et sur l’éventuelle possibilité de retracer leur cours, le gouverneur de la BDL assure : «Nous allons bientôt faire un circulaire pour responsabiliser ces déposants et les inciter à ramener une liquidité importante au pays sans leur confisquer leur argent pour autant. Aujourd’hui, c’est une question éthique, et non pas légale, car c’est un système qui a profité à tout le monde. Dans la triste situation où nous nous nous trouvons, la BDL se doit de responsabiliser ces déposants qui, en refinançant le pays à travers des dépôts externes, peuvent recréer de la liquidité au secteur bancaire. »
Nous allons bientôt faire un circulaire pour responsabiliser ces déposants et les inciter à ramener une liquidité importante au pays sans leur confisquer leur argent pour autant. Aujourd’hui, c’est une question éthique, et non pas légale, car c’est un système qui a profité à tout le monde.
Riad Salamé
Accusé enfin par certains d’avoir profité du système pour son enrichissement personnel, Salamé répond qu’il gagnait bien sa vie avant de devenir gouverneur de la BDL, avec un salaire de 165 000 dollars par mois à la banque Merrill Lynch. « J’ai montré tous les documents à la télévision. Je suis arrivé à la BDL avec une fortune de 23 millions de dollars, qui a été investie et a donné des résultats. On m’accuse d’avoir siphonné des milliards sans chercher à connaître les dettes en face. Ma réponse est claire : puisque je peux démontrer la source de ma fortune, c’est suffisant pour prouver que je n’abuse pas de mon poste. J’ai d’ailleurs intenté un procès contre ceux qui me diffament. »
La sortie de crise est-elle pour bientôt ? « Elle est d’abord politique, selon Riad Salamé. Ce sont surtout les tensions régionales qui ont pris le dessus au Liban et il faut un soutien international pour créer une liquidité dans le pays. Je ne doute pas que les Libanais pourront se débrouiller après. »