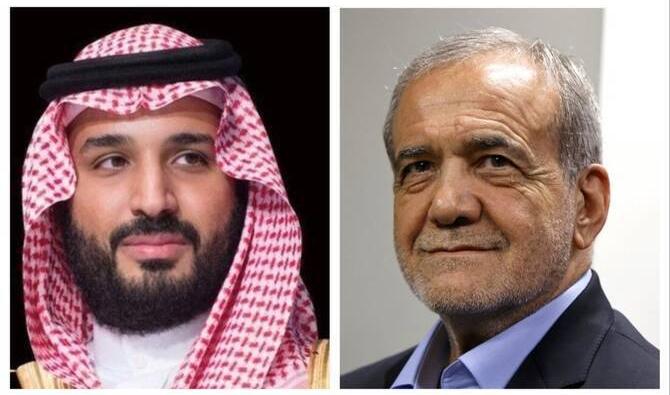PARIS: Dégoûtés. Le mot revient comme un leitmotiv chez de nombreux Algériens en France, lassés de se sentir traités comme des "sous-citoyens" par leur pays d'origine. Beaucoup n'iront pas voter aux législatives, une élection qui ne les "concerne pas".
Le scrutin, prévu samedi en Algérie, s'est ouvert dès jeudi en France, où plus de 700.000 électeurs sont inscrits. L'ambassadeur algérien Mohamed-Antar Daoud s'est rendu au consulat parisien pour voter, sous haute sécurité, et a assuré qu'il y avait un "engouement" pour ces élections de "l'Algérie nouvelle".
Mais pour Lila et Nadia, qui attendent une distribution de fruits et légumes dans le quartier parisien de Belleville, le scrutin est le cadet de leur souci. Elles pensent plutôt à l'impossibilité de revenir voir la famille à Alger depuis le début de la pandémie de Covid, aux billets d'avion introuvables ou hors de prix, et à la quarantaine de cinq jours imposée à l'arrivée en Algérie, aux frais du voyageur.
"Ils s'imaginent quoi les généraux? Que nous, les binationaux, on n'a qu'à se baisser pour ramasser de l'argent ? L'Algérie ne m'a rien donné. Ils m'ont dégoûtée. Dégoûtée", lance Lila, une Algéroise de 70 ans, arrivée en France à l'âge de 20 ans. Comme beaucoup d'autres, elle accepte de discuter, mais anonymement, et sans être filmée.
"Les vrais Algériens, ceux qui ont l'amour de leur patrie, je pense qu'ils ne vont pas aller voter. C'est un système corrompu, pour les généraux, les hauts placés, les députés. Ils se servent. Le peuple vient en dernier", poursuit l'ex-animatrice, qui vit désormais d'une pension d'invalidité.
Un son de cloche largement partagé alors que le principal enjeu des législatives pour le pouvoir algérien va être la participation, après deux scrutins en 2019 et 2020 marqués par une abstention historique.
« Comme du bétail »
L'élection ? "Je suis une je-m'en-foutiste", lance une jeune franco-Algérienne de Marseille, Hadjer, venue récupérer un passeport au consulat de la grande ville du sud-est, sans un regard pour les affiches électorales sur les murs du bâtiment.
Ils ne sont pas spécialement politisés, n'ont pas forcément manifesté aux rassemblements régulièrement organisés par la diaspora en France en soutien au Hirak, le mouvement contestataire algérien né en 2019 et laminé par la répression.
Mais la gestion chaotique de la pandémie par le gouvernement du président Abdelmadjid Tebboune, et les mauvaises nouvelles en provenance du "bled" alimentent leur colère.
"Les expatriés algériens lambda commencent à comprendre pourquoi on manifeste et pourquoi on est contre ce pouvoir. Ils réalisent à qui ils ont affaire: un régime qui les traite comme du bétail, des vaches à lait", constate Faïza Menaï, membre du collectif Debout l'Algérie, un regroupement d'associations et de militants qui tente d'entretenir la flamme du Hirak en France.
Dans la communauté algérienne, de nombreuses vidéos de citoyens en colère racontant leur périple pour revenir au pays, leur "humiliation" face aux entraves, sont partagées depuis des semaines.
L'Algérie, un pays dans l'impasse 60 ans après son indépendance
L'Algérie, où des législatives sont prévues le 12 juin, connaît une multicrise à la fois politique, sociale et économique, avec un régime impopulaire confronté au soulèvement populaire du Hirak depuis février 2019 et la chute de la rente pétrolière.
Dépendance aux hydrocarbures
Socialiste jusqu'au début des années 1990, l'économie reste ancrée dans une tradition de forte intervention étatique. Le pays est très dépendant de la rente pétrolière -- plus de 90% de ses recettes extérieures --, qui subventionne notamment carburants, gaz, électricité, eau, santé, logements et produits de base.
Pays membre de l'Organisation des pays exportateurs de pétrole (Opep), l'Algérie est le 3e producteur de brut d'Afrique et parmi les dix premiers producteurs mondiaux de gaz.
Mais l'économie subit lourdement et durablement les effets de la pandémie de Covid-19 qui vient s'ajouter à la crise pétrolière.
Et les autorités font face à une multiplication des conflits sociaux, alimentés par un taux de chômage élevé (15%) et une paupérisation de larges franges de la société.
Passé colonial
Colonisée par la France pendant 132 ans, après trois siècles de domination ottomane, l'Algérie proclame son indépendance le 5 juillet 1962 à l'issue d'une guerre de libération sanglante de près de huit ans.
En septembre 1963, Ahmed Ben Bella, secrétaire général du Front de libération nationale (FLN), devient le premier président de l'Algérie indépendante.
En 1965, il est renversé par un coup d'Etat du colonel Houari Boumédiène, puis emprisonné. M. Boumédiène va diriger le pays d'une main de fer jusqu'à son décès fin 1978. Chadli Bendjedid lui succède et est réélu en 1984 et 1988 lors d'une présidentielle où il est le seul candidat.
«Décennie noire»
En octobre 1988, de violentes émeutes secouent Alger où l'état de siège est instauré. L'armée rétablit l'ordre en menant une répression meurtrière, tout en engageant des réformes qui mettent fin au règne du parti unique, le Front de libération nationale (FLN).
L'annulation en janvier 1992 du premier tour des premières législatives multipartites, remporté par le Front islamique du salut (FIS), déclenche une guerre civile, jalonnée de massacres, entre groupes islamistes et forces de sécurité.
Le 15 avril 1999, Abdelaziz Bouteflika, adoubé par l'armée, est élu président en pleine guerre civile.
Deux lois d'amnistie, en 1999 puis en 2005, largement adoptées par référendum, convainquent de nombreux islamistes de quitter le maquis et de déposer les armes. La "décennie noire" a fait officiellement 200 000 morts entre 1992 et 2002.
Hirak
En 2014, M. Bouteflika, candidat du FLN, est réélu pour un 4e mandat (81,49% des voix) malgré un accident vasculaire cérébral survenu l'année précédente qui l'a laissé handicapé et aphasique.
Début 2019, sa candidature à un 5e mandat provoque la colère de la rue qui se sent humiliée.
Un mouvement ("Hirak" en arabe) de protestation d'ampleur inédite naît le 22 février et contraint Abdelaziz Bouteflika, lâché par l'armée et plusieurs de ses alliés, à démissionner le 2 avril.
Le 12 décembre, Abdelmadjid Tebboune, un apparatchik, ex-Premier ministre de Bouteflika, remporte la présidentielle, marquée par un taux d'abstention record, mais il est aussitôt contesté par le Hirak qui continue d'exiger le démantèlement du "système" au pouvoir depuis l'indépendance.
En mars 2021, le président Tebboune, de retour d'Allemagne où il a été longuement soigné du Covid-19, convoque des élections législatives anticipées le 12 juin.
Ces élections apparaissent comme une tentative du pouvoir de reprendre la main face à la reprise en février du Hirak dans la rue, après un an d'interruption due à la pandémie.
Déterminé à appliquer sa "feuille de route" électoraliste, le régime -- dont le pilier reste l'armée -- interdit les marches du Hirak.
Plus grand pays d'Afrique
Pays du Maghreb, l'Algérie est le plus grand pays d'Afrique (2 381 741 km2). La majorité du territoire est constituée de régions désertiques.
Plus de 80% de ses 44 millions d'habitants vivent sur le littoral, surtout dans la capitale Alger et sa région. Près de 54% de la population a moins de 30 ans.
Le pays compte quelque 10 millions de berbérophones, la plupart vivant en Kabylie, région montagneuse, réputée frondeuse, à l'est d'Alger.
Langue du colonisateur, le français ne fait pas partie des langues officielles -- arabe et tamazight (berbère) --, mais le pays compte de très nombreux francophones.
Lassitude
"Les Algériens commencent à s'intéresser à la politique alors que le pouvoir a tout fait depuis l'indépendance pour les dépolitiser et les diviser, laïcs contre islamistes, arabes contre kabyles", se félicite Ylias Lahouazi, membre du conseil nation du RCD (Rassemblement pour la culture et la démocratie), qui boycotte le scrutin.
La colère est partagée des deux côtés de la Méditerranée et, ajoutée à la crise économique et sociale qui ronge l'Algérie, constitue un "cocktail explosif", selon le militant Samir Yahiaoui. "Lorsque les gens sont désespérés, il y a un risque d'explosion majeure", met-il en garde.
Mais plus que la politisation ou la "conjonction des luttes sociale et politique" dont rêvent les activistes, c'est un sentiment de lassitude qui domine.
Comme l'explique le septuagénaire Mohand, ancien professeur de maths algérien, exilé en France depuis 50 ans: "On ne nous voit pas. On ne nous écoute pas. Que j'aille manifester ou pas, voter ou pas, le résultat est le même. C'est toujours les mêmes qui se remplissent le ventre, l'Algérie éternellement corrompue", soupire le vieux monsieur en tirant son caddie de retour du marché de Barbès, un quartier populaire de Paris à forte population algérienne.
Un sentiment d'amour trahi revient aussi en boucle: "J'adore mon pays mais il ne veut pas de nous", s'énerve Soufiane, un chef cuisinier de 30 ans. "C'est un très beau pays, mais ils ne nous aiment pas", renchérit Nadia, l'Algéroise de Belleville.