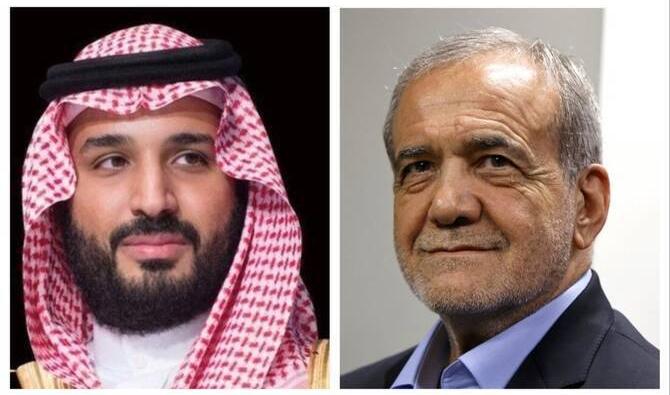ALGER: L’Algérie célèbre ce 1er novembre le 67e anniversaire du déclenchement de la «guerre de libération», lorsque le groupe dit «des 22» a décidé de lancer une bataille qui allait durer sept ans et qui avait pour ambition de libérer le pays d’un joug colonial de cent trente-deux ans.
Formés politiquement et engagés militairement, les vingt-deux militants du mouvement national étaient conscients du fait qu’il était important qu’ils se regroupent au sein d'un «front» uni. Ils ont décidé de «jeter la révolution dans la rue pour qu'elle soit portée à bras-le-corps par tout le peuple».
Pour commémorer cette date phare de l’histoire de l’Algérie, des festivités sont prévues dans toutes les grandes villes du pays. «Les fils de la Toussaint» (en référence au Groupe des 22) ont répondu présents, ce 1er novembre 1954. Les mots de la «déclaration» du 1er novembre faisaient écho aux premiers tirs de balles qui avaient retenti aux quatre coins du pays. Les «indigènes» algériens, qui revendiquaient des terres confisquées et dénonçaient une nation niée, défiaient enfin l’empire colonial.
L'épopée d'un peuple
Historien et chercheur au Centre de recherche en anthropologie sociale et culturelle (Crasc), Amar Mohand-Amer estime pour sa part qu’«une Algérie qui veut devenir forte devrait impérativement développer son économie, consolider ses institutions et revenir à l’âge d’or de la diplomatie, celle des décennies 1960 et 1970, héritière du GPRA (Gouvernement provisoire de la république algérienne [1958-1962]), né de la guerre de libération nationale».
Pour le chercheur, les dates clés de l'Algérie illustrent que «l’histoire n’est pas du saucissonnage» car «aucune société ne doit faire de concessions». Il estime que «l’université algérienne devrait se pencher sérieusement sur cet héritage».
Par ailleurs, selon M. Mohand-Amer, ce 1er novembre intervient dans un contexte marqué par «la remontée fulgurante, ces dernières années en France, des idées de la droite dure et extrême».
Il fait savoir que «cette dynamique est portée par de puissants relais médiatiques [qui sont] de connivence et ont collaboré avec les porteurs et les entrepreneurs de la mémoire de la colonisation de l’Algérie par la France (1830-1962)» – ceux qui «restent dans le déni et qui professent une histoire faisant la part belle au système colonial ainsi qu’en justifiant ses méfaits et massacres».
Se fondant sur l'idée que la mémoire constitue ce qui illustre le poids de l'histoire entre Alger et Paris, l'historien précise que «ces forces sont bien ancrées en France, car cette mémoire constitue un carburant électoral conséquent et efficace». Il estime que «cela a toujours été le cas en France».
Le poids de l'histoire qui pèse sur les relations algéro-françaises est tellement lourd que l'historien n'hésite pas à affirmer que «le politique nuit à la recherche historique et la pollue».
Pour les jeunes, l'importance de la transmission intergénérationnelle
À chaque rendez-vous historique, le peuple algérien commémore cette époque au cours de laquelle il a consenti les plus grands sacrifices sur tous les fronts. «Lors de ces années, le peuple algérien a écrit l’une des plus belles pages de son histoire», déclare ainsi Wahiba, étudiante en histoire à l’université d’Alger, à Arab News en français. Dans la nuit du 1er novembre 1954 poursuit-elle, une vague d'attentats a eu lieu sur l'ensemble du territoire algérien. Ce fut le début du soulèvement des nationalistes algériens.
Du haut de ses 25 ans, cette jeune étudiante met en exergue l'importance de la transmission intergénérationnelle. Pour elle, il s’agit de «voir notre histoire en face, parler des vérités historiques de la lutte algérienne et ancrer la symbolique du sacrifice dans les générations futures afin de perpétuer les valeurs pour lesquelles se sont sacrifiés nos martyrs». Elle poursuit: «L’histoire de la lutte est une leçon dont les significations sont multiples. Les Algériens en tireront les principes et les valeurs qui ont constitué le ciment d’une nation en quête d’indépendance.» L’étudiante explique que l’attachement des générations futures aux sacrifices de leurs aînés est une condition sin qua non pour apprendre à aimer son pays, et surtout pour préserver un acquis inaliénable: la liberté.
Vissé à l’écran de son téléphone, Mokrane, originaire de Beni Yenni (wilaya de Tizi Ouzou, à 90 kilomètres à l’est d’Alger) est fier que sa région ait contribué aux efforts pour libérer le pays. Il explique que «les revendications politiques des Algériens, [qui se sont exprimées] dès 1910, sont restées lettre morte»; ces derniers étaient considérés comme des «indigènes» aux yeux de l'administration française. Les colons – issus notamment d’Espagne, de Grèce, d’Italie ou de France – ont trouvé dans les territoires algériens occupés un espace pour y exercer leur hégémonie.
En effet, les massacres du 8 mai 1945 constituent selon lui un tournant majeur dans la conscience collective de ces «indigènes» et un point de non-retour pour le mouvement national, et la prise de conscience du fait que c’est par la force que la liberté doit être conquise.
L'indépendance confisquée?
Fidèle à la rigueur académique qu'impose la recherche scientifique, M. Mohand-Amer fustige la communauté des chercheurs: «Son rôle [celui de la discipline] est de créer les conditions appropriées à son développement et à sa promotion dans le cadre des règles académiques.» Il conclut: «Le bout du tunnel viendra quand l’histoire sera du ressort des historiens et des archivistes.»
Le chercheur en profite pour rappeler que «les historiens algériens sont en butte avec la fermeture quasi totale des archives publiques en Algérie [en effet, l’accès à ces fonds est entravée]». Il précise également que de semblables entraves relatives à des fonds précis qui sont en relation avec l’histoire coloniale sont également signalées en France.
Les déclarations de Mohand-Amer font écho aux recommandations du rapport de l'historien Benjamin Stora «sur la mémoire de la colonisation et de la guerre d’Algérie». Dans l'une d’elles, ce dernier souligne qu’il est impératif d'avancer sur la question des archives et d’avoir pour objectif, d’une part, le transfert de certaines archives de la France vers l'Algérie, et d'autre part le fait de permettre aux chercheurs des deux pays d’accéder aux archives françaises et algériennes.
Comme dans tout processus d'indépendance, la révolution algérienne a également connu des conflits, des luttes intestines, des volontés de domination, mais l'indépendance fut acquise au prix d'un lourd tribut payé sur l'autel de la liberté. L’écrivain ivoirien Ahmadou Kourouma avait d’ailleurs écrit: «Nous attendaient le long de notre chemin les indépendances politiques, le parti unique, l'homme charismatique, le père de la nation, puis les autres mythes: la lutte pour l'unité nationale, pour le développement, le socialisme, la paix, l'autosuffisance alimentaire. Salmigondis de slogans qui, à force d'être galvaudés, nous ont rendus sceptiques, pelés, demi-sourds, demi-aveugles, bref plus nègres que nous étions avant».