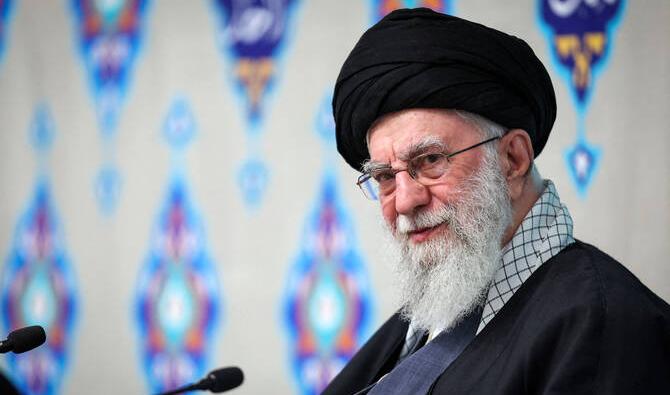CASABLANCA: «Le Maroc s'est fait un nom en tant que leader climatique. Le pays revendique certains des plus grands projets d'énergie propre au monde», lisait-on dans un article du média britannique BBC, publié le 19 novembre dernier. Le 9 novembre, le Maroc pointait au 5e rang mondial dans l’Indice de performance du changement climatique de 2022, aux côtés du Danemark, de la Suède, de la Norvège et du Royaume-Uni. L’indice révélé à l’occasion de la COP26 à Glasgow met en avant les efforts consentis par 60 pays dans la lutte contre le réchauffement climatique.
C’est un secret de polichinelle. Le Royaume du Maroc qui a multiplié ces dernières années les projets et les chantiers titanesques dans le domaine des énergies renouvelables est très souvent cité comme exemple en la matière, non seulement au niveau régional ou continental, mais également à l’échelle mondiale. La centrale solaire d’Ouarzazate qui s’étend sur 3 000 hectares est aujourd’hui la plus grande centrale au monde et lui a valu les éloges de plusieurs institutions et organisations internationales.
Depuis près d’une décennie, le Royaume chérifien est dans les radars des plus grands noms du domaine des énergies renouvelables. Des investissements importants dans le solaire, l’éolien et l’hydraulique ont été injectés dans les quatre coins du pays. Le Royaume présente en effet un potentiel énorme et un cadre incitatif propice à ces investissements, mais qui attire le plus ces investisseurs c’est la viabilité d’une stratégie ambitieuse et volontariste du secteur, une feuille de route suivie de très près et portée au plus haut sommet de l’État par le roi Mohammed VI. La vision clairvoyante du Monarque a été formulée en 2009 par la stratégie énergétique du pays, basée essentiellement sur les énergies renouvelables et le développement de l'efficacité énergétique, et qui s’est fixée comme objectif de porter la part des énergies renouvelables dans la puissance électrique installée à plus de 52% en 2030.
Les énergies propres représentent 37% du mix énergétique
Douze années après son lancement, cette stratégie s’avère concluante puisqu’aujourd’hui les énergies renouvelables contribuent d'environ 20% dans la production de l'énergie électrique, pour une puissance électrique de 37%. Le ratio de dépendance énergétique s’est réduit de 7 points de pourcentage entre 2009 et aujourd’hui. De même, pas moins de 50 projets d’énergies renouvelables ont vu le jour et une soixantaine sont dans le pipe. La capacité installée de sources renouvelables a atteint 3 950 MW, dont 710 MW de source solaire, 1 430 MW de source éolienne et 1 770 MW de source hydroélectrique.
Des chiffres qui font la fierté de ce pays d’Afrique du Nord qui, grâce à la perspicacité et l’engagement de ses gouvernants et du roi Mohammed VI, peut se targuer de ses performances et réalisations en matière de lutte contre le changement climatique, dépassant largement plusieurs pays développés.
Si le Maroc est aujourd’hui leader en matière d’énergies renouvelables, ce n’est pas le fruit du hasard. Ce que peu savent, c’est que les engagements du Maroc ne datent pas de 2009, année du lancement de sa stratégie. Le roi Mohammed VI a, en effet, pu bénéficier d’un terrain balisé pour poursuivre une dynamique enclenchée déjà par son père, feu Hassan II. Le défunt monarque avait, durant les années 1980, posé les jalons d’une métamorphose de la carte énergétique du pays.
Lancement d’un centre des énergies renouvelables en 1982
«Si le Maroc figure aujourd’hui parmi les leaders mondiaux en matière d’énergies renouvelables, il faut savoir qu’il était parmi les pionniers dans ce domaine. L’épopée du Maroc dans ce domaine est faite de plusieurs grandes dates et de phases historiques importantes. Le défunt roi Hassan II avait créé le 6 mai 1982 un centre de développement des énergies renouvelables à Marrakech. Un centre pionnier au niveau mondial à cette époque», se rappelle pour Arab News en français Abdelali Dakkina, ancien directeur du pôle stratégie et développement à l’Agence marocaine pour l’efficacité énergétique (AMEE) et ex-membre de la délégation marocaine chargée des négociations climatiques au niveau des COP.
Le début des années 80 du siècle dernier a été marqué par des tensions régionales énergétiques dues aux deux chocs pétroliers de 1973 et 1979. Plusieurs pays ont lancé des réflexions pour ne plus dépendre énergétiquement de l’extérieur, l’objectif étant de trouver des solutions alternatives aux énergies fossiles – ce à quoi s’est attelé le Centre de Marrakech. Les experts de l’époque ont défini quatre énergies renouvelables où le Maroc dispose d’un potentiel avéré: l’éolien, le solaire, la biomasse et l’hydraulique. Plusieurs projets pilotes ont ainsi été lancés dans plusieurs régions du pays, en fonction de leur particularité géographique.
Le premier village «vert» en Afrique
«Nous avons réalisé plusieurs projets de démonstration. Nous avions déjà une expérience grâce au programme des barrages durant les années 1960. On s’est intéressé en priorité au solaire dans ses deux composantes, le thermique et l’électrique», se remémore Abdelali Dakkina. Le premier village électrifié grâce à la technologie photovoltaïque a ainsi vu le jour en 1985 à Douar Dbibzat à El-Kelaa des Srarhna, près de Marrakech. Il s’agit du premier village africain électrifié en énergies renouvelables. Cette même année, le Maroc a éclairé plusieurs de ses rues, administrations, mosquées, écoles et villages grâce au photovoltaïque. Ce fut le début de l’implémentation de la vision voulue par Hassan II. En parallèle, les équipes du Centre de développement des énergies renouvelables de Marrakech ont lancé plusieurs projets pilotes de biomasse au sein de quelques fermes marocaines.
Des dizaines de digesteurs y sont installés pour la valorisation de la biomasse en produisant du méthane, un gaz à pouvoir calorifique important. La formule prend, puisqu’à la fin des années 1980, 500 digesteurs sont installés partout au Maroc et des coopératives adoptent cette alternative énergétique que ce soit pour l’agriculture ou leurs besoins quotidiens. Une source viable intéressante voit ainsi le jour dans le monde rural. D’ailleurs, le principal défi de feu Hassan II était d’électrifier le monde rural rapidement et de manière efficiente. En 1995, il lance le Programme d'électrification rurale global (PERG) qui a connu une réussite notamment grâce à son mode de financement participatif innovant et l’emploi des énergies renouvelables.
Le défi de l’électrification du monde rural
«Depuis l’indépendance du Maroc, plusieurs programmes ont été lancés pour électrifier 41 000 villages au niveau national. On atteignait un objectif de 70 villages par an. C’était très lent. Grâce au PERG, nous avons réalisé un sursaut remarquable, nous sommes passés à 1 000 villages annuellement. Ce programme était suivi de près par Hassan II. C’était le branle-bas au niveau du centre de Marrakech, de l’Office national de l’électricité et tous les services concernés», nous confie Abdelali Dakkina. Et d’ajouter: «En cinq ans, nous avons acquis une certaine expertise terrain et technique. Nous avons installé, selon les spécificités géographiques, des centrales hydrauliques, des groupes électrogènes, des extensions du réseau électrique, des digesteurs… Toutes les solutions étaient déployées, en particulier celles exploitant les énergies renouvelables.»
Le Maroc, notamment le monde rural, s’est véritablement métamorphosé en peu de temps et le rythme s’est nettement accéléré en l’espace de cinq ans. En 2000, l’objectif a été carrément multiplié par quatre (4 400 villages électrifiés par an). Résultat: le taux d’électrification du monde rural est passé de 16% en 1995 à 80% en 2010. Une prouesse.
Le Programme d'électrification rurale global a été ainsi le catalyseur de la stratégie marocaine des énergies renouvelables, en posant les jalons de cette stratégie et en acquérant une certaine expertise pour mener à bien les grands chantiers énergétiques. C’est dans ce sens qu’en 1999 le premier parc éolien en production concessionnelle voit le jour au Maroc. Situé dans la commune de Tleta Taghramt, près de la ville de Tétouan au nord du Maroc, le parc éolien Abdelkhalek Torrès dispose d’une puissance installée de 50 MW et a nécessité 510 millions de dirhams (1 dirham marocain = 0,096 euro) d’investissements avec des partenaires français.
À noter que le Maroc est réputé mondialement pour son climat très propice pour l’installation de parcs éoliens, grâce à des sites ventés toute l’année et de vents jouissant d’une bonne vitesse, notamment au niveau de la région du Nord, des couloirs de Taza et de Midelt. Le nombre d’heures de fonctionnement d’une centrale éolienne au nord du Royaume est de plus de 4 700, soit 50% plus que les centrales situées en mer du Nord comme en Norvège, au Danemark ou en Allemagne.
Que ce soit pour l’éolien, le solaire ou l’hydraulique, le Maroc dispose d’énormes acquis depuis le siècle dernier. Rien que pour l’hydraulique, feu Hassan II a initié depuis les années 1960 la politique visionnaire des barrages, l’une des réalisations phares de l’ère de ce monarque réputé être le bâtisseur du Maroc moderne. Aujourd’hui, le Maroc, pays agricole de premier plan, dispose de près de 150 barrages, ce qui lui permet de limiter l’impact de son stress hydrique.
8% des besoins en électricité de la Grande-Bretagne
Le règne de son fils, le roi Mohammed VI, s’inscrit dans la continuité de cette vision axée sur le développement durable et inclusif pour le bien de la population marocaine et des générations futures. Mohammed VI a, en revanche, appuyé sur l’accélérateur en adoptant une stratégie des énergies renouvelables très ambitieuse, ayant notamment pour objectif la réduction de la dépendance énergétique de l’extérieur et en se positionnant comme futur exportateur d’énergie propre. Le pays sera d’ailleurs le récipiendaire d’un projet gigantesque initié par le Britannique Xlinks. Ce dernier investira dans une centrale électrique, solaire et éolienne, de 10,5 GW dans la région de Guelmim-Oued Noun, au sud du Maroc, et qui devra alimenter le Royaume-Uni en énergie propre à travers un câble sous-marin de 3 800 km de long. Le projet, dont la construction débutera en 2025, alimentera 7 millions de foyers britanniques en énergie d'ici à 2030, soit 8% des besoins en électricité de la Grande-Bretagne. Le Maroc a mobilisé le foncier nécessaire à ce projet, soit 1 500 km2 carrés, l’équivalent de plus de 210 000 terrains de football.
«Le bilan à mi-parcours de la stratégie des énergies renouvelables est très satisfaisant. Grâce au projet de Xlinks, le Maroc va dépasser largement ses objectifs de 52% d’énergies renouvelables dans le mix énergétique en 2030. On va atteindre facilement les 60%. C’est énorme et c’est très réalisable», estime Abdelali Dakkina, à condition, selon lui, de sécuriser les financements des projets prévus et d’assurer une intégration industrielle locale, une territorialisation de l’expertise et un renforcement des capacités.
Maigre consolation pour le régime algérien
En attendant, le Maroc peut s’enorgueillir de l’efficacité de ses choix stratégiques. Début novembre 2021, alors que certains pseudo-analystes algériens s’attendaient à un impact important sur le Maroc suite à l’arrêt du gazoduc Maghreb-Europe, aucune coupure d’électricité majeure n’a été enregistrée. Maigre consolation pour les généraux algériens. «Le Maroc a été préparé à ce genre d’événements. Depuis la coupure de l’approvisionnement du gaz algérien, le Maroc n’a pas enregistré de problèmes et de coupures d’électricité. Le gaz naturel ne compte en effet que pour 10% dans le mix énergétique du Maroc, soit la moitié de la part des énergies renouvelables», précise Abdelali Dakkina. À bon entendeur!