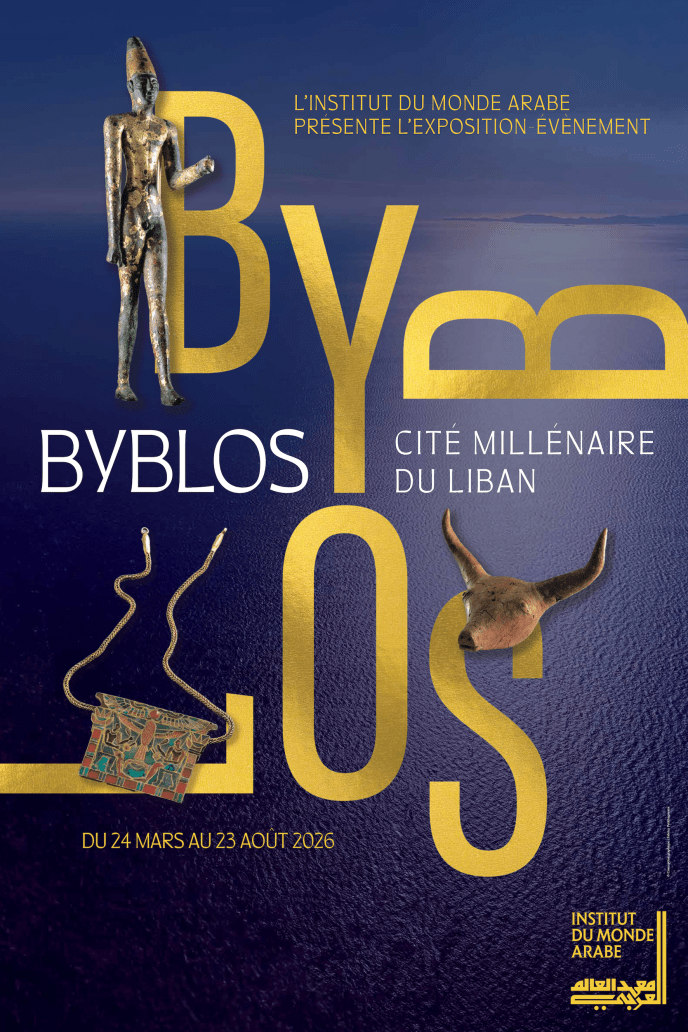PARIS: La Menart Fair reprend ses quartiers dans l’hôtel particulier de la maison Cornette de Saint-Cyr pour une deuxième édition, du 19 au 22 mai. Mercredi en fin d’après-midi, à la veille de l’ouverture au public, on a accroché les dernières toiles aux murs, vérifié l’horizontalité des cimaises, collé les étiquettes sous les œuvres.
La foire internationale d’art moderne et contemporain dédiée aux artistes du Moyen-Orient et de l’Afrique du Nord propose cette fois-ci au public, professionnels avertis ou amateurs éclairés quelque deux cent cinquante œuvres de quatre-vingt-dix-huit artistes représentés par dix-huit galeries venant de douze pays, avec un accent particulier mis sur la modernité.
«Comment comprendre le contemporain si on ne retourne pas aux sources de la modernité avec toutes les influences qui traversent les artistes du monde arabe», interroge Laure d’Hauteville, la directrice de la foire, à Arab News en français. «Nous avons demandé à chaque galerie de nous exposer un, deux ou trois artistes de la modernité du pays d'où elles viennent.»
Cette modernité sera aussi mise à l’honneur à travers une exposition spécifique consacrée à l’école de Casablanca. En 1962, l’artiste Farid Belkahia (1934-2014) est nommé directeur de l’École des beaux-arts de Casablanca. Avec un groupe d’artistes et d’enseignants, Mohammed Melehi (1936-2020), Mohammed Chabâa (1935-2013) et Mohammed Hamidi (1941), il cherche à restructurer les bases pédagogiques de l’enseignement artistique. Ensemble, ils réinvestissent le patrimoine artistique populaire et classique du Maroc, en introduisant les pratiques artisanales traditionnelles au sein de l’établissement, avec l’utilisation de matériaux comme le cuir, le métal, les pigments naturels, et le retour à l’attraction géométrique et aux signes et symboles berbères, arabo-musulmans et africains.
Mouvement à la recherche d’une modernité artistique et culturelle propre au Maroc, l’école de Casablanca défie l’institution et l’Histoire de l’art eurocentrée. «C’est la première fois qu’à Paris seront exposés ces six artistes de la modernité marocaine. Ce sont des œuvres absolument extraordinaires, choisies par la commissaire Fadia Antar.»
Autre nouveauté cette année, un espace consacré à l’univers NFT de la région du Moyen-Orient et de l’Afrique du Nord (Mena) avec une vingtaine d’œuvres, de la vidéo, du numérique, de la réalité virtuelle. Brian Beccafico, collectionneur et commissaire de l’espace, propose ainsi une expérience immersive grâce à une scénographie dynamique et pluridisciplinaire. «Menart Fair est également une foire à la pointe de la technologie», précise ainsi sa directrice. «Nombre d'artistes vivent dans des pays en conflit où ils ne peuvent pas s'exprimer librement. Mais grâce aux NFT, qui est une forme de passeport pour les artistes, ils peuvent s'exprimer librement sans subir des pressions des pays dans lesquels ils vivent.»
Cette année, de nouvelles galeries participent à l’événement. La toute jeune galerie Salahin (Paris) expose ainsi des peintures éclatantes et riches en symboles de la photographe libanaise Ayla Hibri, alors que la galerie Bessière (Chatou) revient avec des photographies aux lignes claires et nettes de Serge Najjar et des peintures abstraites de Hala Schoukair, fille de la grande peintre Saloua Raouda Schoukair qui a fait son «coming out artistique» à 65 ans. L’art libanais est d’ailleurs à l’honneur avec trente-cinq artistes originaires du pays du Cèdre, représentés par sept galeries.
L’artiste algérienne Baya Mahieddine est, quant à elle, représentée par trois galeries, la galerie Ayn (France), la galerie El-Marsa (Tunisie-Émirats arabes unis), et la galerie Le Violon bleu (Tunisie). «Découverte en 1947 par André Breton, Baya, passée par l’atelier de Picasso, est vraiment une sommité», explique Laure d’Hauteville, passionnée d’art de la région Mena et fondatrice notamment de la Beirut Art Fair en 2010.
Menart Fair apporte ainsi un condensé de la scène artistique des pays de la région Mena dans la capitale des arts. «Menart apporte quelque chose d'important en France, car dans l’Hexagone, vous avez des foires dédiées à l'Asie ou à l'Afrique, mais rien sur le Moyen-Orient», remarque-t-elle. «D'ailleurs, quand on parle du Moyen-Orient, généralement, c'est souvent en rapport avec les conflits. Mais le public s'est-il déjà intéressé à la vie artistique de ces pays-là, au foisonnement et aux découvertes incroyables à faire? Il y a de plus en plus d'institutions qui viennent à Menart Fair et qui s'interrogent et regardent de très près l'art de ces régions.»
Foire confidentielle née de la rencontre entre Laure d’Hauteville et Joanna Chevalier pendant le confinement de mars 2020, Menart Fair commence d’ailleurs à s’exporter puisqu’une nouvelle édition est prévue à Bruxelles en janvier 2023, à la Villa Empain de la fondation Boghossian.