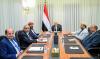RIYAD: Si la géographie est le destin, alors tous les petits pays ayant des voisins beaucoup plus grands doivent nécessairement apprendre à tirer parti des avantages tout en gérant les défis avec tact et finesse.
Peu de pays se rapprochent de Djibouti, un minuscule pays africain coincé entre l'Érythrée, l'Éthiopie et la Somalie, quant à la réussite de cet exploit.
L’emplacement de Djibouti, sur le détroit de Bab al-Mandab et à l'intersection de la mer Rouge et du golfe d'Aden, s'est avérée bénéfique à bien des égards. Ses ports constituent la principale porte d'entrée pour le commerce de l'Éthiopie, pays enclavé, et assurent 95% des échanges commerciaux du pays. En tant que porte d'entrée du canal de Suez, l'une des routes maritimes les plus fréquentées au monde, les ports de Djibouti assurent également des transbordements entre l'Europe, le Moyen-Orient et l'Asie.
La stabilité politique relative et l'emplacement stratégique ont également fait de Djibouti un site idéal pour les bases militaires étrangères, ce qui a assuré un flux constant de recettes publiques et d'aide étrangère. Le gouvernement entretient des liens de longue date avec la France, qui maintient une présence militaire dans le pays, ainsi qu'avec les États-Unis, le Japon, l'Italie, l'Allemagne, l'Espagne et la Chine.
L'islam radical, qui a fait des ravages en Somalie, pays voisin, et dans d'autres pays d'Afrique, n'a pas réussi à s'implanter à Djibouti, pays majoritairement musulman où l'on trouve quelques autres confessions.
Lors d'une visite en mars, Ferid Belhaj, vice-président de la Banque mondiale pour le Moyen-Orient et l'Afrique du Nord, a réaffirmé l'engagement de la banque envers le «redressement résilient et inclusif de Djibouti après la Covid-19 et ses efforts afin d’accélérer des investissements plus nombreux et meilleurs dans les personnes».

Selon le rapport «Perspectives économiques de Djibouti» effectué par le Groupe de la Banque africaine de développement, l'économie a commencé à se redresser en 2021 avec une croissance du produit intérieur brut de 3,9%, contre 1,2% en 2020. Cette reprise a été soutenue par un secteur redynamisé des services, qui génère environ trois quarts du PIB, en particulier les activités portuaires.
Le rapport du groupe a indiqué: «Les perspectives sont positives. La croissance moyenne du PIB entre 2022 et 23 devrait atteindre 4,3% et rester soutenue par les activités portuaires et les investissements.»
Au cours des dernières décennies, Djibouti a beaucoup investi dans la construction de nouveaux ports et la modernisation des infrastructures existantes. Des travaux sont en cours sur de nouvelles installations, notamment un terminal de gaz naturel liquéfié, une zone d'activité, des chantiers de réparation navale, un terminal de pétrole brut, un aéroport international et des lignes ferroviaires reliant Tadjourah, Mekele et la capitale Addis-Abeba au port de Djibouti.
Chaque jour, quelque 2 500 navires transitent par le port ou y font escale, avec l'espoir de faire de Djibouti la plaque tournante du commerce maritime mondial. Pas plus tard que mardi, un navire affrété par les Nations unies et chargé de milliers de tonnes de blé ukrainien est arrivé à Djibouti, à destination de certaines des 22 millions de personnes menacées de famine dans la Corne de l'Afrique.
Le tourisme est également l'un des secteurs économiques en pleine croissance de Djibouti. C'est une industrie qui génère entre 53 000 et 73 000 arrivées par an. Outre les sites historiques, un parc national, des plages et des chaînes de montagnes, les attractions du pays comprennent des sites d'art rupestre à Abourma, des îles et des plages dans le golfe de Tadjoura et, la plongée sous-marine, la pêche, le trekking et la randonnée, à Bab al-Mandab.

Le droit à la propriété est respecté à Djibouti et le gouvernement a réorganisé les syndicats. On estime à 15 000 le nombre d'étrangers résidant dans le pays.
La population indigène est divisée entre la majorité des Somaliens (principalement de la tribu Issa, avec une représentation minoritaire d'Isaaq et de Gadabuursi) et les Afars (également connus sous le nom de Danakils).
Djibouti est un pays membre de l'Organisation de la coopération islamique et de la Ligue arabe. Il soutient fermement les efforts de médiation dans la guerre en Éthiopie et encourage la vaccination contre la Covid-19.
L'histoire de Djibouti, inscrite dans la poésie et les chants de ses peuples nomades, remonte à des milliers d'années, à une époque où les Djiboutiens échangeaient des peaux d’animaux contre les parfums et les épices de l'Égypte ancienne, de l'Inde et de la Chine. Grâce à des contacts étroits avec la péninsule arabique pendant plus de mille ans, les tribus somaliennes et afar de la région ont été les premières du continent africain à adopter l'islam.
L'exploration de Shoa par le négociant et diplomate Rochet d'Hericourt (1839 à 1842) a marqué le début de l'intérêt français pour les rives africaines de la mer Rouge, intérêt qui s'est accru au fur et à mesure de l'augmentation de l'activité britannique en Égypte et de l'ouverture du canal de Suez en 1869. En 1884 et 1885, la France étend son protectorat aux rives du golfe de Tadjoura et au Somaliland.

La capitale administrative a été déplacée d'Obock à Djibouti en 1896. Djibouti a attiré des caravanes commerciales traversant l'Afrique de l'Est, ainsi que des colons somaliens venus du sud. Le chemin de fer franco-éthiopien, qui relie Djibouti au cœur de l'Éthiopie, est mis en service en 1897 et atteint Addis-Abeba en juin 1917, facilitant encore l’augmentation des échanges.
En 1957, la colonie a été réorganisée par le gouvernement français pour donner à la population une autonomie considérable. L'année suivante, lors d'un référendum constitutionnel, le Somaliland français a choisi de rejoindre la communauté française en tant que territoire d'outre-mer.
En mars 1967, lors d'un référendum organisé par le gouvernement français, 60% des électeurs ont choisi de maintenir l'association du territoire avec la France. En juillet de la même année, une directive de Paris a officiellement changé le nom de la région en Territoire français des Afars et des Issas.
Les Djiboutiens ont voté pour l'indépendance lors d'un référendum en mai 1977, et la République de Djibouti a été créée le 27 juin 1977. Hassan Gouled Aptidon est devenu le premier président du pays et a été réélu plusieurs fois jusqu'en 1999, date à laquelle Ismail Omar Guelleh est devenu le nouveau président.
Ce texte est la traduction d’un article paru sur Arabnews.com