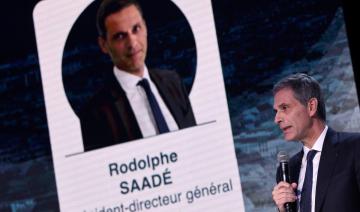PARIS : C’est une menace quasi-invisible mais pourtant bien réelle: les espèces exotiques envahissantes (EEE) sont au cœur du prochain rapport de l'IPBES, l’équivalent du Giec pour la biodiversité, qui sera publié lundi pour alerter sur le phénomène et réfléchir sur les moyens d’y faire face.
Très adaptables, ces animaux ou ces plantes, introduits volontairement ou non par l’homme, prolifèrent, supplantent ou chassent les espèces indigènes, allant jusqu’à en faire disparaître certaines et provoquant des impacts multiples, souvent insoupçonnés avant qu’il ne soit trop tard.
Son nouveau rapport, préparé par 86 experts internationaux originaires de 49 pays, s'appuie sur plus de 13.000 études de références, synthétisés pendant quatre ans, pour un coût total de plus de 1,5 million de dollars.
Il sort quelques mois après l'accord de Kunming-Montréal, où la communauté internationale s'est fixée comme objectif de réduire de 50% le taux d'introduction d'espèces exotiques envahissantes d’ici 2030.
«Le phénomène est encore peu connu et jusqu’à récemment, à part chez quelques scientifiques, suscitait peu d'attention. Mais c'est pourtant un problème majeur aussi bien sur le plan écologique que sanitaire ou même économique», souligne Christophe Diagne, chercheur à l'Institut de recherche pour le développement (IRD) de Montpellier.
Espèces invasives: quand l'Australie se débat avec le coup du lapin
Avec ses grandes oreilles et sa fourrure duveteuse, le lapin est souvent perçu comme mignon et inoffensif. Il est pourtant responsable de l'une des pires invasions biologiques mondiales, ravageant l'Australie qui a tenté par tous les moyens de l'éradiquer mais n'a souvent fait qu'empirer le problème.
En 1859, ils n'étaient pourtant que 24 Oryctolagus cuniculus, plus communément désignés comme lapins de garenne, à débarquer sur les côtes australiennes en provenance d'Angleterre, pour le bon plaisir du Britannique Thomas Austin, nostalgique de ses parties de chasse.
Mais plus de 150 ans plus tard, ils sont, selon une étude parue en 2022 dans PNAS, environ 200 millions à pulluler au pays des kangourous, dévorant la végétation, détruisant les cultures et menaçant la survie de plusieurs espèces.
Avec jusqu'à sept portées annuelles, de 5 lapereaux en moyenne chacune, et une maturité sexuelle dès l'âge de 3-4 mois, le lapin a la faculté de s'étendre rapidement.
Dès ses premières années aux antipodes, en l'absence de prédateurs naturels et grâce à sa rapide adaptation au climat, le léporidé ne s'en est pas privé.
Étendant son territoire de 110 km par an, il se répand en 70 ans sur 70% de la masse terrestre de l'Australie, "ce qui constitue l'invasion la plus rapide connue par un mammifère dans le monde entier", relate un rapport de l'organisme gouvernemental australien pour la recherche scientifique (CSIRO).
200 millions de dégâts annuels
Le problème est que le petit mammifère à l'air placide est du genre vorace. Herbes, bulbes, graines, arbustes, aucun herbacé ne résiste à son appétit. Résultat: il contribue à la désertification de l'outback, prive de nourritures d'autres espèces et grignote les cultures.
Les dommages agricoles et horticoles causés par les lapins sont estimés à environ 200 millions de dollars australiens chaque année, selon le ministère de l'Agriculture d'Australie occidentale.
Alors depuis plus d'un siècle, le gouvernement tente par tous les moyens de régler le problème.
Chasse intensive, pièges, bulldozers pour détruire les terriers, poison ou même explosifs: rien n'y fait, la progression du lapin résiste à tout.
En 1901, l'Australie décide de construire une barrière de 1.800 km de long dans l'espoir de freiner l’irrésistible progression de la bestiole vers les terres agricoles de l'ouest.
Mais le temps que la construction soit achevée, le garenne est déjà de l'autre côté. S'ensuit une extension, puis une autre. Au total plus de 3.000 km de pieux et de grillages. En vain.
L'Australie passe alors au plan B: l'introduction de prédateurs, comme le renard.
Mais le remède s'avère pire que le mal. Le goupil préfère s'attaquer à des proies plus faciles, comme les petits marsupiaux endémiques de l'île, déjà menacés d'extinction.
«cas d'école»
Dans les années 50, la science est appelée à la rescousse. Le virus de la myxomatose, une maladie provoquant des tumeurs mortelles chez les lapins, est introduit dans le pays.
Dans un premier temps, le succès semble au rendez-vous, la population de lapins passe de 600 à 100 millions. Mais le léporidé s'adapte et finit par développer une résistance au virus, peu à peu inopérant.
Nouvel angle d'attaque quelques années plus tard: la puce espagnole, censée propager des maladies parmi les lapins. Mais là encore, c'est un échec. Pire, le parasite infecte d'autres espèces.
En 1995, une nouvelle tentative d'éradication, via un virus de fièvre hémorragique, finit par inquiéter la communauté scientifique, craignant qu'il ne mute.
Très efficace sur les lapins, ce pathogène hautement contagieux peut en outre se propager rapidement à d'autres pays via les moustiques. Il arrive d'ailleurs deux ans plus tard en Nouvelle-Zélande, elle aussi aux prises avec une invasion lapine.
Un mal pour un bien? Pas vraiment. Privé d'une partie des lapins, son prédateur principal, l'hermine, elle aussi importée, se rabat sur le kiwi, oiseau endémique de l'île qui se trouve à son tour menacé.
L'Australie comme la Nouvelle-Zélande représentent "des cas d'école" de ce qu'il ne faut pas faire en matière d'introduction et de gestion des espèces invasives, souligne Elaine Murphy, scientifique au département de conservation néo-zélandais.
Si la propagation du léporidé semble aujourd'hui stabilisée sous les 300 millions, le gouvernement australien indique "continuer les recherches" pour endiguer durablement le problème.
Des extinctions et des milliards
En s'installant durablement sur de nouveaux territoires, ces espèces «vont changer l'environnement local, avec des conséquences qu’on ne mesure pas toujours au début, mais qui peuvent conduire à faire disparaître certaines espèces natives», explique M. Diagne.
Les exemples sont nombreux, du dodo de l’île Maurice, disparu en raison de la prédation d'animaux importés par les colons (rats, chats, chiens), à l’écrevisse américaine, prédateur redoutable dans les cours d'eau français ou l'apparemment inoffensif bourdon européen sur le point d'avoir la peau de son collègue chilien en ramenant un parasite ravageur.
Une étude en 2021 dans Global Change Biology montrait que 14% de la «diversité fonctionnelle» (habitat et masse) des mammifères était menacée par les invasions biologiques et que 27% des oiseaux, particulièrement vulnérables, pourraient disparaître au cours des cinquante prochaines années.
Au niveau financier aussi, les conséquences ne sont pas négligeables: en 2021, une étude dans Nature chiffrait le coût des ravages à au moins 1.288 milliards de dollars depuis 1970.
«C’est énorme! A titre de comparaison, ce montant est supérieur au PIB de la plupart des pays africains réunis», souligne M. Diagne qui a coordonné cette étude. Une autre étude en avril juge le montant des dégâts à peu près similaire aux dommages causés par les tremblements de terre ou les inondations.
Selon Invacost, une base de données coordonnée notamment par le CNRS, ce coût «triple chaque décennie depuis 1970» quand dans «le même temps, les dépenses investies pour éviter ou contrôler ces invasions sont 10 à 100 fois moins importantes».
Selon l'IPBES, «la menace croissante» que représente les espèces exotiques envahissantes «est généralement mal comprise».
Son rapport inédit a pour objectif de «faire autorité» et de «contribuer grandement à combler les lacunes critiques en matière de connaissances, à soutenir les décideurs et à sensibiliser le public», souligne Helen Roy du Centre britannique d'écologie et d'hydrologie, qui copréside la publication.
- Constante évolution -
Peu de recensements officiels existent: la base de données mondiales des espèces invasives (GISD), coordonnée par l'Union internationale pour la conservation de la nature, estime leur nombre à 1.071, rappelle M. Diagne. Mais le changement climatique accélère le déplacement d'espèces.
Les effets néfastes peuvent longtemps rester invisibles et une espèce, considérée un temps comme envahissante, peut ne plus l’être quelques années plus tard car l'environnement s'y sera adapté ou elle aura simplement disparu d'elle-même.
D'où la nécessité de ne pas diaboliser: «il n'y a pas de +bonnes ou de mauvaises espèces+ en soi, c'est le fait qu'elle soit déplacée qui pose problème, pas l'espèce en elle-même», souligne M. Diagne.
En France, des lacs de montagne verdissent, un petit poisson désigné coupable
A 1 800 mètres d'altitude, l'étang d'Areau dans le sud-ouest de la France a pris une étrange couleur verte: comme d'autres lacs pyrénéens à l'eau habituellement cristalline, il est victime d'un dérèglement attribué par certains chercheurs à un petit poisson introduit par les pêcheurs.
"Quand on voit des poissons dans les lacs de montagne, on voit un écosystème qui est perturbé", assure à l'AFP Adeline Loyau, biologiste et ingénieure à l'Institut national polytechnique (INP) de Toulouse (sud-ouest).
Les poissons ont été introduits en montagne par l'être humain il y a plusieurs siècles, probablement autour du Moyen-Âge, d'abord comme source de protéines pour les bergers puis, de façon plus massive, pour approvisionner les hôtels et restaurants des villes thermales.
Adeline Loyau et son mari Dirk Schmeller, professeur spécialiste de l'écologie des montagnes à l'INP, s'intéressent en particulier à l'un d'entre eux: le vairon, une espèce de moins de dix centimètres qui vit normalement dans les rivières fraîches et qui est utilisé comme appât vivant.
Lorsqu'il parvient à s'échapper de l'hameçon ou qu'il est relâché par les pêcheurs, il s'acclimate bien, dévorant amphibiens et insectes, ainsi que le zooplancton, "des petits crustacés microscopiques dont le rôle est de manger les algues et de maintenir l'eau très claire, très pure", explique Adeline Loyau.
Lorsqu'un lac devient vert, "c'est que les algues ont gagné", complète Dirk Schmeller.
«Cocktail de facteurs»
La prolifération des algues n'est toutefois pas uniquement due au vairon et l'impact réel de ce petit poisson sur l'écosystème est au coeur de débats animés entre chercheurs.
Pour Didier Galop, directeur de recherche au Centre national de recherche scientifique (CNRS) spécialiste de l'histoire et de la géographie de l'environnement, "il y a un cocktail de facteurs de perturbation" qui peuvent expliquer le verdissement des lacs, comme la concentration de troupeaux autour de ces points d'eau ou les températures plus élevées liées au réchauffement climatique.
Aux yeux du scientifique, également pêcheur, le verdissement est un phénomène qui reste assez marginal et n'est que l'un des nombreux symptômes de la dégradation de la qualité de l'eau des lacs de montagne. "Il y a aussi des lacs qui sont très bleus, mais qui ont zéro biodiversité", souligne-t-il.
Dirk Schmeller et Adeline Loyau estiment quant à eux que les lacs verts sont de plus en plus fréquents, notamment sur des petites surfaces d'eau.
"On a même des randonneurs qui sont parfois venus il y a trente ans et qui nous le font remarquer", assure la chercheuse.
Sensibiliser les pêcheurs
De l'autre côté des Pyrénées, des lacs verts ont été observés dès 2011 par des chercheurs espagnols, qui ont entamé en 2014 des programmes d'élimination des poissons, à l'aide de filets ou de techniques de pêche électrique.
En 2018, le parc national des Pyrénées, en France, les a imités. Mais il a constaté que des poissons avaient été réintroduits de manière "sauvage" par la suite. Il compte donc sur la sensibilisation des pêcheurs pour trouver un équilibre entre loisirs et préservation de l'environnement.
Sébastien Delmas, président d'une association regroupant les fédérations de pêche des Pyrénées, reconnaît que le vairon pose problème et souhaite "harmoniser les règlementations", différentes d'un département à l'autre, pour limiter la pêche au vif en montagne. Mais il estime que d'autres poissons, comme les truites, y ont parfaitement leur place.
"Les poissons, c'est aussi de la biodiversité: s'ils sont là depuis des siècles c'est qu'ils y sont bien", soutient-il.
Selon lui, il faudrait aussi regarder du côté du tourisme pour comprendre la mauvaise santé des lacs, car la baignade avec de la crème solaire ou des produits anti-moustique ont également un effet sur l'écosystème.
"Sur une journée d'été, il peut y avoir trois ou quatre pêcheurs autour d'un lac, mais 300 baigneurs. Mais on accuse toujours les pêcheurs", regrette-t-il.
Dirk Schmeller, favorable à l'élimination des poissons, estime aussi qu'il faudrait réduire l'utilisation de polluants autour des lacs. "Après, on aura juste le réchauffement climatique à changer...", relève-t-il avec ironie.