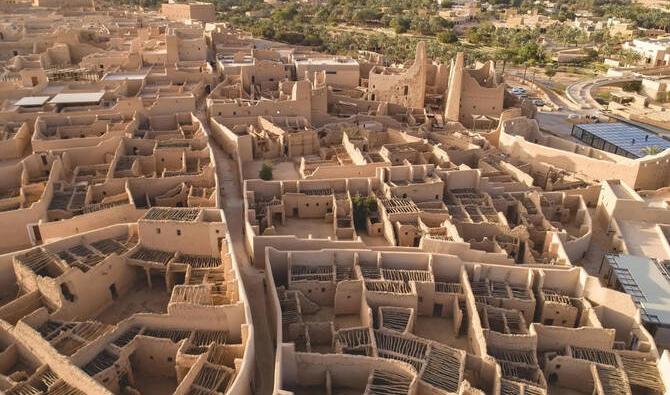ATHENES: La chancelière allemande Angela Merkel a achevé vendredi sa dernière visite officielle à Athènes, en reconnaissant que les Grecs avaient payé un lourd tribut pendant la crise de la dette.
Au terme de ses seize années à la Chancellerie allemande, Angela Merkel a redit qu'elle avait "conscience des contraintes et des défis auxquels les Grecs avaient été confrontés" pendant la cure d'austérité destinée à consolider la stabilité de l'euro.
Mais la chancelière a aussi noté que l'ajustement aurait été moins brutal si la Grèce et un certain nombre d'autres États de l'Union européenne avaient entrepris des réformes clés en période de prospérité.
"L'une des femmes les plus détestées de Grèce", selon le tabloïd allemand Bild, Angela Merkel avait déjà confié en septembre que "le moment le plus difficile de son mandat a été lorsqu'elle avait tellement demandé à la Grèce".
La crise grecque était "une période d'hystérie", selon le journal allemand "Der Spiegel", estimant que "la Grèce a été sauvée, mais pas l'idée européenne".
"Je pense que nous avons tous été très choqués par la fragilité de l'euro face à la spéculation extérieure", a admis Mme Merkel vendredi, au sortir d'une rencontre avec le Premier ministre conservateur grec Kyriakos Mitsotakis.
Pour la chancelière sortante, la relation gréco-allemande "a toujours eu une bonne base" malgré les "moments difficiles".
En 2012, au plus fort de la crise de la dette, la chancelière était accueillie en Grèce par un large rassemblement anti-austérité avec des croix gammées nazies et des caricatures la représentant avec une moustache d'Hitler.
Dès 2010, elle avait réclamé au Premier ministre socialiste d'alors, George Papandréou, des mesures d'austérité pour réduire les déficits publics du pays. Dès lors, elle a été considérée en Grèce comme la "dame de fer" de l'Europe qui demande des efforts inconsidérés aux Grecs.
Avec son ministre des Finances de l'époque, Wolfgang Schäuble, Angela Merkel avait exigé d'Athènes des coupes budgétaires et des hausses d'impôts drastiques en échange de trois plans de sauvetage internationaux de plus de 300 milliards d'euros.
Les retraites ont été diminuées, le salaire minimum réduit à quelque 500 euros, les privatisations lancées à tour de bras, les services publics et notamment les hôpitaux ont subi des coupes claires en effectifs et en équipements.
«Un pays différent»
"La Grèce est un pays différent de celui que vous avez connu lors de la précédente décennie. Ce n'est plus une source de crises et de déficits", a affirmé vendredi M. Mitsotakis, s'adressant à la responsable allemande.
Angela "Merkel était la voix de la raison et de la stabilité à Berlin et à Bruxelles. Parfois injuste, mais décisive aux moments cruciaux", comme en 2015, lorsqu'elle a refusé la sortie de la Grèce de l'Union européenne, a ajouté le Premier ministre.
La présidente grecque Katerina Sakellaropoulou, lors d'une rencontre séparée, a salué l'aide de l'Allemagne pendant la crise migratoire de 2015, lorsque près d'un million de réfugiés avaient débarqué sur les îles grecques, en soulignant que ce moment avait "contribué à la compréhension mutuelle".
Bras de fer avec Tsipras
Avec l'élection du leader de gauche radicale, Alexis Tsipras, en janvier 2015, un véritable bras de fer s'était enclenché.
Le Premier ministre d'alors souhaitait lors de sa campagne électorale "déchirer les mémorandums" et appelait "Merkel à rentrer chez elle". Athènes, menacée d'être exclue de la zone euro, avait fini par céder sous la pression à ses créanciers et s'était résolue à de nouvelles mesures d'austérité.
Dans un article de l'hebdomadaire allemand Die Zeit le mois dernier, Alexis Tsipras a déclaré que "l'honnêteté" avait "renforcé le climat de confiance" entre la chancelière et lui, malgré leurs divergences politiques.
Pendant ses quatre mandats consécutifs, Angela Merkel a côtoyé huit premiers ministres grecs. Elle reste peu appréciée des Grecs. Selon un sondage réalisé dans 16 pays par le Pew Research center, seulement 30% des Grecs disent avoir confiance en elle, contre une moyenne de 77% dans les autres pays.