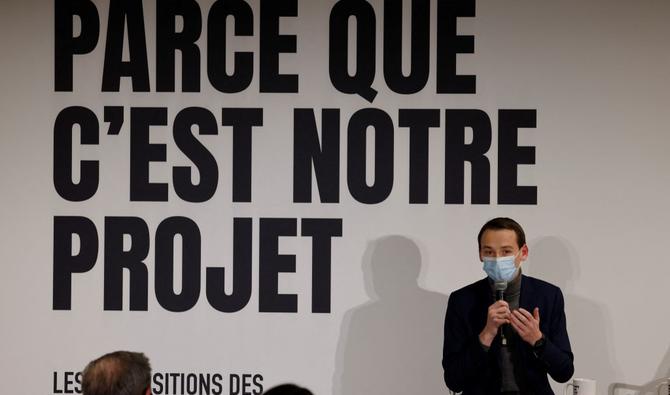PARIS: La montée de l'abstention chez les jeunes, qui risque de se confirmer à la présidentielle en avril, est révélatrice d'un nouveau rapport au vote et à la politique qui ne concerne pas que les moins de 35 ans.
Pour les spécialistes des élections, il y a incontestablement dans les nouvelles générations une proportion croissante d'électeurs intermittents, qui alternent participation ou abstention selon les scrutins.
Ainsi, si l'abstention a atteint des records lors des dernières élections locales, elle a encore été plus élevée chez les jeunes, pas seulement les 18-24 ans, mais aussi les 25-34 ans.
Selon l'Ifop par exemple, à peine 16% des 18-24 ans et 19% des 25-34 ans se sont déplacés lors du premier tour des régionales le 20 juin, à comparer aux 47% des plus de 65 ans (et aux 33% des Français en moyenne).
Mais, à rebours d'une antienne "déplorative", déjà fort ancienne, sur les "jeunes qui se détournent du vote", le politiste Vincent Tiberj préfère mettre l'accent sur une nouvelle "culture politique" qu'il appelle la "citoyenneté distante".
Virtuoses de la participation
Pour ce professeur de Sciences Po Bordeaux, "les générations post-Baby boom et surtout les millenials (qui ont atteint leur majorité en 2000 ou après)", de plus en plus diplômés, de mieux en mieux informés, sont aussi "de plus en plus distants à l'endroit du système représentatif et du vote".
Mais ce sont aussi "des virtuoses de la participation parce que certes ils ne vont pas forcément toujours voter, mais ils vont participer de plein d'autres manières, par la manif, la pétition, les réseaux sociaux, par l'action locale", comme on a pu le voir avec les mobilisations de jeunes pour le climat, explique-t-il à l'AFP.
Il conteste donc l'idée que l'abstention soit le symptôme d'une "crise de la citoyenneté".
Selon lui, "la citoyenneté, beaucoup parmi ces jeunes générations la pratiquent mais autrement qu'en tant qu'électeurs, qu'en tant que citoyens qui s'en remettent à des élus en leur laissant le soin de diriger pour eux", comme c'était bien davantage le cas pour les générations nées avant la Seconde guerre mondiale.
"Il n'est pas vrai de dire que les jeunes ne portent pas d’intérêt à la vie politique, à la vie de la collectivité, à l'intérêt général", abonde sa collègue Anne Muxel, qui repère elle aussi une "citoyenneté plus réflexive et plus critique, non dénuée d’une tentation protestataire lancinante".
"Malgré le contexte de crises successives, leurs pratiques d’engagement et de bénévolat se sont plutôt renforcées. Mais lorsqu'ils s'engagent, les jeunes le font en dehors des organisations politiques traditionnelles. Ils se mobilisent sur les réseaux sociaux, dans la rue, se montrent créatifs et inventifs", précise à Ouest France cette directrice de recherche du Cevipof.
"L'attitude de défiance à l'égard de la sphère politique, accélérée par la crise du coronavirus, conduit la jeunesse, dans sa majorité, à ne plus compter sur le personnel politique pour préparer son avenir", analyse aussi le sondeur Frédéric Dabi (Ifop) dans son livre La Fracture.
A moins de 25 ans, ils défendent leurs convictions à la présidentielle
Ils sont deux, parmi des dizaines de candidats putatifs à la présidentielle. La jeunesse de Martin Rocca, 22 ans, et d'Anna Agueb-Porterie, arrivée dernière de la Primaire populaire, les distingue alors que nombre de jeunes se désinvestissent du vote.
Martin Rocca a mis ses études entre parenthèses, après une licence d'histoire, parce qu'"aujourd'hui on va un peu dans le mur, aucun gouvernement successif n'a réussi à répondre à la crise climatique", explique-t-il.
Depuis le 10 janvier, il s'est lancé dans un tour de France en caravane pour collecter ses parrainages. "Quand je dors dans un fourgon et que je me lève à 6h du mat', qu’il gèle et que je dois sortir en sac de couchage avant d’aller voir un maire, je me dis que c’est épuisant mais ponctué de bonnes nouvelles", raconte-t-il.
Il défend une unique proposition : la création d'une assemblée constituante pour "rénover la démocratie". Son idée de participer à la présidentielle est née après une discussion avec des militants écologistes d'Extinction Rebellion. "Je voulais prendre le contrepied face aux jeunes qui prônent la désobéissance civile." Pour lui, une telle démarche est vouée à l'échec car elle place "la morale individuelle au-dessus de l'intérêt collectif". "C'est un problème en démocratie alors qu'on a des outils légaux", estime-t-il.
Martin Rocca veut défendre ses idées et gagner en visibilité, et juge que la période électorale y est favorable. "Pour porter l'idée d'une assemblée constituante, il existe des associations depuis longtemps, mais on n'en entend pas parler alors que la candidature d'un jeune de 22 ans ça fait du bruit", veut-il croire.
Anna Agueb-Porterie, engagée dans plusieurs associations, était candidate à la Primaire populaire, qui a vu triompher Christiane Taubira. Elle s'est depuis ralliée à Jean-Luc Mélenchon.
"Je soutiens depuis le début la convergence entre le programme l'Avenir en commun et le socle commun de la Primaire populaire", se justifie-t-elle.
Originaire des Pyrénées-Atlantiques, celle qui défend un "discours d'écologie populaire" indique maintenant vouloir "prendre ses distances" avec le monde politique "institutionnel" dont le fonctionnement l'a, dit-elle, laissée amère.
"Cela a été une sacrée expérience, j'ai pu rencontrer du monde. Je continuerai à promouvoir le programme de l'Avenir en commun mais à mon échelle" dans la politique sociale, déclare la militante de l'association Alliance citoyenne. Elle n'exclut pas de réinvestir la politique mais n'a pas "d'objectifs carriéristes".
L'abstention des 18-24 ans a atteint 29% au premier tour de l'élection présidentielle de 2017, soit sept points de plus que la moyenne tous âges confondus.
En dehors des radars
Attention cependant aux généralisations hâtives, avertit Vincent Tiberj car "il faut penser les jeunesses au pluriel".
A un bout du spectre, on a "ceux qu'on met en avant dans les partis politiques, qui se mobilisent dans les meetings", mais ils "sont une infime minorité, pas forcément représentatifs de leur génération", analyse-t-il.
Mais à l'autre bout, il y a ceux qu'il appelle les "ni en études ni en emploi ni en politique" qui se tiennent encore plus à distance de la politique et "sont en dehors des radars à la fois de l'offre politique et du système médiatique".
Car là réside le principal risque politique d'un vote moins régulier, notamment pour la prochaine présidentielle. "Dans la sphère électorale, si tu ne te déplaces pas parce que tu n'es pas content, il y en a d'autres qui le font à ta place et ça aboutit à des déformations en termes d'équilibre politique", résume-t-il.
"Les plus de 65 ans ont pesé dans les urnes 1,4 fois leur poids dans la population tandis que les moins de 35 ans ont pesé moins de 50% de leur poids démographique réel", a ainsi calculé Vincent Tiberj pour les régionales, pointant un "biais générationnel" qui n'est pas sans conséquence sur les politiques publiques.
Voter à 16 ans ? Pas la priorité des jeunes selon des sondages
Abaisser l'âge du droit de vote à 16 ans serait-il un bon moyen d'intéresser la jeunesse à la vie politique ? Le sujet divise les candidats à la présidentielle, mais suscite aussi d'importantes réserves chez les jeunes, de plus en plus éloignés de la politique traditionnelle, selon des sondages.
Pourquoi proposer le vote à 16 ans ?
A gauche, Anne Hidalgo (PS), l'écologiste Yannick Jadot et l'insoumis Jean-Luc Mélenchon soutiennent le droit de vote à 16 ans.
Elargir le corps électoral permettrait une sensibilisation plus précoce des jeunes aux enjeux politiques. "Un certain nombre d'études ont montré - notamment aux Etats-Unis - que l'abaissement de l'âge électoral rendrait possible un accompagnement des premières expériences électorales", indique Céline Braconnier, directrice de Sciences Po Saint-Germain-en-Laye.
Les défenseurs de la mesure en font un des outils pour répondre à l'abstention massive de la jeunesse (82% des moins de 35 ans inscrits n'ont pas voté aux dernières régionales et départementales).
Ils soulignent que 16 ans est un âge d'émancipation à partir duquel on peut déjà travailler, payer des impôts, s'immatriculer à la Sécurité sociale, être pompier volontaire, obtenir un permis de chasse...
En France, 1,5 million de jeunes de 16 et 17 ans seraient concernés.
Quelles sont les critiques ?
Droite et extrême droite sont défavorables à la mesure, débattue et rejetée au mois de décembre au Sénat.
Contre cette proposition de loi socialiste, la sénatrice LR Nadine Bellurot avait évoqué l'importance du "recul" et d'une "certaine maturité" pour voter. Elle considère aussi sur le plan juridique qu'il n'est pas possible de dissocier majorité électorale et majorité civile (18 ans).
Se poserait aussi la question de pouvoir voter à 16 ans, sans avoir le droit de se présenter aux élections (18 ans).
Au gouvernement, des nuances sont apparues. Le secrétaire d'Etat Clément Beaune s'était dit "plutôt favorable" au vote à 16 ans.
Devant les sénateurs, la secrétaire d'Etat Sarah El Haïry chargée de la jeunesse et de l'engagement, estimait pour sa part en décembre que "les conditions ne semblent pas réunies".
A ses yeux, "le cœur de la bataille, c'est l'abstention" et la crainte "qu'une partie des jeunes n'aient perdu confiance dans la capacité transformatrice du vote". Elle plaide plutôt pour "un parcours de citoyenneté" avec la "généralisation du service national universel".
Qu'en pensent les jeunes ?
Des organisations étudiantes et lycéennes comme l'Unef et l'Union nationale lycéenne sont pour le vote à 16 ans.
Dans les enquêtes d'opinion, les jeunes interrogés sont toutefois largement défavorables à la mesure.
L'ouverture du droit de vote à 16 est la proposition qui recueillait le plus d'avis défavorables – plus de 72 % - en 2017 lors d'une enquête de l'Institut national de la jeunesse et l'éducation populaire (Injep) et du Centre de recherche pour l'étude et l'observation des conditions de vie (Crédoc).
En octobre 2021, les députés écologistes Paula Forteza et Matthieu Orphelin, qui plaident pour le vote dès 16 ans, avaient été surpris en présentant une série d'entretiens et de questions auprès de 500 jeunes. Seuls 8% faisaient du vote à 16 ans un levier pour inciter au vote.
Selon Paula Forteza, ces résultats illustrent une "forme d'auto-censure" et l'importance de "l'accompagnement", mais "plus on vote tôt, plus on s'habitue à voter".
Le sondeur Frédéric Dabi (Ifop), qui vient de consacrer un ouvrage à la jeunesse ("La Fracture", éd. Les Arènes), estime que "le vote à 16 ans est une proposition +totem+ pour les candidats. Mais l'abstention n'est pas une question d'âge mais de questionnement sur l'utilité du vote et l'inadéquation de l'offre électorale".
"Les jeunes pensent que les politiques ne transforment plus la vie sur les questions qui les préoccupent comme le climat ou les discriminations", ajoute-t-il.
Qu'en est-il ailleurs en Europe ?
Une poignée d'Etats européens ont déjà franchi le pas de l'abaissement de l'âge du vote, suivant des modalités différentes. C'est le cas en Autriche depuis 2007, à Malte depuis 2018 mais aussi pour certains scrutins locaux en Allemagne, avec des différences selon les régions. En Grèce, il est possible de voter dès l'âge de 17 ans.