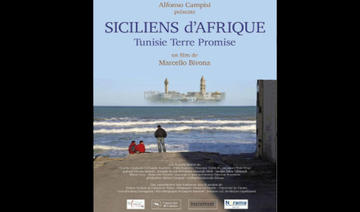PARIS: Organisé par l'Association France-Algérie (AFA), le prix Bouamari-Vautier, qui porte le nom de deux pères fondateurs du cinéma algérien, a pour vocation de mettre en lumière les nouveaux talents de la scène cinématographique et de rapprocher les deux peuples.
À l’occasion de sa 5e édition, une dizaine de films algériens étaient en lice. Une récompense vient couronner une première fiction ou un premier documentaire réalisé par de jeunes cinéastes algériens et franco-algériens.
Fondée en 1963 à l'initiative de l'ethnologue Germaine Tillion et de nombreuses personnalités – journalistes et hommes de lettres –, l'Association France-Algérie œuvre à renforcer la connaissance réciproque des sociétés civiles française et algérienne à travers de nombreux projets dans différents domaines. Pour Arnaud Montebourg, son président, elle vise à maintenir les liens d’amitié et de fraternité entre la France et l’Algérie. «AFA assure la promotion de divers projets, qu’ils soient sociétaux, culturels, économiques ou humains, dans une démarche citoyenne », souligne-t-il lors de la cérémonie de remise des prix.
Récemment récompensé par le prix spécial du jury lors du 41e Festival international du film d’Amiens (Fifam), La Vie d’après, réalisé par Anis Djaad, a remporté le prix Bouamari-Vautier de la meilleure fiction.

Ce long métrage qui rencontre, depuis sa sortie, un succès retentissant est coproduit par le Centre national algérien de développement du cinéma (CADC), le Centre national du cinéma et de l’image animée (CNC, France), l’Institut français et la région Île-de-France. La Vie d’après raconte l’histoire de Hadjer, une veuve, interprétée par Lydia Larini, et de son fils de 16 ans, Djamil, incarné par Ahmed Belmoumane.
Les autres films de la sélection
Dans la catégorie « Fiction »: Cigare au miel de Karim Aïnouz, Ibrahim de Samir Guesmi, Voyage en Kabylie, coréalisé par Hace Mess et Mathieu Tuffreau, et Argu d’Omar Belkacemi.
Dans la catégorie « Documentaire »: Leur Algérie de Lina Soualem et Les Visages de la victoire de Lyèce Boukhitine.
Hadjer est une mère de famille qui fait face à l’adversité, aux préjugés et aux violences faites aux femmes dans l’Algérie profonde. Dans un village de l’Ouest algérien, elle vit avec son fils dans des conditions modestes – un logis avec des murs décrépis et des meubles rudimentaires. Ces deux personnages travaillent pour subvenir à leurs besoins, Djamil dans les champs et Hadjer comme femme de ménage à la mairie du village. Ils mènent une vie tranquille. Mais une rumeur sur les mœurs supposées légères de Hadjer va provoquer une déferlante de haine et un enchaînement d’agressions qui poussent les deux protagonistes à quitter leur village. Leur « vie d’après » va donc commencer. Sera-t-elle meilleure?
Interrogé par Arab News en français sur la trame du film, Anis Djaad explique: «C’est une forme cinématographique assez novatrice, car, en Algérie, on a pour habitude de réaliser des fictions ou des documentaires sur des sujets bien précis. Mon film est un mélange de fiction et de documentaire et présente une démarche néoréaliste assez nouvelle dans le pays. La Vie d’après évoque des sujets sociétaux, des tabous, des désillusions, des espoirs. Cette forme néoréaliste apporte un aspect nouveau au cinéma algérien», ajoute-t-il.

Après la réalisation de trois courts métrages – Hublot (2012), Le Passage à niveau (2014) et Le Voyage de Keltoum (2016) –, Le Jour d’après est le premier long métrage d’Anis Djaad, journaliste, scénariste, réalisateur et romancier. «Ma démarche consistait à filmer des scènes de façon néoréaliste. Ce qui comptait pour moi, dans la réalisation de mes films, est de puiser dans la réalité sociale et dans l’actualité algérienne d’aujourd’hui», nous explique-t-il. Rappelons qu’Anis Djaad a obtenu le prix du meilleur scénario du court métrage lors des Journées cinématographiques d’Alger en 2011 et le prix du jury au festival Vues d’Afrique à Montréal pour Hublot.
Projeté en avant-première le 9 décembre 2021 dans la salle Ibn-Zeydoun d’Alger, ce film a été bien accueilli par le public algérien, aussi bien à Alger qu’à Mostaganem, l’une des villes où s’est déroulé le tournage. «L’avant-première à Alger a fait salle comble, malgré quelques appréhensions, car le film contient des moments forts et soulève des sujets tabous. Son aspect dramatique a provoqué des émotions, des larmes et les applaudissements du public», nous confie Anis Djaad. «À Mostaganem, nous avons organisé un long et passionnant débat avec le public. Je suis content de tout ce que suscite le film depuis sa sortie et sa projection à l’international», ajoute-t-il.
Anis Djaad travaille aujourd’hui sur Terre de vengeance, un scénario développé lors de sa participation à l’atelier Meditalents, cet événement qui réunit des auteurs des pays méditerranéens dans le cadre du festival Cinemed 2021, à Montpellier.
Ne nous racontez plus d’histoires à Carole Filiu et Ferhat Mouhali a été élu meilleur film documentaire. Quant au prix spécial du jury, il a été décerné à Soula, de Salah Issaad.
«Avec la sélection de ces films, nous avons voulu donner un thème à cette 5e édition: la femme et son importance dans la société algérienne. Les message transmis par les deux films – La Vie d’après et Soula – sont très forts», nous confie Flora Boumia, coordinatrice du prix Bouamari-Vautier au sein de l’AFA. Elle ajoute: «Ces deux films nous obligent à regarder en face nos comportements envers la femme, qui est la base de la société humaine. Je souhaite que ces films portent un message à la société algérienne, dont je fais partie. Un message qui dit: “Soyons égaux”», conclut-elle.