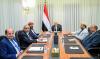PARIS: Les attentats jihadistes du 13 novembre 2015, les plus meurtriers ayant jamais frappé la France, ont officiellement fait 130 morts, mais de nombreux avocats parlent de 132 victimes.
Depuis les attaques, deux rescapés souffrant de stress post-traumatique ont mis fin à leur jour.
Pour leur famille et leurs avocats le décès de ces deux jeunes gens est lié au traumatisme du 13-Novembre, et ils doivent être comptabilisés au côté des morts de la salle de spectacles du Bataclan (90), des terrasses de cafés et restaurants (39) et des abords du Stade de France (1).
Au cours de son réquisitoire, l'avocat général Nicolas le Bris n'a pas hésité à stigmatiser le « cauchemar du 13-Novembre qui a fait 132 morts ».
Guillaume V. et France-Élodie B. seront-ils officiellement considérés comme les 131e et 132e victimes des attentats du 13-Novembre ? C'est à la cour d'assises spéciale présidée par Jean-Louis Périès d'apporter une réponse définitive.
« Les balles invisibles »
Guillaume V., rescapé du Bataclan, avait 31 ans. Il s'est suicidé en 2017 dans une clinique psychiatrique où il était hospitalisé pour délire hypocondriaque et dépression sévère.
« Guillaume n'a pas reçu de balles dans le corps, mais des balles invisibles, qui l'ont tué, doucement mais sûrement », avait témoigné son père Alain en octobre devant la cour.
« Guillaume détestait la violence, mais elle l'a rattrapé le soir du 13 novembre (...). Notre fils qui aimait tant la vie a été envahi et débordé par ce stress post-traumatique, au point de mettre fin à ses jours le 19 novembre 2017 », a raconté le septuagénaire.
Le lendemain de l'attentat, Guillaume avait confié à ses parents: « Ma vie ne sera jamais plus la même ».
Comme nombre de rescapés, Guillaume a souffert d'un syndrome de stress post-traumatique et de ce que les experts appellent « la culpabilité du survivant ». Son état s'est aggravé à partir de juillet 2017. »Le stress post-traumatique s’est transformé en délire hypocondriaque et dépression majeure », avait dit Alain.
Malgré l'amour des siens, les soins des médecins, son état psychique s'est inexorablement dégradé.
Le 13 novembre 2016, Guillaume a parlé pour la première fois des attentats. « Je n'oublierai jamais le bruit des mitraillettes », a-t-il dit en pleurant. « C'était la première fois qu'il nous reparlait de ces attentats. Ça a duré 30 secondes, et il s'est refermé », a dit son père.
En juillet 2017, les crises d'angoisse de Guillaume s'accélèrent. Il est hospitalisé en psychiatrie en août. Personne ne pourra empêcher son suicide le 19 novembre 2017, six jours après le deuxième anniversaire des attentats.
« Guillaume s'est suicidé non pas parce qu'il était faible, mais parce qu'il avait été blessé sur le plan psychiatrique. Guillaume ne voulait pas arrêter de vivre, il voulait arrêter de souffrir », avait déclaré son frère Christophe venu également témoigner.
« Le terrorisme ne l'a pas tué le 13 novembre 2015, le terrorisme l'a tué à petit feu », avait soutenu sa mère dans une lettre lue devant la cour.
Séquelles aggravées par le procès
France-Élodie B. avait survécu à la fusillade à la terrasse du Carillon, le bar en bas de chez elle. Mais elle n'avait pas surmonté sa détresse. Cette mère de deux enfants a mis fin à ses jours le 6 novembre 2021, en plein procès du 13-Novembre. Elle avait 35 ans.
« Depuis les attentats, France-Élodie B. conservait des séquelles psychologiques considérables. Elle n'a jamais réussi à surmonter ce retentissement psychologique et l'ouverture du procès en septembre a aggravé ses séquelles », a expliqué pudiquement à la cour son avocat, Me Pierre Thevenet.
La détresse psychologique dont souffrait la jeune femme l'avait contrainte à abandonner son travail et lui avait valu d'être indemnisée par le Fonds de garantie des victimes des actes de terrorisme (FGTI).
Comme Guillaume et des centaines d'autres rescapés elle était suivie sur le plan psychologique mais la douleur est devenue insupportable.
« Je vous demande d'accepter la constitution de partie civile pour les quatre proches (ses deux enfants mineurs et ses deux parents, ndlr) de Mme France-Élodie B., 132e victime des attentats du 13-Novembre », avait dit à la cour Me Thevenet.
Procès des attentats du 13 novembre en France: les moments marquants de près de dix mois d'audience
Des récits de victimes éprouvants, un principal accusé qui pleure et s'excuse, quelques images diffusées. Voici les moments marquants des près de dix mois d'audience du procès « historique » à Paris des attentats jihadistes du 13 novembre 2015, avant le verdict attendu mercredi.
Le récit collectif des rescapés
Jamais une audience criminelle n'avait autant laissé place à la parole des victimes. Une place en deux temps, au début et à la fin du procès, ce qui est sans précédent.
Au total, environ 400 parties civiles sur les plus de 2 500 constituées - rescapés et proches des 130 victimes décédées - ont défilé à la barre pour raconter « leur 13-Novembre » et reconstituer pièce par pièce le puzzle des attaques jihadistes et de leurs vies brisées.
De ces histoires singulières est né le récit collectif de l'insouciance perdue, la culpabilité intacte et la difficile voire impossible reconstruction.
A l'automne, puis début mai, un même rituel s'est installé: un micro qu'on règle, des feuilles que l'on pose devant soi, la voix qui tremble, et à la fin de longues accolades avec d'autres parties civiles.
Pas d'images « inutilement choquantes »
Il aura fallu attendre près de sept mois d'audience pour que soient finalement diffusés le son et les images de l'attaque du Bataclan. Et une partie seulement. « Pas d'images inutilement choquantes », avait dit la cour.
Cette précaution rarissime aux assises tranche avec le procès des attentats de janvier 2015 contre Charlie Hebdo et l'Hyper Cacher, où la brutalité avait surgi sans ménagement sur grand écran.
Quelques plans larges des tueries sur les terrasses parisiennes et des explosions au Stade de France ont été projetés au début du procès, rien pour le Bataclan. Il y eut aussi des vidéos de propagande du groupe Etat islamique, mais expurgées des scènes les plus atroces.
Cette « aseptisation » fait débat, y compris au sein des associations de victimes.
Le 1er avril, la cour d'assises spéciale de Paris a finalement fait droit à la demande répétée de l'une d'elles, Life for Paris.
Elle diffuse alors une trentaine de photos et des extraits d'un enregistrement sonore. Le silence est lourd quand, dans la salle, résonne la ferveur du concert des Eagles of Death Metal, brusquement interrompu par les tirs des kalachnikov, les cris de peur et les hurlements de douleur.
Un procès sur écrans plats
Un bloc de 45 mètres de long pour 15 mètres de large, 550 places: bâtie de toutes pièces pour ce procès dans l'historique palais de justice de Paris, sur l'île de la Cité, la salle d'audience est lumineuse, moderne et... gigantesque.
Depuis l'ouverture du procès, le 8 septembre, les cous se tordent depuis les bancs de bois pour tenter d'apercevoir, à travers une forêt de robes noires, la cour, les avocats généraux, les accusés et le principal d'entre eux, Salah Abdeslam, placé tout au bout d'un long box vitré.
Les réactions des accusés sont maintes fois restées inaudibles. Leurs expressions imperceptibles.
Pour suivre les débats ne sont souvent restés que les écrans plats disséminés dans les rangées.
« Le planning, le planning »
« Ca va durer neuf mois », « il va falloir vous armer de patience », lançait Jean-Louis Périès à un Salah Abdeslam réclamant le micro au cinquième jour du procès et vitupérant dans son box: « c'est quand qu'on aura la parole ? »
Pour cette audience criminelle inédite par sa durée, qui a paru s'éterniser, le président a opté pour un séquençage qui n'a pas facilité la fluidité des débats.
Les accusés n'auront été interrogés pour la première fois sur le fond du dossier que quatre mois après l'ouverture du procès, après les parties civiles, de nombreux témoins dits « de contexte » et une série d'enquêteurs français et belges.
Et gare à celui qui s'aventurait sur une période des faits sortie du calendrier prévu, « saucissonné » en plusieurs phases: avant août 2015, d'août à début novembre, de début novembre au 13-Novembre, après les attentats...
Un « manque de souplesse », diront certains, une obsession « gestionnaire » du planning, fustigeront d'autres.
La Covid, hôte tenace
La Covid s'est invité tardivement au procès, début 2022, mais de manière tenace: à quatre reprises, l'audience a été suspendue pendant une semaine, repoussant d'un mois la fin prévue de l'audience.
Au total, six des onze accusés comparaissant détenus, serrés dans le box, ont été atteints par le Covid.
Les trois avocats généraux l'ont aussi contracté, l'un d'eux lors des explications très attendues de Salah Abdeslam sur sa soirée du 13-Novembre. Loin de la salle, il a envoyé ses questions par messages à ses collègues.
« Le seul participant connecté »
L'absence physique à la barre et l'anonymat des enquêteurs belges cités comme témoins a fait l'objet d'un bras de fer entre la cour et les avocats de la défense.
Elle a entraîné une « grève du box » de plusieurs accusés, l'un d'eux, le Suédois Osama Krayem, s'absentant même pendant plusieurs mois. Ce refus de comparaître a institué une pause rituelle à chaque début d'audience, le temps que les sommations d'usage par huissier lui soient faites.
Lors des auditions menées depuis le parquet fédéral belge, les connexions avec Bruxelles ont viré au mauvais gag, entre réponses fuyantes des policiers et couacs techniques récurrents.
« Ah ben, il est parti », désespère Me Olivia Ronen, l'une des avocates de Salah Abdeslam, un jour où elle presse de questions un enquêteur. Son visage a disparu des écrans, remplacé par un message et une voix de robot: « vous êtes le seul participant connecté ».
« Bonjour M. le président »
On n'avait pas vu une telle affluence et effervescence au procès depuis son ouverture: l'ambiance est solennelle ce 10 novembre quand l'ancien président François Hollande s'avance à la barre. C'est la première fois qu'un ex chef de l'Etat témoigne aux assises.
« Bonjour Monsieur le président », lui dit Jean-Louis Périès. « Bonjour Monsieur le président », répond le témoin, sourire en coin. Rires dans la salle.
François Hollande ne prononcera pas le nom du principal accusé et ne regardera pas le box, mais ses mots sonnent comme une réponse à ceux de Salah Abdeslam, qui avait affirmé qu'il « n'y avait rien de personnel » dans les attaques. « Ce groupe nous a frappés non pas pour nos modes d'action à l'étranger mais pour nos modes de vie ici-même », martèle François Hollande. « On nous a fait la guerre, nous avons répondu ».
Les larmes d'Abdeslam
Est-ce la même personne ? « Combattant » autoproclamé du groupe Etat islamique au premier jour du procès, Salah Abdeslam verse des larmes lors de son dernier interrogatoire en avril et présente ses excuses »à toutes les victimes ».
« Cette histoire du 13-Novembre s'est écrite avec le sang des victimes. C'est leur histoire, et moi j'en ai fait partie. Elles sont liées à moi et moi à elles », déclare-t-il la voix tremblante.
« Je vous demande de me pardonner. Je sais que la haine subsiste (...) je vous demande aujourd'hui de me détester avec modération ».
Auparavant, il a raconté pour la première fois qu'il avait pour mission de se faire exploser dans un bar du XVIIIe arrondissement de Paris mais qu'il y avait renoncé par « humanité ». A-t-il dit la vérité? Une autre thèse voudrait qu'il ait tenté d'actionner le gilet, mais qu'il était défectueux.