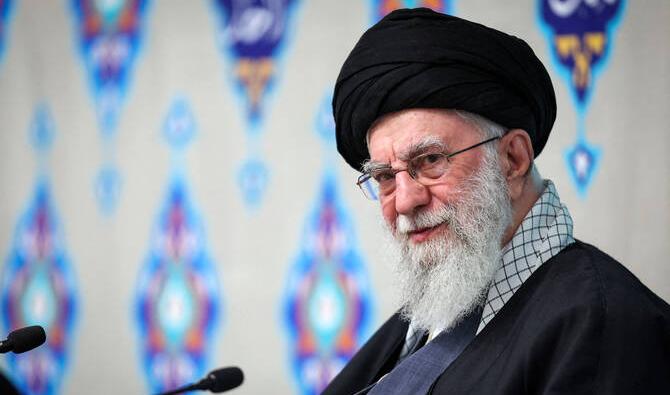PARIS: Ce parcours n'est peut-être pas le plus évident pour une sportive, mais c’est exactement celui qu’a suivi Sadaf Khadem, qui a commencé sa carrière dans la capitale iranienne de Téhéran, pour se retrouver dans la ville côtière de Royan, dans le sud de la France.
Après des études de physique et de mathématiques, elle décide de se lancer dans le sport et de devenir entraîneuse personnelle.
À l’âge de 20 ans, elle se rend à Dubaï et obtient le certificat international d’entraîneur de la Fédération internationale de bodybuilding et fitness (IFBB).
Aujourd'hui, elle suit des études de commerce et travaille en France. Elle a aussi récemment créé sa propre ligne de vêtements.

Le parcours n’a pas été facile pour Khadem, qui a dû affronter de nombreux obstacles depuis qu’elle s’est orientée vers le sport.
Le premier était de trouver un entraîneur de boxe et un lieu pour s’entraîner. Il lui fallait pour cela faire trois heures de route aller-retour, trois fois par semaine.
Autre problème : l’absence de fédération de boxe féminine en Iran pour réglementer ce sport.
«Beaucoup d’hommes s’entraînent avec des femmes en dehors de toute réglementation établie par une quelconque organisation, donc il y a beaucoup de violence. En France ou dans d’autres pays, il existe une fédération qui réglemente le sport, si bien qu’il est plus difficile de commettre des actes violents. Hélas, ce n’est pas le cas en Iran», déclare-t-elle.
Khadem n’a pas souhaité révéler les détails de ce qu’elle a vécu avec son premier entraîneur de boxe en Iran. Toutefois, elle a confié à Arab News qu’après sa mauvaise expérience avec lui, elle a décidé d’arrêter la boxe pendant un an. Elle a ensuite repris ce sport avec l’entraîneur de l’équipe nationale iranienne.
Quelques années plus tard, en 2019, elle devient la première boxeuse iranienne à participer à un match de boxe officiel en France.
«Après m’être entraînée avec l’entraîneur de l’équipe nationale iranienne, j’ai cherché partout pour participer à un match de boxe. J’ai essayé la Turquie, l’Arménie, l’Azerbaïdjan, et finalement, j’ai envoyé un message sur Instagram à l’entraîneur Mahyar Monshipour pour lui demander d’organiser un match officiel, et il a accepté», se souvient la jeune femme.
«Je savais que ce serait important car je suis la première boxeuse à vouloir participer à un match officiel de boxe amateur. Je savais que de nombreux médias voudraient couvrir l’événement, mais je n’imaginais pas que cela prendrait une telle ampleur», poursuit-elle.
Finalement, Khadem s’est installée en France avec l’aide de Mahyar Monsiphour, franco-iranien et six fois champion du monde de boxe.
Elle a réussi à disputer son premier combat officiel à l’étranger, mais depuis, elle a du mal à rentrer en Iran.
Elle était loin de se douter que cet événement allait bouleverser sa vie, pas de la manière dont elle l’avait toujours imaginé.
En raison des lois françaises qui interdisent le port des signes religieux, Sadaf Khadem a dû retirer son voile pendant ses combats, ce qui lui a valu de recevoir des menaces du régime iranien et de choisir de vivre en exil forcé en France.
Cependant, elle affirme à Arab News qu’elle ne vit plus en exil forcé, car elle a pris la décision de rester en France de son plein gré, même si elle n’est plus menacée dans son pays d’origine.
«La première année était très difficile. Je ne parlais pas français. C’était comme si je venais d’une autre planète», indique-t-elle. «Je ne connaissais ni les règles ni la culture du pays. Tout était différent. En plus de cela, j’étais seule, sans ma famille et sans argent. L’exil forcé n’a duré qu’un an, après quoi c’est moi qui ai choisi de rester en France. Les journalistes disent toujours que je suis une réfugiée, mais je ne le suis pas. Je vis ici maintenant de mon plein gré, je dispose d’un permis de séjour et j’ai mon passeport iranien.»
En France, Khadem a trouvé ce dont elle était privée en Iran : la liberté et la protection. «Je ne dis pas que c’est le paradis et qu’il n’y a aucun problème ici, mais par rapport à un pays comme l’Iran, je me sens plus libre», souligne-t-elle.
«J’ai vécu en Iran, donc je sais ce que vit une femme là-bas. Je me souviens que lorsque j’avais 16 ans, je voulais m’entraîner avec les hommes parce que je détestais être une femme en Iran.»
Durant les premiers mois de son séjour en France, les journalistes lui demandaient de commenter la situation politique en Iran. Elle refusait toujours de répondre, prétextant n’être qu’une athlète et ne pas être en France pour exprimer son opinion politique.
«Je n’ai jamais répondu à leurs questions car je risquais de mettre en danger ma famille, qui vit toujours en Iran», explique la sportive. «L’Iran n’est pas comme la France. Nous ne sommes pas libres d’exprimer notre opinion politique. J’ai refusé de donner la moindre interview jusqu’à ce qui est arrivé il y a quelques semaines avec Mahsa Amini.»
Khadem a déclaré aimer toujours son pays d’origine.
«Je ne rejette pas le fait d’être iranienne, j’en suis fière, mais avec toute la gentillesse et la liberté que je ressens ici en France, je n’irais visiter l’Iran aujourd’hui que pour voir ma famille et mes amis, mais je ne peux pas y vivre.»
En outre, Khadem a décidé de vendre l’un de ses appartements en Iran et a investi l’argent dans la création de sa propre ligne de vêtements.
Pour ce qui est de la présence de son entreprise et de ses employés en Iran, elle a affirmé qu’elle souhaitait autonomiser les femmes iraniennes et les aider de toutes les manières possibles.
«Je ne suis pas une féministe pure et dure qui s’oppose aux hommes, mais les droits humains sont importants pour moi», note-t-elle. «La vie des femmes là-bas est différente de celle des autres pays. Je veux motiver les femmes. J’ai investi beaucoup d’argent dans mon entreprise et je n’ai pas réalisé de bénéfices, mais j’en suis fière.»
Sadaf Khadem, qui ne souhaitait pas se mêler de politique, s’est sentie obligée de le faire après ce qui est arrivé à Mahsa Amini, tuée par la police des mœurs iranienne car elle avait enlevé son voile.
«J’ai commencé à en parler sur mon compte Instagram, non pas par compassion parce que je suis iranienne, mais parce que logiquement, il n’est pas acceptable de tuer des gens en 2022, qu’il s’agisse d’hommes ou de femmes, pour un morceau de tissu. Je n’accepte pas cela et je lutte pour les droits humains», poursuit-elle.
«Après la mort de Mahsa Amini, plus de 100 personnes ont été tuées. Le gouvernement iranien a fait appel à ses alliés dans d’autres pays pour tuer son peuple. Cela me brise le cœur de voir que les gens protestent et que leur vie est le prix à payer. Les gens élèvent leurs voix pour la démocratie, pour avoir un pays où ils peuvent vivre plus librement», dit-elle, ajoutant qu’ils ne demandent pas grand-chose mais que le prix à payer est très lourd.

Khadem explique que si elle ne s’oppose pas aux manifestations organisées par les Iraniens dans le monde entier, elle ne pense pas qu’il s’agisse d’une solution.
«Nous ne faisons que du bruit et nous ne pouvons pas accompagner le peuple en Iran. Le prix que nous payons ici en France est un peu de fatigue. Après cela, nous rentrons chez nous tranquillement», remarque-t-elle. «Malheureusement, le prix que les gens payent en Iran est le prix de leur vie et je ne peux pas accepter cela. C’est pourquoi j’estime que la meilleure solution serait une manifestation en ligne et le lancement de cyberattaques, car tout est partagé sur les réseaux sociaux de nos jours.»
Pour Khadem, la stratégie est cruciale à ce stade. Elle a rappelé que la plupart des Iraniens vivant en France s’étaient installés dans le pays avant la révolution de 1979 contre le Chah, ou qu’ils étaient très jeunes lorsqu’ils ont immigré. Ils ne savent donc pas de quoi le régime iranien est capable.
«Vous pouvez manifester mais vous devez avoir une stratégie et un plan pour tout ce que vous désirez dans la vie», observe-t-elle. «Diriger un pays ou apporter des changements dans un pays, ce n’est pas une mince affaire.»
Interrogée sur la différence entre les soulèvements précédents en Iran et les événements de ces dernières semaines, Sadaf Khadem a répondu que les troubles du passé étaient principalement motivés par des raisons économiques ou l’inflation. «Aujourd’hui, la raison est que les gens veulent simplement vivre.»
«Si je ne m’exprime pas aujourd’hui, je le regretterai demain», lance-t-elle. «Je me tiens aux côtés du peuple iranien jusqu’au jour où l’Iran sera libre. Je suis leur soldat. Je suis une championne aux yeux du peuple iranien. Je les soutiens jusqu’à la fin dans leur lutte pour obtenir la liberté et le respect des droits humains.»