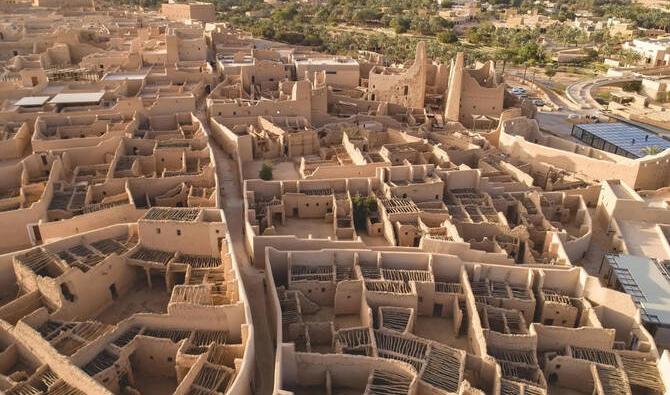LE CAIRE: Leader de la production mondiale de pétrole, le Moyen-Orient s’apprête à jouer un rôle important dans la transition énergétique, selon un rapport de McKinsey & Co.
Le Moyen-Orient produit actuellement près d'un tiers de l'approvisionnement mondial en pétrole, avec 48% des réserves mondiales avérées de pétrole et 40% des réserves de gaz, indique le rapport.
«Aujourd'hui, le Moyen-Orient est responsable de 1,9 gigatonne d'équivalent dioxyde de carbone d'émissions énergétiques, soit près de 5,5% des émissions mondiales liées à l'énergie. La région abrite également plusieurs des dix nations les plus émettrices de carbone par habitant dans le monde», ajoute le rapport.
En outre, les pays du Moyen-Orient sont alimentés presque exclusivement par le pétrole et le gaz, qui représentent 98% de leur consommation d'énergie.
Le Moyen-Orient a exporté 22 millions de barils de pétrole par jour et 127 milliards de mètres cubes de gaz, soit respectivement 34% et 26% des exportations mondiales d'énergie en 2020, précise le rapport.
Cependant, la région possède également certains des bassins d'extraction – c'est-à-dire des roches mères où naissent le pétrole et le gaz – les moins coûteux et les moins intensifs en carbone du monde.
Par exemple, l'intensité carbonique des opérations en amont en Arabie saoudite, de 4,6 grammes d'équivalent dioxyde de carbone par mégajoule (MJ) d'énergie, est inférieure à la moitié de la moyenne mondiale de 10,3 grammes de dioxyde de carbone par mégajoule (gCO2e/MJ).
C'est l'un des principaux avantages dont bénéficie la région pour lui permettre de jouer un rôle de premier plan dans la transition énergétique mondiale.
Mais ce n'est pas tout. Comme les prix de l'énergie solaire dans la région sont actuellement parmi les plus bas au monde, les énergies renouvelables gagnent du terrain, en plus des programmes verts locaux tels que le plan des Émirats arabes unis (EAU), qui vise à investir 160 milliards de dollars (1 dollar = 0,91 euro) dans des sources d'énergie propres et renouvelables au cours des trente prochaines années.
Plusieurs autres pays ont annoncé des gigaprojets, notamment le programme Vision 2030 de l'Arabie saoudite, qui vise l'installation d'environ 60 GW d'énergies renouvelables d'ici à 2030.
Le Royaume a également lancé l'Initiative verte saoudienne, ainsi que l'Initiative verte du Moyen-Orient, afin de renforcer l'engagement de la région en faveur d'un monde plus vert. Il accueillera également la 44e conférence de l'International Association for Energy Economics du 4 au 9 février 2023.
Des avantages uniques
La région attire d'énormes opportunités d'investissement dans les énergies renouvelables grâce à sa situation géographique.
La région du Moyen-Orient et de l'Afrique du Nord reçoit 22 à 26% de l'ensemble des radiations solaires de la planète et la vitesse moyenne des vents y est supérieure au seuil minimal requis pour les parcs éoliens de grande envergure.
Ces avantages uniques offrent à la région la possibilité de réduire les émissions de carbone à l'échelle mondiale.
La promotion des investissements visant à augmenter l'offre de captage, d'utilisation et de stockage du carbone, qui consiste à capter et à utiliser efficacement les fortes concentrations de CO2 émises par les activités industrielles, peut constituer l'une des principales étapes vers une région plus verte.
Le potentiel inexploité du procédé appelé «captage et valorisation du dioxyde de carbone» (également désigné par l’acronyme anglais «CCUS») est important, car des secteurs comme le raffinage, l'acier et le ciment pourraient l’utiliser pour se décarboniser à grande échelle.
Selon le rapport de McKinsey & Co., la réserve actuelle de projets engagés jusqu'en 2030 comporte encore une part considérable de projets d'hydrogène gris, d'une capacité de 45 à 50%, plutôt que de projets d'hydrogène bleu, qui utilisent le CCUS pour atténuer les émissions, ou de projets d'hydrogène vert, qui utilisent encore moins de carbone.
En bref
Le Moyen-Orient a exporté 22 millions de barils de pétrole par jour et 127 milliards de mètres cubes de gaz, soit respectivement 34% et 26% des exportations mondiales d'énergie en 2020.
La région possède également des bassins d'extraction, c'est-à-dire des roches mères où naissent le pétrole et le gaz, parmi les moins coûteux et les moins intensifs en carbone du monde.
À l'heure actuelle, la région affiche également les prix des offres solaires parmi les plus bas du monde.
Plusieurs pays ont annoncé des gigaprojets, notamment le programme Vision 2030 de l'Arabie saoudite, qui vise l'installation d'environ 60 GW d'énergies renouvelables d'ici à 2030.
Les pays du Moyen-Orient utilisent actuellement de grandes quantités d'hydrogène gris à base de gaz naturel, environ 8,4 mégatonnes par an, soit environ 7% du total mondial.
L'augmentation de l'hydrogène bleu et vert ainsi que de la production d'ammoniac pourrait stimuler les partenariats internationaux et les investissements dans les exportations d'hydrogène.
En outre, le Moyen-Orient est une région propice au stockage du carbone, avec un potentiel de stockage souterrain vaste et accessible d'environ 30 gigatonnes.
Le rapport indique également que la région est l'une des moins chères du monde pour la production d'hydrogène vert, avec un coût potentiel inférieur à 2 dollars par kilogramme, alors que le coût mondial se situe entre 2,8 et 6,3 dollars.
Pour soutenir la transition de la région, il est indispensable de stimuler le développement des énergies renouvelables et de faciliter leur intégration en modernisant les infrastructures de soutien. Les investissements dans les énergies renouvelables ont été assez faibles par rapport au pétrole, au gaz et à la pétrochimie, car le mix de production d'électricité des pays du Moyen-Orient reste faible par rapport aux objectifs ambitieux de la région.
En moyenne, un projet solaire nécessite trois à quatre ans pour être achevé au Moyen-Orient. Étant donné que la taille moyenne des projets installés n'est actuellement que de 500 à 800 MW environ, le risque d'incertitude est accru pour les investissements à long terme, selon l'analyse de McKinsey.
La voie à suivre
L'incitation à l'électrification et à l'efficacité énergétique joue également un rôle énorme dans le développement d'une région à consommation nette zéro.
Selon les recherches de McKinsey, 44% de l'énergie consommée dans le monde est basée sur les combustibles et la moitié de ces derniers consommés pour l'énergie pourrait être électrifiée avec les technologies disponibles aujourd'hui.
Au Moyen-Orient, 95% de la consommation énergétique de l'industrie est actuellement basée sur les combustibles fossiles et seulement 4% de l'énergie consommée est de l'électricité.
L'électrification des actifs en amont pourrait réduire les émissions dans les opérations pétrolières et gazières. La recherche et le développement d'équipements et de processus industriels électriques pourraient réduire considérablement les coûts d'investissement et augmenter l'efficacité énergétique des équipements électriques.
La promotion des entreprises de technologies propres qui élaborent de nouvelles solutions énergétiques pour diversifier l'économie locale et saisir les nouvelles opportunités économiques de la transition encouragera fortement d'autres entreprises à en faire autant.
En renforçant le secteur privé non énergétique, l'entrepreneuriat pourrait permettre une diversification économique plus rapide.
Les entrepreneurs sont confrontés à des défis tels que les coûts élevés de constitution en société, le manque de financement pour les petites et moyennes entreprises et les difficultés liées à l'octroi de licences.
La création d'un écosystème de start-up dans le domaine des technologies propres, alimenté par des programmes d'incitation et l'innovation, peut attirer des investissements locaux et internationaux.
Ce texte est la traduction d’un article paru sur Arabnews.com