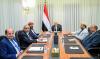BAMAKO, Mali : Un «rapport biaisé, reposant sur un récit fictif»: la junte malienne a dénoncé samedi le rapport de l'ONU accusant l'armée et des combattants «étrangers» d'avoir exécuté au moins 500 personnes lors d’une opération antijihadiste à Moura en mars 2022.
Selon le porte-parole du gouvernement, le colonel Abdoulaye Maïga, la justice malienne a ouvert une enquête à la suite des événements de Moura. «Aucun ressortissant civil de Moura n’a perdu la vie pendant l’opération militaire», a-t-il affirmé dans un communiqué lu à la télévision d'Etat. «Parmi les morts, il n’y avait que des combattants terroristes», a-t-il ajouté.
Tels que documentés dans le rapport publié vendredi du Haut-Commissariat aux droits de l’Homme, les évènements de Moura (centre), objets de versions contradictoires depuis un an, sont les pires du genre dans un pays pourtant familier des atrocités des jihadistes et d’autres groupes armés depuis 2012. Le rapport constitue le document le plus accusateur produit contre les forces maliennes mises en cause à de multiples reprises par le passé.
Le Haut-Commissariat «a des motifs raisonnables de croire» qu’au moins 500 personnes, dont une vingtaine de femmes et sept enfants, auraient été «exécutées par les Forces armées maliennes et les personnels militaires étrangers» entre le 27 et le 31 mars 2022 dans cette localité de quelques milliers d'habitants, dit le texte.
Ce rapport est basé sur une enquête de la division des droits de l'Homme de la mission de Casques bleus déployée au Mali depuis 2013 (Minusma), 157 entretiens individuels et 11 entretiens de groupes.
- Enquête pour «espionnage» -
Dans sa réponse, le gouvernement malien a dit avoir appris «avec stupeur» que la mission d’établissement des faits avait utilisé des satellites au-dessus de Moura pour obtenir des images «sans autorisation et à l’insu des autorités maliennes». Il a déclaré «ouvrir immédiatement une enquête» pour «espionnage, atteinte à la sûreté extérieure de l’Etat» ainsi que «complot militaire».
Le Haut-commissariat a aussi «des motifs raisonnables de croire que 58 femmes et jeunes filles ont été victimes de viol et autres formes de violences sexuelles». Il fait état d'actes de torture sur des personnes arrêtées.
Ces agissements pourraient constituer des crimes de guerre et des crimes contre l'humanité, a dit dans un communiqué Volker Türk, Haut-Commissaire de l'ONU aux droits de l’Homme.
Le rapport n'identifie pas les «étrangers». Mais il rappelle les déclarations officielles maliennes sur le concours «d'instructeurs» russes au combat contre les jihadistes et les propos attribués au chef de la diplomatie russe Sergueï Lavrov sur la présence au Mali de la société privée de sécurité russe Wagner.
L'ONU cite des témoignages décrivant ces étrangers comme des hommes blancs en treillis parlant une langue «inconnue» et qui «supervisaient» les opérations.
- Cinq jours d'effroi -
Le rapport raconte cinq jours d'effroi après l'arrivée le 27 mars en fin de matinée des soldats maliens et de leurs alliés dotés de cinq hélicoptères alors qu'une foire aux bestiaux avait attiré des milliers de civils.
Moura est réputé être un fief de la Katiba Macina affiliée au Groupe de soutien à l’islam et aux musulmans (GSIM), lui-même affilié à Al-Qaïda. Une trentaine de membres de la Katiba Macina se seraient mêlés aux forains et civils.
Un hélicoptère et des hommes au sol auraient ouvert le feu «de manière indiscriminée» vers le marché, des jihadistes auraient riposté. Une trentaine de personnes dont une douzaine de jihadistes auraient été tués. L'armée malienne aurait pris le contrôle des lieux et interpellé environ 3.000 personnes. Elle aurait continué à ratisser la localité les jours suivants.
Les soldats maliens et leurs alliés «auraient sélectionné plusieurs centaines de personnes qui ont été sommairement exécutées pendant au moins quatre jours», essentiellement par balles, dit le rapport.
Selon la junte malienne, cette opération antijihadiste a été «salutaire» pour les populations locales et a permis de «désorganiser durablement» la Katiba Macina.
La surveillance des droits fait partie du mandat de la Minusma et son rapport contredit le narratif officiel.
Le rapport paraît à un moment très délicat des relations - en constante détérioration - entre la junte et la Minusma.
«Le gouvernement de transition avait mis en garde contre l’instrumentalisation de la Minusma et des Droits de l’Homme dans le dessein de briser la dynamique de la montée en puissance des forces de défense et de sécurité du Mali et de s’opposer aux choix stratégiques du Mali», a affirmé samedi le gouvernement dans son communiqué.
Le renouvellement du mandat de la Minusma qui expire en juin doit être examiné dans les prochaines semaines. La mission est plus que jamais sujette aux interrogations sur sa capacité à accomplir son mandat, devant les obstructions de la junte et le départ de plusieurs pays contributeurs.