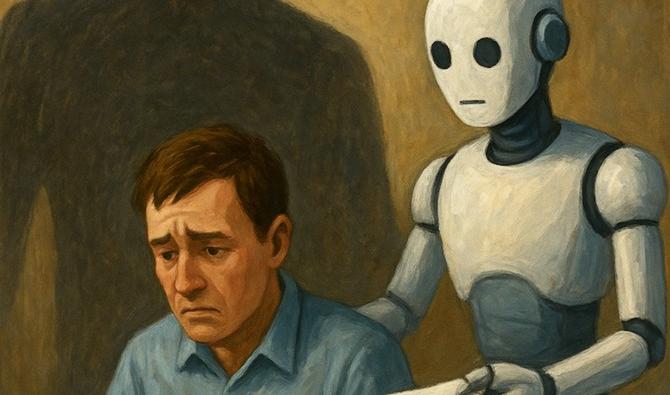Depuis deux siècles, les révolutions technologiques promettent à la fois bouleversements et renouveau. Le métier à filer a brisé le système des guildes, les tracteurs ont déplacé les ouvriers agricoles mais en ont nourri des millions d'autres, et les ordinateurs ont vidé le travail de bureau tout en donnant naissance à des industries entières. Chaque vague d'innovation a suscité l'inquiétude d'un chômage massif, mais à chaque fois, de nouveaux secteurs ont absorbé les personnes déplacées.
L'intelligence artificielle est toutefois différente. Contrairement au métier à tisser ou au tracteur, l'IA menace non seulement le travail manuel, mais aussi le travail cognitif : rédiger des contrats, diagnostiquer des maladies, voire écrire des logiciels. La question qui se pose aux décideurs politiques en 2025 n'est plus de savoir si l'IA va remodeler les marchés du travail, mais plutôt de savoir où les humains trouveront encore un emploi lorsque les machines se chargeront de la réflexion.
Le rythme du changement est extraordinaire. Les débuts de ChatGPT en 2022 ont été suivis par Genie 3 de Google en 2024, un système qui permet aux robots de naviguer dans des environnements réels. Le GPT-5, sorti en 2025, a repoussé encore plus loin les limites du raisonnement. Il ne s'agit pas d'outils de niche. Il s'agit de technologies à usage général qui se diffusent à une vitesse qu'aucune révolution industrielle antérieure n'a jamais connue. Les projections varient, mais elles vont toutes dans le même sens : des dizaines de millions d'emplois perdus, des centaines de millions potentiellement automatisés dans le monde et des licenciements aux États-Unis déjà au plus haut depuis les années de la pandémie.
Des enquêtes suggèrent que près de la moitié des entreprises américaines prévoient de réduire leurs effectifs à cause de l'IA. L'Organisation internationale du travail estime que 14 % des emplois dans le monde sont fortement menacés par l'automatisation et que 32 % sont susceptibles de subir des transformations majeures. Goldman Sachs a chiffré le déplacement potentiel à 300 millions d'emplois dans le monde. Ce bouleversement n'est plus hypothétique - il est en cours.
L'histoire offre des précédents, mais pas nécessairement de réconfort. Les luddites qui détruisaient les machines textiles se sont avérés avoir tort et la révolution informatique a éliminé les ateliers de dactylographie mais a créé des industries entièrement nouvelles. Pourtant, l'analogie d'aujourd'hui ne tient pas la route. Ces innovations antérieures ont déplacé le travail manuel ou de bureau tout en ouvrant de nouvelles frontières industrielles - l'acier, l'automobile, les technologies de l'information, etc. En revanche, l'IA automatise la cognition elle-même. Si les tracteurs ont permis aux ouvriers agricoles d'aller travailler dans les usines, où iront les avocats lorsque les contrats s'écriront d'eux-mêmes, ou les codeurs lorsque les logiciels répareront leur propre code ? Cette fois, même les classes professionnelles, longtemps considérées comme à l'abri de l'automatisation, sont menacées.
Les gouvernements se démènent. Singapour consacre des fonds à la reconversion professionnelle liée à l'IA. L'Union européenne pilote des "passeports de compétences" pour aider les travailleurs à passer d'un secteur à l'autre. Aux États-Unis, le revenu de base universel, autrefois considéré comme une idée marginale, est entré dans le débat général. Pourtant, ces efforts ressemblent à des rustines sur une rupture. McKinsey estime que l'IA pourrait ajouter 4 400 milliards de dollars de productivité annuelle à l'économie mondiale d'ici à 2040, mais ces gains ne seront pas répartis uniformément et ne compenseront pas les laissés-pour-compte. Si l'IA continue de progresser, elle ne déplacera pas seulement les employés de bureau et les assistants juridiques, mais aussi les radiologues, les analystes et même les enseignants, ébranlant ainsi les fondements de la classe moyenne.
Le contexte géopolitique ajoute à l'urgence. La formation de systèmes d'IA de pointe exige tellement de ressources que seuls quelques pays et entreprises peuvent rivaliser. La course s'est réduite aux géants américains et chinois. L'investissement privé mondial dans l'IA atteindra 67 milliards de dollars en 2024, les États-Unis en captant environ la moitié, tandis que la Chine s'est engagée à dépenser plus de 150 milliards de dollars dans l'IA d'ici à 2030.
Soixante-dix pour cent des étudiants diplômés dans des domaines liés à l'IA aux États-Unis sont nés à l'étranger, et c'est la Chine qui fournit les effectifs les plus importants. Les ressortissants chinois représentent environ 30 % des doctorats en IA aux États-Unis. Les immigrants chinois ont fondé huit des 48 plus importantes entreprises américaines spécialisées dans l'IA et la moitié de l'équipe de "superintelligence" de Meta est chinoise. Pourtant, Washington durcit la loterie H-1B et réprimande les universités d'élite pour leur recours aux talents étrangers - la "naissance de l'ère de l'ICE". Au moment même où l'Amérique a le plus besoin d'esprits internationaux, elle les exclut. L'ironie est flagrante : un pays terrifié à l'idée de perdre la course à l'IA face à la Chine met à l'écart les ingénieurs et entrepreneurs chinois qui alimentent son avance.
Aujourd'hui, la recherche exploratoire en matière d'IA n'est pas un champ ouvert, mais un domaine étroitement protégé, limité moins par l'argent que par la rareté des personnes capables de faire avancer les choses. La comparaison est moins avec la technologie grand public qu'avec les débuts de la physique nucléaire, lorsque les percées dépendaient d'une poignée d'esprits regroupés dans quelques laboratoires.
Si l'IA continue de progresser, elle remplacera les radiologues, les analystes et même les enseignants, ébranlant ainsi les fondements de la classe moyenne.
John Sfakianakis
Pour les plus grandes entreprises technologiques, même si elles ont des milliards à dépenser, le nombre de chercheurs qui comptent vraiment n'est que de quelques centaines - et, parmi eux, il y en a peut-être quelques dizaines dont les idées influencent de manière disproportionnée l'orientation du domaine.
Mais l'incertitude centrale n'est pas seulement de savoir qui mène la course, c'est de savoir où elle se dirige. La littérature sur l'IA et la productivité reste incertaine, non seulement parce que les preuves sont rares, mais aussi parce que nous ne savons pas encore quelle direction prendra l'IA elle-même. Sera-t-elle la nouvelle électricité, saturant l'économie, ou un outil surestimé - brillant dans les flashs mais limité ? Jusqu'à ce que la trajectoire se clarifie, toute affirmation confiante quant à l'impact à long terme de l'IA relève plus de la spéculation que de la science.
Certains affirment que les humains se réorienteront vers des domaines où la confiance, l'empathie et la présence physique sont indispensables - les soins aux personnes âgées, l'hôtellerie, les services communautaires et l'artisanat, par exemple. D'autres placent leurs espoirs dans des industries entièrement nouvelles, comme la biologie synthétique ou l'exploration spatiale. Mais ces alternatives sont spéculatives et peu susceptibles d'absorber des dizaines de millions de professionnels déplacés à des salaires comparables. L'Organisation de coopération et de développement économiques avertit que l'automatisation induite par l'IA risque de vider la classe moyenne de sa substance, en affectant de manière disproportionnée les emplois moyennement qualifiés qui soutiennent la stabilité sociale.
La possibilité la plus inquiétante est que les sociétés acceptent un chômage structurel permanent, en s'appuyant sur la redistribution plutôt que sur le travail. Cela soulève des questions d'identité et de dignité : les sociétés peuvent-elles rester unies lorsque le rôle social du travail diminue ? Et plus profondément : qu'advient-il de l'humanité lorsque l'acte même de penser - une tâche qui définissait autrefois notre espèce - est externalisé ? Il ne s'agit pas seulement d'un problème économique, mais d'une énigme civilisationnelle. Que feront les gens lorsque quelqu'un d'autre - ou quelque chose d'autre - pensera à leur place ?
Le malaise de l'opinion publique reflète cette incertitude. Selon une récente enquête de Pew, 62 % des Américains s'attendent à ce que l'IA ait un impact majeur sur l'emploi d'ici 20 ans, mais seulement 28 % d'entre eux pensent qu'elle améliorera les possibilités d'emploi. En d'autres termes, la plupart des gens voient venir les bouleversements, mais peu d'entre eux s'attendent à en bénéficier. Cette inquiétude n'est pas déplacée : elle reflète l'ampleur des changements déjà en cours.
Les décideurs politiques commencent à peine à s'en préoccuper. La redistribution par le biais d'un revenu de base ou d'un impôt négatif sur le revenu pourrait amortir le choc, mais il n'est pas certain que les contribuables soutiendront de tels programmes. La collaboration entre l'homme et l'intelligence artificielle, dans le cadre de laquelle les machines augmentent les capacités des travailleurs au lieu de les remplacer, peut ralentir l'érosion, mais ne l'arrête pas. La redéfinition du "travail" lui-même est encore plus radicale : il s'agit d'en étendre la reconnaissance aux soins, au bénévolat et aux activités créatives que l'IA ne peut pas reproduire entièrement. Mais cela exige une réorganisation de la valeur économique et du statut social que peu de gouvernements sont prêts à entreprendre.
Les enjeux ne pourraient être plus élevés. L'IA élimine déjà des emplois à un rythme sans précédent depuis la Grande Dépression. Les analogies historiques sont réconfortantes mais trompeuses : la machine à vapeur, l'électricité et les ordinateurs ont remodelé les économies mais ont préservé la primauté de l'homme dans les domaines cognitifs. Cette fois, les machines s'attaquent au bureau, et pas seulement à l'atelier.
Le bilan est inévitable. Les sociétés qui s'adaptent peuvent naviguer dans la transition en construisant des filets de sécurité, en investissant dans la complémentarité entre l'homme et l'intelligence artificielle et en développant de nouvelles industries. Celles qui échouent s'exposent à un chômage de masse et à des troubles politiques d'une ampleur inégalée de mémoire d'homme. La révolution de l'IA nous pose une question plus aiguë : non seulement quels emplois subsisteront, mais aussi si la dignité du travail elle-même peut survivre lorsque les machines nous surpassent.
Le défi n'est plus de suivre le rythme des machines, mais de décider du type de société que nous voulons lorsqu'elles prendront inévitablement de l'avance.
John Sfakianakis est économiste en chef et responsable de la recherche économique au Gulf Research Center.
NDLR: Les opinions exprimées par les auteurs dans cette section leur sont propres et ne reflètent pas nécessairement le point de vue d'Arab News.