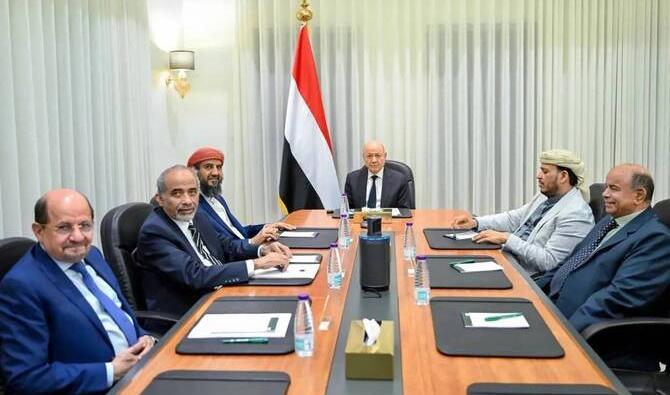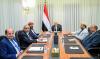---------------------------------------------------------------------
Irak, Algérie, Liban: ces trois pays arabes ont connu ces deux dernières années des mouvements de contestation populaire, ou «Hiraks». Survenus près d’une décennie après les soulèvements des Printemps arabes, ces mouvements ont la particularité d’être portés par une nouvelle génération plus jeune, plus virulente contre le pouvoir, et plus en harmonie avec son époque. Mais elle est surtout nettement mieux équipée pour exploiter et manœuvrer les modes de «communication 2.0», en l’occurrence les réseaux sociaux, à des fins de mobilisation politique. Dans une série d’articles, Arab News en français se penche, à l’aide de spécialistes de chacun de ces trois pays, sur ces Hiraks qui, bien qu’ils s’inscrivent dans la même époque et se réclament d’une même mouvance, ont chacun des particularités très spécifiques, en raison des différents défis sociaux, politiques et économiques à Bagdad, Alger et Beyrouth.
---------------------------------------------------------------------
BEYROUTH: Le 17 octobre 2019, les Libanais, toutes confessions confondues, sont descendus dans les rues dans toutes les régions du pays pour protester contre une taxe que le gouvernement voulait imposer sur les appels via l’application WhatsApp.
Au fil des jours, par un effet boule de neige, les manifestations ont pris une tournure plus politique. Elles ont clairement accusé les dirigeants libanais de corruption, de népotisme et de clientélisme, utilisant le slogan, Kellon yaané kellon («Tous sans exception»), les rendant responsables de la faillite de l’État, sur les plans financier, économique et sécuritaire. En presque deux semaines, les révolutionnaires sont parvenus à faire chuter le gouvernement de Saad Hariri. Mais depuis cette date, ils ne sont pas parvenus à renverser le système en place, enraciné depuis plusieurs décennies. Tous les autres dirigeants, notamment le président de la République, Michel Aoun, et le président du Parlement, Nabih Berry, sont toujours en place.
Après la double explosion qui a eu lieu dans le port de Beyrouth le 4 août 2020, les manifestants ont également réussi à faire sauter le gouvernement de Hassan Diab. Les autres revendications sont toutefois restées lettre morte, notamment l’appel à organiser de nouvelles élections législatives, et la lutte contre l’impunité en faisant juger des responsables qu’ils considèrent corrompus et incompétents.
Les politiciens mènent des actions délibérées pour détruire le pays. Les crises au Liban se succèdent depuis un an: la contrebande aux frontières, l’explosion du port de Beyrouth, la crise financière, bancaire, judiciaire, le refus de former un gouvernement, et récemment l’affaire du Captagon…
Pour Tarek Mitri, ancien ministre, et actuellement président de l’université Saint-Georges à Beyrouth (SGUB), on peut tirer deux enseignements intéressants du mouvement du 17 octobre. «Il a permis l’émergence d’une conscience citoyenne chez les jeunes, qui est l’absence de médiation entre l’individu et l’État. La citoyenneté suppose une individualité. Les manifestants avaient une conscience de soi libanaise. Lors des discussions et des débats qui ont eu lieu, ils ne se définissaient pas comme membre d’une communauté, mais avaient un discours purement libanais», explique-t-il. «Ce mouvement a également démontré qu’il est possible de rejeter la classe politique par des moyens pacifiques.»

«Dans un système communautariste, il y a souvent un degré d’identification des personnes avec leur leader»,
Tarek Mitri
Contrairement aux autres révoltes dans la région, la contestation populaire au pays du Cèdre a été moins meurtrière que dans d’autres pays comme l’Irak, ou par rapport aux conflits armés qui ont dégénéré à la suite de révoltes dans certains pays arabes depuis 2011, notamment en Syrie ou en Libye.
Dans ce contexte, Tarek Mitri conteste l’usage de la notion de «printemps arabe». Selon lui, il s’agit de révolutions distinctes, initiées pour des raisons différentes. «La révolution tunisienne a donné des idées aux Égyptiens. La révolution égyptienne a inspiré les Libyens et les Syriens. Mais chacune d’entre elles a été motivée par des considérations locales. Ce qui est panarabe, c’est la volonté du changement et le rejet des régimes dictatoriaux», estime-t-il.

Le Liban a en effet son histoire et ses spécificités. Il possède surtout un système politique bien plus résistant au changement que n’importe quel autre système politique arabe. «C’est un pays qui est – en raison de son système communautaire – gouverné par des chefs de communautés plus ou moins autoritaires, selon les cas et le contexte. Il n’obéit pas à la même logique que les révoltes contre les régimes autoritaires», explique l’ancien ministre. Selon lui: «Le Liban n’est pas gouverné par une dictature. Il est gouverné par une “vetocratie”, un parti puissant qui a un droit de veto qu’il exerce sur toutes les questions», faisant ainsi allusion au Hezbollah.
La situation économique est tellement dramatique que «les contestataires, et notamment les jeunes qui ont investi les rues pendant des mois sont en train d’émigrer ou essaient de quitter le pays. Ils n’ont pas les moyens de continuer ce combat»
Tarek Mitri
Un mouvement qui s’essouffle?
Un an et demi après son lancement, le mouvement du 17 octobre semble s’essouffler. La crise sanitaire liée au coronavirus a terrassé la contestation populaire. Mais pas seulement. Armés de leur laïcité pour combattre le système communautaire, les révolutionnaires ont échoué à rallier une grande partie des Libanais. «Le problème du communautarisme, c’est qu’il existe une adhésion populaire à la communauté. Même si leurs dirigeants sont élus sans être, d’une certaine manière, démocratiquement choisis, on constate souvent une forme d’identification des personnes avec leur leader, ne serait-ce que pour se différencier des autres, ou à cause des peurs que peuvent susciter les relations entre communautés», affirme Tarek Mitri à Arab News en français.

Dans une période instable et de crise comme celle que le Liban traverse, «les Libanais cherchent la protection au sein même de leur propre communauté. C’est pourquoi la majorité des personnes qui appartiennent à chacune des communautés ne sont pas écrasées par leur dirigeant. Au contraire, beaucoup continuent de s’identifier à lui. Ce qui rend le changement bien plus difficile», précise Tarek Mitri.
Le mouvement contestataire a également échoué à faire émerger des leaders révolutionnaires, et non de simples coordinateurs d’associations et d’ONG. Il n’a en outre pas réussi à convaincre les partisans des chefs traditionnels, en leur présentant un programme simple et une feuille de route commune. Selon M. Mitri, il y a deux formes de société civile: celle qui est organisée, comme les ONG largement influencées par des modèles d’intervention qu’ont connu les sociétés plus développées que les nôtres; et une autre non organisée, et formée d’individus et de groupes qui se considèrent comme autonomes par rapport à la société politique.
«Il faut qu’un mouvement politique clair puisse émerger. Pas nécessairement un parti politique. Or, les organisations de la société civile ne peuvent pas en l’état supplanter les organisations politiques qui nous manquent cruellement: les partis politiques traditionnels transcommunautaires sont marginaux et ont perdu leur crédibilité, et les partis communautaires font partie du problème, bien que certains soient en train de se réinventer», précise Tarek Mitri. «Pour qu’il ait un changement politique, il faut qu’il y ait un instrument politique pluricommunautaire. Or, celui-ci n’existe pas, malheureusement.»
Par ailleurs, il faut des organisations qui font de la politique, et non pas un travail de société civile. Les premières sont une force de proposition, alors que les secondes sont une force d’opposition. Le problème, c’est que des propositions de la société civile comme Kellon yaané kellon, n’ont pas de consistance, ou bien sont trop spécifiques sur une question précise. «Il faut un projet politique qui puisse recoller tous ces morceaux, et c’est là que le bât blesse», affirme ainsi M. Mitri.
Un autre facteur essentiel qui a nui énormément au mouvement du 17 octobre est le manque de réflexion en son sein, au sujet du pouvoir libanais. «Le débat ou le non-débat autour du Hezbollah est assez révélateur. Pour comprendre le pouvoir libanais en vue de le changer, il faut examiner de près la part qu’occupe le Hezbollah dans l’exercice du pouvoir», précise l’ancien ministre de la Culture.
D’après lui: «Les autorités politiques aujourd’hui au Liban forment un pouvoir nominal, alors que le pouvoir effectif est ailleurs.» On a l’impression qu’il y a une action délibérée des politiciens libanais pour détruire le pays. Les crises au Liban se succèdent depuis un an: l’affaire du Captagon récemment, mais aussi la contrebande aux frontières, l’explosion du port, la crise financière, bancaire, judiciaire, le refus de former un gouvernement...
«Ce qui est incompréhensible dans le cas libanais, c’est de savoir quels intérêts ont ces deux pouvoirs – le pouvoir nominal et le pouvoir effectif – à laisser mourir le Liban, et à contribuer à sa destruction. Il n’y a plus de butin à partager, il ne reste qu’une dépouille à gouverner», s’indigne Tarek Mitri.
Quelles perspectives ?
La situation économique est tellement dramatique que «les contestataires, et notamment les jeunes qui ont investi les rues pendant des mois sont en train d’émigrer ou essaient de quitter le pays. Ils n’ont pas les moyens de continuer ce combat». Ce nouveau développement est très grave», affirme Mitri. Or, la traduction du mouvement en changement politique nécessite beaucoup de temps. On ne peut pas s’attendre à récolter les fruits de cette révolution immédiatement. Il est très difficile dans un pays où on a du mal à survivre de s’inscrire dans la longue durée. «Le Liban ne va pas changer dans l’immédiat. Il faut avoir le courage et la patience de continuer, sans s’attendre à des résultats immédiats. Le combat des idées est important. Il faut travailler pour que les idées nées de ce mouvement soient reconnues et bien acceptées par la population, sans avoir de garantie que cela aura lieu prochainement. C’est un peu ça la politique», explique M. Mitri à Arab News. «C’est un phénomène largement générationnel, avec beaucoup de jeunes. C’est cette jeunesse qui est la plus découragée. On risque de ne plus retrouver les gens qu’on a vu dans les rues il y a deux ans», s’inquiète le ministre.