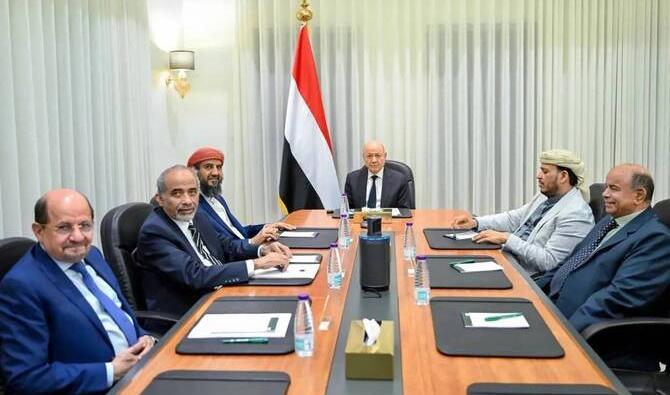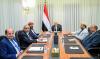-----------------------------------------------------------------------
Irak, Algérie, Liban: ces trois pays arabes ont connu ces deux dernières années des mouvements de contestation populaire ou «Hiraks». Survenus près d’une décennie après les soulèvements des Printemps arabes, ces mouvements ont la particularité d’être portés par une nouvelle génération plus jeune, plus virulente contre le pouvoir, et plus en harmonie avec son époque. Mais elle est surtout nettement mieux équipée pour exploiter et manœuvrer les modes de communication 2.0, en l’occurrence les réseaux sociaux, à des fins de mobilisation politique. Dans une série d’articles, Arab News en français se penche, à l’aide de spécialistes de chacun de ces trois pays, sur ces Hiraks qui, bien qu’ils s’inscrivent dans la même époque et se réclament d’une même mouvance, affichent chacun des particularités très spécifiques aux défis sociaux, politiques et économiques de Bagdad, d’Alger et de Beyrouth.
-----------------------------------------------------------------------
ALGER : Depuis le déclenchement, le 22 février 2019, du mouvement populaire communément connu sous le nom de «Hirak», le climat politique algérien a subi d’importantes métamorphoses. Ce soulèvement pacifique, d’une ampleur inédite dans l’histoire de l’Algérie indépendante, est devenu «l’exemple» à suivre pour de nombreuses populations du monde, surtout qu’il a réussi l’impossible: faire tomber le projet de nouveau mandat d’un président au pouvoir depuis vingt ans.
Le Hirak est à l’évidence un mouvement social, même si l’essence des revendications est d’ordre politique. Ce mouvement populaire massif et continu doit justement sa longévité, voire sa survie, au fait qu’aucun parti politique, aucune association et aucun leadership ne peut revendiquer ou faire valoir sa paternité, même si les velléités de récupérations politiques et les tentatives de manipulation sont nombreuses et récurrentes.
Le mouvement n’a pas échappé à l’analyse des sociologues qui se sont penchés sur ces Algériens qui se sont réappropriés la chose politique, et qui s’impliquent, de manière significative, dans l’édification d’une «Algérie nouvelle».
Qu'est-ce qui a contribué à cet éveil politique de la jeunesse algérienne, longtemps démissionnaire? Pourquoi ce soulèvement a-t-il tardé à apparaître? Dans quel carrefour le Hirak algérien rencontre-t-il et/ou se différencie-t-il des autres mouvements dans la région? Alors, que s'est-il concrètement passé depuis deux ans dans le pays? Quels ont été les acquis du Hirak?
Pour répondre à ces questions Arab News en français a contacté le Pr Arous Zoubir, éminent sociologue et directeur du laboratoire Religion et Société, de l’Université d'Alger 2. Il nous a présenté une analyse sociopolitique de la situation.
«Un avant et un après 22 février»
Pour le Pr Arous, ce soulèvement était «inévitable». Il parle d’ailleurs d’un éveil national dont les raisons sont claires et connues. Elles sont notamment liées à la pratique d'un système qui a mené le pays au bord de la faillite. On parle là, explique le professeur, d’un système qui a détruit la société du point de vue de l'éthique, qui a détruit le sentiment d'appartenance à la patrie et qui a amené tout Algérien à ressentir de l'humiliation en voyant sa dignité piétinée.

Le sociologue évoque un élan populaire de masse dominé par la présence de la jeunesse algérienne qui été longtemps absente de la sphère politique et sociétale. «Des jeunes sont sortis à travers tous les villages et toutes les villes du pays avec un slogan et une discipline remarquable. Je pense réellement qu'il y a dans l'histoire du pays un avant et un après 22 février», a assuré Arous.
Tout a commencé le 16 février dans la ville de Kherrata (une commune de la wilaya de Béjaïa, située à plus de 300 km à l’est d'Alger). L’Algérie a vu naître son mouvement populaire, provoqué par la candidature de l'ancien président Abdelaziz Bouteflika pour un cinquième mandat, en dépit de son état de santé et de son incapacité à assumer les responsabilités qu'impose le statut présidentiel.
Cette révolte s'est métamorphosée en un sursaut populaire à partir 22 février 2019. «Si nous mobilisons l'outil conceptuel de l'analyse historique, on peut affirmer que le Hirak fait partie des mouvements de contestations que le pays a connu depuis les années 1980», affirme le spécialiste.
«Pacifisme» et «civisme», marques du Hirak
Sociologiquement, en comparaison avec les mouvements sociaux précédents, le Hirak a rapidement pris de l'ampleur et s'est étalé sur tout le territoire national avec une participation hétérogène de la population de différentes affiliations culturelles. «S’ajoute à cela la pluralité de la participation qui va des militants des partis et des dichotomies politiques, et des polarisations idéologiques. Sans oublier le facteur “genre” dans la définition des publics manifestants à l'instar des individus, familles, associations féminines et féministes», explique Arous.
L’autre aspect mis en exergue par le chercheur est le pacifisme (Silmiya) du mouvement qui a caractérisé depuis le début les manifestations dans tout le pays, avec la conscience en la continuité de la lutte. Pour Zoubir Arous, le choix du pacifisme comme paradigme différencie clairement le Hirak algérien des autres révoltes populaires que plusieurs pays de la région Moyen-Orient et Afrique du Nord (Mena) ont connues depuis 2011, sous le nom de «Printemps arabe», à l'image de la Tunisie, l'Égypte, la Syrie, le Yémen, la Libye, l'Irak, et enfin le Soudan.
Printemps arabes - Hirak : symétries et différences
En dépit des spécificités des contextes nationaux des mouvements de protestations de ces différents pays, il est certain, selon Arous, que les circonstances objectives sont similaires, en considération de la structure dominante et tyrannique multidimensionnelles de ces régimes, qu'ils soient du Maghreb ou du Machrek. «Ce n’est donc pas une exception historique, mais la conséquence inévitable et objective d’une combinaison de facteurs, allant de la dégradation du niveau de vie, social et culturel, et du recul de la pratique politique caractérisée par une corruption généralisée», précise-t-il.
Poursuivant ses propos, le sociologue explique que cet ensemble de facteurs a cristallisé la gronde populaire et a agrégé les mécontentements d’ordre politique, pour activer ensuite la mèche des révoltes composées de forces sociales aux profils sociologiques hybrides, et pas forcément en accord avec ce qu'imposent les structures partisanes des partis politiques, ou des organisations civiles.
Nouveaux acteurs individuels et «cadrage symbolique»
Il note, par ailleurs, que la diversité des publics et masses participant aux manifestations, le refus de toute forme de représentation ont fait émerger des acteurs individuels, qui se sont hissés par la suite comme leaders assumant la fonction de «cadrage symbolique» au sein des manifestations des étudiants (les mardis) et celles des vendredis. Et ce, en dépit du verrouillage hermétique, du rétrécissement des espaces d'expression, et de l'arrestation de plusieurs militants à travers le territoire national.

Cette nouvelle catégorie de militants a permis au mouvement populaire de se libérer du joug d'un cadrage politique et d'une domination idéologique exercée par les partis et les élites autant démocratiques qu’islamistes, et personnels politiques des mêmes sphères d'une opposition calcifiée.
Notre interlocuteur a mis en relief la puissance d'une jeunesse active ressuscitée après une période d'hibernation, ce qu’il a qualifié d'«égarement existentiel», et cela, à la suite du choc de la violence dévastatrice de la décennie noire (les années 1990)
«Nous sommes là face à une jeunesse consciente qui, grâce à sa formation, et en raison de la nouvelle réalité de l'environnement techno-médiatique, fait dorénavant partie des segments les plus en phase avec les métamorphoses que connaît le pays, et des différents enjeux du moment, que ce soit sur les plans politique, économique, culturel ou social», a-t-il indiqué.
Faire face aux anciennes formations politiques
Cette nouvelle puissance politique est diamétralement opposée aux forces politiques classiques qui se décomposent en trois catégories principalement.
Il s’agit, selon Zoubir Arous, des formations politiques dites «démocratiques» regroupées au sein du Pacte pour l'alternative démocratique (PAD) et rejetant toute proposition émanant du régime dans sa tentative pour sortir de la crise multidimensionnelle en adoptant le stratagème de la continuité.
Il est question également, des formations politiques dites «nationalistes» ayant marqué leur retour en force sur la scène politique algérienne. Et enfin, les formations politiques de tendances islamistes du courant des frères musulmans qui ont opéré un tournant allant des discours refusant la démarche du régime à une collaboration active avec lui, par l'appel à la participation aux élections législatives prévues pour le 12 juin prochain, sans aucune vision claire pour sortir de l'impasse actuelle, conformément aux revendications légitimes de la jeunesse du Hirak, dont l'essence était et reste: Yetnahaw Gaâ («qu'ils partent tous»), sans atteinte aux fondements de l’État, qui de ce fait nécessite une réforme structurelle.