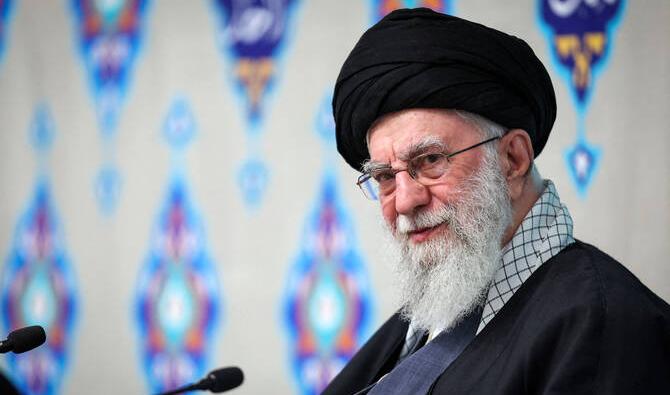DUBAÏ: La technologie a progressé à une vitesse vertigineuse au cours de la dernière décennie, avec de nombreux processus – du shopping et des opérations bancaires à la production énergétique et à la livraison – passant en ligne, permettant une économie de temps et de main- d'œuvre, tout en améliorant l'accessibilité.
Cependant, toutes ces avancées entraînent également une série de nouvelles menaces, notamment celles qui cherchent à tirer profit de contrôles de cybersécurité centralisés et obsolètes, entraînant une augmentation des cyberattaques et des activités criminelles en ligne.
Alors qu’une part croissante de l’économie mondiale se tourne vers le cyberespace, la lutte contre la menace internationale en matière de cybersécurité devrait coûter au monde 10,5 trillions de dollars (un dollar = 0,91 euro) par an d’ici à 2025.

Les pays du Moyen-Orient ne font pas exception à cette règle et semblent particulièrement vulnérables aux cyberattaques contre des infrastructures essentielles comme les champs de pétrole et de gaz, les centrales électriques, les ports et les aéroports, compte tenu du rôle vital joué par la région dans la production énergétique mondiale.
Une analyse réalisée en 2022 par la société de cybersécurité Kaspersky a montré que le Moyen-Orient était l'une des cinq régions du monde ayant cette année-là le pourcentage le plus élevé de logiciels malveillants bloqués dans les systèmes de contrôle industriel.
Deux ans plus tôt, les données d'IBM montraient que le coût moyen d'une cyberattaque contre des institutions aux Émirats arabes unis (EAU) et en Arabie saoudite s'élevait à 6,53 millions de dollars, soit environ 69 % de plus que la moyenne mondiale.
EN CHIFFRES
105 trillions de dollars
Alors qu’une part croissante de l’économie mondiale se tourne vers le cyberespace, la lutte contre la menace internationale en matière de cybersécurité devrait coûter au monde 10,5 trillions de dollars par an d’ici à 2025.
Le deuxième trimestre 2022 a vu augmenter de 168 % de la fréquence des attaques d’hameçonnage, de piratage et des escroqueries en ligne en Arabie saoudite par rapport au trimestre précédent.
«Il est vrai qu'il y a eu une augmentation de la fréquence des cyberattaques ciblant l'Arabie saoudite, mais il est essentiel de souligner que cette tendance s’inscrit dans le cadre d'une augmentation mondiale plus large des activités illicites dans l'espace numérique», affirme à Arab News Achraf Koheil, directeur régional pour le Moyen-Orient, l’Afrique et la Turquie de la société de cybersécurité Group-IB.
«Les entreprises et les institutions de tous les secteurs et de toutes les régions doivent faire face à un nombre croissant d'attaques d’hameçonnage, de tentatives de rançongiciel et d'escroqueries», ajoute-t-il.

Achraf Koheil estime que les racines de l’activité cybercriminelle sont souvent liées à des facteurs socio-économiques. «Le royaume saoudien est une puissance économique mondiale qui connaît une transformation numérique incroyablement rapide ayant créé une multitude d’emplois et d’opportunités», explique-t-il.
«Dans ce contexte, on pourrait s’attendre à ce que les cybercriminels tentent d’en profiter pour inciter certaines personnes à interagir sans le savoir avec des pages d’hameçonnage ou des sites Web frauduleux pour obtenir un gain financier illicite.»
EN BREF
• Les données d'IBM pour 2020 ont montré que le coût moyen d'une cyberattaque contre des institutions aux Émirats arabes unis et en Arabie saoudite était de 6,53 millions de dollars, soit environ 69 % de plus que la moyenne mondiale.
• Les modèles d'IA générative ont réduit le coût et la difficulté des attaques d’hameçonnage, ce qui rend les pays arabophones comme l'Arabie saoudite particulièrement vulnérables.
Un autre facteur déterminant est l’augmentation spectaculaire de l’utilisation des plates-formes de commerce électronique par la population saoudienne ces dernières années.
Safwan Akram, directeur des services de sécurité pour l'Arabie saoudite auprès du fournisseur de cybersécurité Help AG, affirme que de plus en plus de consommateurs effectuent la majorité de leurs achats en ligne, les revenus du commerce électronique devant afficher un taux de croissance annuel composé de 13,5 % entre 2023 et 2027, selon les données d'ecommerceDB.
«Cela constitue une cible attrayante pour les acteurs nocifs cherchant à obtenir des informations telles que les identifiants des utilisateurs et les détails de leurs comptes bancaires», assure-t-il à Arab News.

En outre, le coût et la difficulté de mener une attaque d’hameçonnage ont considérablement diminué grâce à l’émergence de modèles d’intelligence artificielle générative, ce qui rend les pays arabophones comme l’Arabie saoudite particulièrement vulnérables.
«Auparavant, les pirates informatiques étaient limités dans leur capacité à cibler les résidents du Royaume avec des e-mails d’hameçonnage, un grand nombre d’entre eux ne sachant pas écrire en langue arabe. Cependant, grâce aux modèles d’IA générative, ils peuvent désormais générer d’un simple clic des e-mails et des messages d’hameçonnage bien rédigés et apparemment fiables dans diverses langues», note Safwan Akram.
«L'Arabie saoudite a mené son parcours de numérisation en donnant la priorité à la cybersécurité... à mesure que les frontières de la numérisation et de la technologie s'étendent, les cyberattaques surviennent également, en raison de nouvelles vulnérabilités.»
Mohammed Hachem, directeur général de Kaspersky pour l’Arabie saoudite et Bahreïn
L’Arabie saoudite comprend une communauté fintech grandissante, avec l’apparition de nombreuses nouvelles entreprises, réglementées par la Banque centrale saoudienne.
«Un grand nombre de ces sociétés de technologie financière sont des start-up qui ne disposent peut-être pas d'un système de cybersécurité élaboré par rapport aux entreprises bien établies, ce qui les rend vulnérables aux attaques», indique Safwan Akram.
Dans cette optique, les pays du Golfe, qui constituent des cibles évidentes pour les pirates informatiques du monde entier, travaillent de manière assidue avec les prestataires de cybersécurité du secteur public pour protéger leurs infrastructures.

Le marché de la cybersécurité au Moyen-Orient et en Afrique devrait atteindre 36,2 milliards de dollars d'ici à 2028, avec un taux de croissance annuel composé de 10,2 % au cours des cinq prochaines années, selon un nouveau rapport publié par MarketsandMarkets.
«L'Arabie saoudite a mené son parcours de numérisation en donnant la priorité à la cybersécurité», affirme à Arab News Mohammed Hachem, directeur général de Kaspersky pour l'Arabie saoudite et Bahreïn.
Cela se reflète dans la création dans le pays d’entités telles que le Global Cybersecurity Forum Institute et l’Autorité nationale saoudienne de cybersécurité, qui sont responsables de l’élaboration, de la mise en œuvre et de la supervision des stratégies de sécurité.
Depuis leur création, ces institutions ont lancé de nombreuses initiatives en matière de cybersécurité, notamment la Fédération saoudienne pour la cybersécurité et l’Académie nationale pour la cybersécurité.
Cette année, ces initiatives ont permis au Royaume d'obtenir la deuxième place dans l'indice mondial de cybersécurité du World Competitiveness Yearbook, un classement créé par l'Institut international pour le développement de la gestion, ou IMD, basé en Suisse.
Les derniers rapports de Kaspersky montrent également une diminution de 1 % des attaques d’hameçonnage en Arabie saoudite au cours du premier trimestre 2023 par rapport à la même période de 2022.
Mohammed Hachem estime que cette diminution pourrait être le résultat des mesures dynamiques prises par le gouvernement et les institutions saoudiennes pour mettre en œuvre des mesures de cybersécurité strictes et investir dans la technologie appropriée, afin de protéger leurs systèmes et données contre les cybermenaces.
«Cependant, on peut noter qu'à mesure que les frontières de la numérisation et de la technologie se développent, les cyberattaques surviennent également, en raison de nouvelles vulnérabilités», ajoute-t-il. Ces vulnérabilités sont couramment exploitées par les cybercriminels, entraînant une augmentation des attaques d’hameçonnage, de piratage et des escroqueries en ligne.
«Les techniques d'ingénierie sociale qui s'appuient sur les émotions humaines telles que la peur, l'avidité, la curiosité et l'enthousiasme sont couramment utilisées par les cybercriminels pour manipuler les gens», fait remarquer Mohammed Hachem.
Il précise que l’hameçonnage, les leurres, le spam de contacts et le piratage d’e-mails sont des formes courantes de techniques d'ingénierie sociale utilisées pour tromper les individus et obtenir un accès non autorisé à l'information, le vol d'identité et d'autres informations personnelles.
Les attaques d’hameçonnage répondent au même schéma: l’envoi d’un e-mail et d’un message instantané ou un SMS prétendant provenir d'une source fiable demandant des informations. Le mécanisme de leurre consiste lui à créer un piège pour exploiter la curiosité d'un individu, généralement via une clé USB chargée de logiciels malveillants ou un e-mail proposant des offres exceptionnelles via une pièce jointe.
Bien que les gouvernements régionaux et les banques disposent de ressources suffisantes et de mesures pour accroître le niveau de sensibilisation aux attaques d’hameçonnage financier et aux escroqueries en ligne, des lacunes en matière d'éducation et de sensibilisation existent toujours.
«Le fait que nous constatons de plus en plus de ces attaques d’hameçonnage indique qu'elles sont efficaces et réussies, ce qui signifie qu'il y a encore du travail à faire en matière de formation et de sensibilisation», constate à Arab News Renze Jongman, responsable du renseignement auprès de la société de cyberdéfense Mandiant.
Selon le rapport Global Perspectives on Threat Intelligence de Mandiant, 44 % des personnes interrogées ont déclaré que leur institution avait subi une cyberattaque importante au cours des douze derniers mois.
Le rapport indique également que 98 % des personnes interrogées estiment qu'elles doivent plus rapidement mettre en œuvre les changements basés sur les informations disponibles concernant les menaces.
Comme pour tout autre crime, le piratage informatique, l’hameçonnage et les escroqueries en ligne augmentent en fréquence s'ils réussissent, soutient Renze Jongman.
Il indique que l’un des principaux facteurs encourageant la cybercriminalité est l’existence de réseaux de «cybercriminalité en tant que service», c’est-à-dire des groupes qui opèrent de manière professionnelle et à grande échelle pour faciliter la création de campagnes d’escroquerie en ligne.
«L’impunité quasi-totale ou la possibilité de rester presque anonyme sur Internet, l'ampleur du problème et la nature transnationale de la cybercriminalité en font un type de crime difficile à enquêter et à poursuivre en justice», affirme Renze Jongman.
Il souligne également que les cybercriminels opèrent en sachant qu'il n'y a qu'une très faible chance qu'ils aient à faire face aux conséquences de leurs actes. De plus, cibler des entreprises ou des secteurs spécifiques permet aux cybercriminels de se concentrer sur des cibles de grande valeur, et aux acteurs de l'espionnage de collecter des informations classifiées et confidentielles sur des sujets très spécifiques, observe Renze Jongman. «Ainsi, les personnes à la recherche d'un nouvel emploi parleront volontiers du travail qu'elles ont accompli auparavant.»
Cependant, en surveillant de manière active de telles menaces, les entreprises peuvent protéger à la fois leur marque et leurs clients. Les entreprises qui réussissent le mieux à se protéger contre ces menaces utilisent les veilles sur les menaces pour détecter ces attaques et y répondre lorsqu'elles se produisent.
De ce fait, ces institutions s’arment de la connaissance de ce dont elles se défendent, ce qui leur permet d’agir de manière préventive.
«Des réflexes simples, comme vérifier les signaux d’alerte dans un e-mail, surveiller les fautes de frappe dans un e-mail ou un texte, ou utiliser un antivirus, peuvent être d'une grande aide», affirme Mohammed Hachem, de Kaspersky. «L'ignorance ne fait pas le bonheur lorsque la cybercriminalité domine votre vie en ligne et hors ligne.»
Ce texte est la traduction d’un article paru sur Arabnews.com