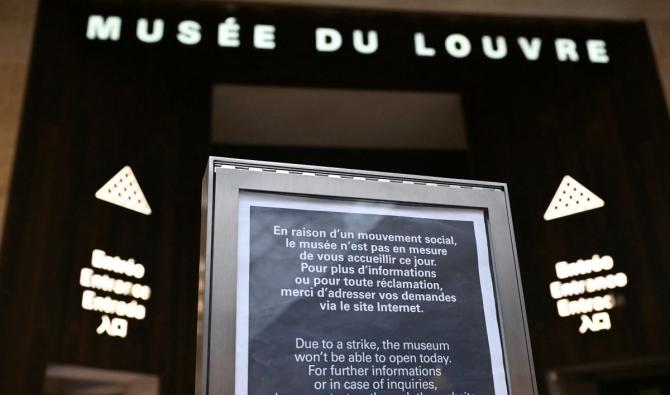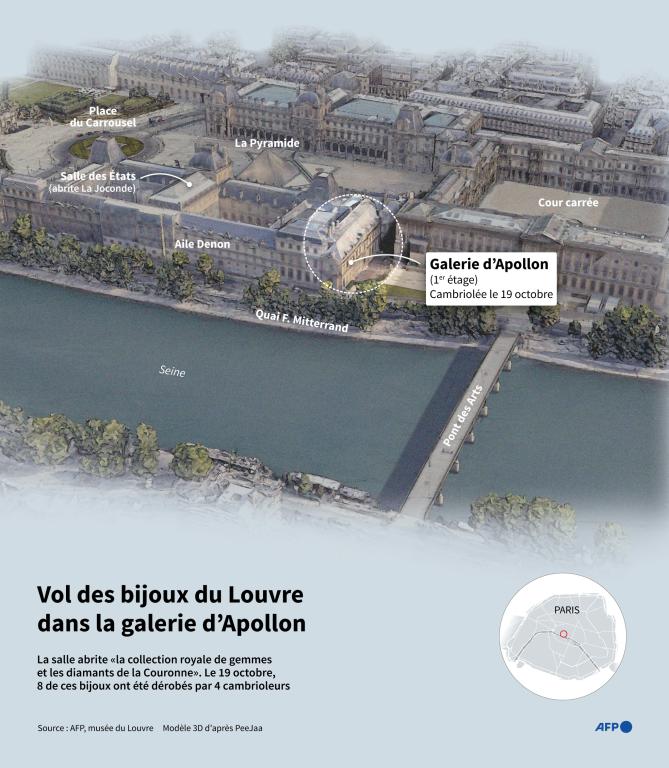PARIS: En marge d’une réunion du Conseil de défense et de sécurité nationale (CDSN), tenue ce mercredi 21 mai, le gouvernement français a dressé un état des lieux de sa lutte contre le séparatisme et mis en lumière une menace émergente: l’entrisme islamiste.
Ce conseil avait un double objectif: évaluer les dispositifs antiséparatistes existants et les ajuster si nécessaire, mais aussi définir une stratégie ciblée face à cette nouvelle forme d’infiltration jugée plus discrète mais tout aussi préoccupante. Pour y répondre, les autorités prévoient la mise en place d’outils spécifiques: détection, blocage, judiciarisation, et sensibilisation accrue des élus locaux.
À la différence du «séparatisme», concept désormais bien installé dans le débat public depuis près de trois ans, l’entrisme désigne une infiltration progressive et silencieuse des institutions. Selon l’Élysée, cette évolution appelle une réponse ferme et structurée.
Cette stratégie s’appuie sur un rapport classé confidentiel, commandé en 2024 par le président Emmanuel Macron à deux hauts fonctionnaires. Partiellement révélé ce jour, le document souligne qu’«aucun élément récent ne prouve la volonté d’instaurer un État islamique en France, ni d’y appliquer la charia», mais alerte sur un «risque frériste bien réel».
Le rapport pointe notamment le danger d’un islamisme municipal, idéologiquement hétérogène mais fortement militant et soutenu par des financements étrangers, ce qui en fait une préoccupation stratégique majeure pour les autorités françaises.
Sur 2 800 lieux de culte musulmans en France, 207 lieux sont identifiés comme étant affiliés ou proches des Frères musulmans, et le rapport indique que des «écosystèmes islamistes» représentés par des «cours d’éducation coranique» ou d’associations caritatives, culturelles ou sportives, gravitent autour de ces lieux.
Le rapport pointe la paupérisation comme facteur favorisant la création de ces écosystèmes «qui répondent à des besoins de la population, et «à mesure que l’écosystème se consolide», des normes comme le port du voile et de la barbe s’imposent.
Une attention particulière est par ailleurs portée au système éducatif: le rapport indique que sur 74 établissements scolaires musulmans, cinq seulement sont sous contrat avec l’État.
De plus, le rapport pointe du doigt «l’importance croissante des influenceurs» islamistes et des prédicateurs sur les réseaux sociaux, et estime qu’ils représentent une «menace pour la cohésion sociale».
Pour rédiger ce rapport, les deux hauts fonctionnaires ont mené un vaste travail de terrain, se déplaçant dans plusieurs départements français ainsi que dans quatre pays européens. Ils ont conduit plus de 2 000 auditions, rencontrant des universitaires, des acteurs institutionnels et des responsables musulmans.
Sur la base des constats et témoignages recueillis, ils formulent une série de recommandations, dont la principale consiste à mieux appréhender la menace que représente l’islamisme politique, en particulier à travers la stratégie insidieuse des Frères musulmans. Le rapport souligne que leur projet, souvent discret et graduel, vise à «porter atteinte aux intérêts fondamentaux de la nation».
Pour y faire face, les auteurs appellent à un effort renforcé d’éducation du public et des décideurs, notamment sur les principes de la laïcité, une meilleure compréhension de l’islam et la reconnaissance des formes contemporaines du séparatisme.
Le rapport recommande en outre de renforcer la recherche académique française sur l’islam et l’islamisme, afin de contrer ce qu’il décrit comme une «islamisation de la connaissance» menée par les courants fréristes. Cette stratégie viserait, selon le document, à légitimer des concepts comme celui d’«islamophobie», utilisés pour délégitimer la critique ou les actions de l’État.
Le rapport met le doigt sur un point essentiel en proposant de mieux répondre au malaise des musulmans de France, dans «un contexte où l’Islam reste évoqué sous un angle négatif».
Il préconise le développement de l’apprentissage de l’arabe à l’école, afin que cet apprentissage ne soit plus le monopole des écoles coraniques.
Il appelle à reconnaître que le sentiment d’une «islamophobie d’état» est attisé par le soutien de la France à Israël dans la guerre à Gaza, et estime que la reconnaissance d’un État palestinien pourrait «apaiser ces frustrations».
À son arrivée à l’Élysée en 2017, Emmanuel Macron s’est immédiatement confronté à deux chantiers majeurs: le chômage et le terrorisme.
Si des réformes économiques ont été engagées pour redresser l’emploi, la lutte contre l’islamisme radical s’est traduite par une série de mesures d’urgence et de long terme.
Dès les premiers mois, le gouvernement prolonge l’état d’urgence puis adopte la loi SILT (sécurité intérieure et lutte contre le terrorisme), renforçant les moyens de surveillance et d’intervention, avec pour objectif de prévenir tout passage à l’acte sur le sol national.
Entre 2018 et 2020, la stratégie antiséparatisme s’est d’abord appuyée sur le maillage du territoire. Des «quartiers de reconquête républicaine» ont été créés, avec des actions ciblées: fermeture de lieux de culte, de structures associatives ou commerciales soupçonnées de dérives communautaires.
En 2021, cette démarche s’est structurée avec l’adoption de la loi confortant les principes républicains (loi CRPR).
Appliquée quotidiennement par les préfets, elle a permis un contrôle rigoureux d’écoles, de clubs sportifs, de commerces ou encore d’associations cultuelles.
En août 2024, 150 structures ont ainsi été inspectées, avec 30 fermetures à la clé et 20 signalements judiciaires.
Par ailleurs, 5 associations ont été dissoutes pour motifs séparatistes, et 15 fonds de dotation ont été visés par des mesures spécifiques.
Sur le plan judiciaire, 500 personnes ont été mises en cause au titre de la loi CRPR, avec 280 sanctions pénales, dont 25 condamnations pour endoctrinement – cette pratique d’exposition publique dénoncée après l’assassinat de Samuel Paty.
Cette vigilance accrue s’inscrit dans un contexte sensible à l’approche des élections municipales, car, souligne l’Élysée, il est important d’éviter toute dérive, tout en respectant scrupuleusement les libertés fondamentales.
Face à ces enjeux complexes, le président Macron réaffirme une distinction nette entre islam, islamisme et islamisme radical, et l’Élysée précise que le discours des Mureaux, prononcé en 2020, reste la référence doctrinale de cette ligne d’équilibre, «ni laxisme, ni amalgame».
Le président entend poursuivre ce travail avec les musulmans de France, et non contre eux, car ce sont bien eux, souvent, les premières cibles et victimes de ces dérives communautaristes.