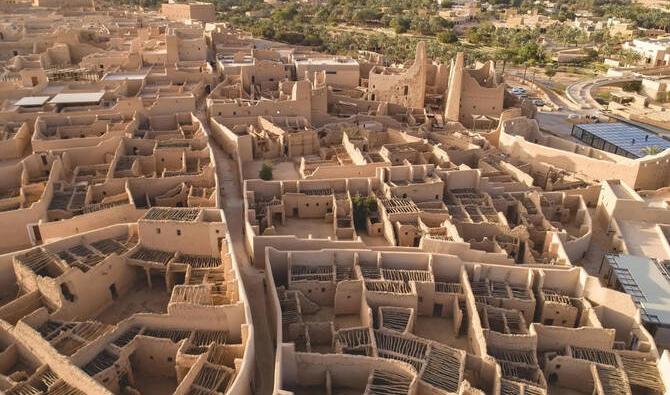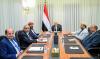DUBAÏ : Partout dans le monde, les industries créatives ont été touchées par les mesures de confinement imposées par la Covid-19. Ainsi, des événements ont été annulés, des artistes et des galeries ont subi des pertes financières. Alors que les initiatives locales au Moyen-Orient ont permis aux artistes professionnels de survivre aux conséquences financières les plus graves que cette pandémie a entraînées, le marché de l'art a lui-même été contraint de s'adapter aux nouvelles circonstances toutes particulières.
En effet, le marché mondial de l'art, qui représente une valeur annuelle de 64,1 milliards de dollars, selon la banque d'investissement multinationale suisse UBS, était en croissance constante ces dernières années, avant que la propagation du coronavirus ne contraigne les galeries à fermer boutique. Ceci a interrompu les ventes et les expositions et anéanti le pouvoir d'achat des collectionneurs.
UBS et Art Basel ont publié le rapport « Impact de la Covid-19 sur le secteur des galeries » (The Impact of Covid-19 on the Gallery Sector) qui a interrogé un échantillon de 795 galeries et 360 collectionneurs des États-Unis, du Royaume-Uni et de Hong Kong. Selon cette étude, la pandémie a entraîné une baisse de 36 % des ventes des galeries d'art moderne et contemporain, avec une baisse moyenne de 43 % en comparaison avec les six premiers mois de 2019.
Les plus petites galeries, dont le chiffre d'affaires ne dépasse pas 500 000 dollars, ont connu la plus forte baisse de ventes. Bon nombre d'entre elles ont réduit leurs effectifs et licencié du personnel. Les constatations recueillies semblent révéler une baisse des ventes dans plusieurs industries de produits de luxe au cours de l'année.
En raison des restrictions de déplacement et des verrouillages qui ont entraîné la fermeture de leurs établissements, les galeristes ont dû concevoir de nouveaux moyens pour vendre leur art et promouvoir leurs artistes, y compris par le biais de foires virtuelles. Même si les galeristes se montrent réticents à l'égard de l'efficacité des foires virtuelles, il semble que celles-ci resteront en place dans l'avenir proche, en attendant que les événements physiques puissent être organisés en toute sécurité.
En revanche, dans le monde des ventes aux enchères, le passage au numérique n'a pas eu un impact significatif sur les ventes. Les vendeurs demeurent avides de se séparer de leurs objets de valeur et les acheteurs ont toujours le même appétit.
Prenons l'exemple de la vente en ligne d'art contemporain organisée par Sotheby's à la fin du mois de juin. Les acheteurs ont payé un prix exorbitant pour bon nombre d’œuvres. Ainsi, un tableau de Jean Michel Basquiat s'est vendu à 15 millions de dollars et un triptyque de Francis Bacon à près de 85 millions de dollars.
Au Moyen-Orient aussi, les ventes aux enchères se sont déroulées dans un climat positif. En 2020, 52 % des ventes aux enchères menées par Sotheby's dans la région du Moyen-Orient et de l'Afrique du Nord concernaient exclusivement des ventes en ligne - un pourcentage calculé sur la base de six ventes en ligne et de deux ventes en direct. En 2019, sept ventes aux enchères ont été faites en direct et aucune en ligne, contre cinq en direct et aucune en ligne en 2018.

« Cela ne signifie pas qu'il n'y a pas eu assez de soumissions et d'achats en ligne lors de ces ventes », confie à Arab News Edward Gibbs, le président de Sotheby's pour le Moyen-Orient et l'Inde. « Pourtant, l'année 2020 a été marquée par des changements radicaux, dont les impacts perdureront à l'avenir ».
Le mode numérique a été introduit précédemment, mais c'est la pandémie qui lui a donné toute son importance. « Historiquement, le marché de l'art a mis du temps à intégrer le commerce électronique ; néanmoins, les constatations indiquent que les choses ont changé en raison de la crise », comme l’indique le rapport publié par Art Basel et UBS.
En effet, au cours du premier semestre de 2020, les ventes en ligne constituaient 37 % du total des ventes des galeries - contre 10 % en 2019. Sur les collectionneurs interrogés dans le rapport, 85 % au moins disent avoir consulté en ligne les galeries ou les foires, et un peu moins de la moitié d'entre eux ont déjà effectué un achat en ligne.
Environ 66 % des galeries interrogées prévoient que les ventes en ligne dans le secteur des galeries continueront à augmenter en 2021.
Le marché de l'art en chiffres
* La valeur annuelle du marché de l'art dans le monde est estimée à 64,1 milliards de dollars.
* Baisse de 36% des ventes des galeries en comparaison avec les 6 premiers mois de 2019.
* En 2020, 52 % des ventes aux enchères menées par Sotheby's dans la région du Moyen-Orient et de l'Afrique du Nord concernaient exclusivement des ventes en ligne.
Selon M. Gibbs, « parmi les nombreux avantages que l'on peut espérer cette année, figurent l'importance de l'innovation numérique et le pouvoir indéniable de l'art et des objets rares ». Il poursuit : « En ce qui concerne la technologie, Sotheby's a développé, au cours des dernières années, sa propre plateforme de vente en ligne. Lorsque le coronavirus a fait son apparition, nous avons donc réussi à élargir rapidement nos opérations et à intégrer de nouvelles catégories qui n'avaient jamais été proposées en ligne auparavant».
« Les clients du Moyen-Orient ont toujours été parmi les plus avertis en matière de technologie », dit-il.
« Notre première vente en ligne a été lancée depuis Dubaï, de même que notre toute première vente en ligne d'art moderne et contemporain arabe et iranien », ajoute M. Gibbs.
« Ce fut également le cas des marchés plus traditionnels, comme l'art islamique par exemple. Lors de notre plus récente vente physique des Arts du monde islamique et de l'Inde, plus de la moitié des enchérisseurs ont effectué les transitions en ligne ».

La maison de vente aux enchères Christie's partage ce sentiment. Dans un entretien accordé à Arab News, Caroline Louca-Kirkland, directrice générale de Christie's Middle East, a déclaré que « les ventes en ligne sont en très bonne forme ». « Nous avons accueilli un grand nombre de nouvelles inscriptions ou de nouveaux clients qui se sont inscrits en ligne ».
En novembre 2020, Christie's Middle East a célébré sa 15e saison de ventes d'automne en lançant trois ventes aux enchères en ligne. L'une d'entre elles était intitulée « We Are All Beirut » (Nous sommes tous Beyrouth), une initiative caritative visant à fournir des secours à la communauté artistique et à la soutenir, dans la capitale libanaise, dans le sillage de l'explosion du port, le 4 août. Plus de 680 000 dollars ont été collectés lors de cet événement dans le but de relancer la communauté artistique et culturelle de la ville, notamment le musée historique de Sursock à Beyrouth.
« C’était un véritable défi d’organiser des ventes aux enchères en ligne sans visites durant le verrouillage et les restrictions de voyage. Pourtant, les résultats sont encourageants », explique Mme Louca-Kirkland. « Nous avons battu le record avec une pièce de l'artiste Samia Halaby (542 000 dollars) et réalisé un montant impressionnant (406 000 dollars) pour une œuvre réalisée en 1982 par le défunt maître marocain Mohamed Melehi. Par ailleurs, nous avons battu le record avec la pièce « Ouroboros » de Ranya Sarakbi (406 000 dollars) dans notre section consacrée au design».
Christie's a remarqué un vif intérêt de la part des collectionneurs libanais concernant sa vente de charité consacrée à Beyrouth. « Cependant, les restrictions sur les virements en provenance du Liban ont empêché les collectionneurs de Beyrouth de participer à cette vente », précise Mme Louca-Kirkland.
« Le marché de l'art au Liban pâtit des restrictions bancaires imposées actuellement ainsi que du contexte politique du pays. Tout comme le marché iranien est affecté par les sanctions persistantes et d'autres embûches géopolitiques ».

Dans d’autres régions du Moyen-Orient, le marché se montre plus prometteur. « Le marché de l'art est toujours aussi florissant. Nous observons en particulier un intérêt de plus en plus marqué pour l'art d'Afrique du Nord, et accueillons de nouveaux acheteurs de cet art via la plateforme en ligne », poursuit-elle. Néanmoins, « nous devons soutenir l'art iranien et libanais en ces temps difficiles ».
Christie's Middle East entend organiser sa vente d'art annuelle à Londres au mois d'octobre.
En outre, les collectionneurs ne voient pas dans les plates-formes en ligne un moyen idéal pour interagir avec les artistes et les galeries, même si elles ont été largement utilisées au cours de la pandémie.
Sur les collectionneurs interrogés par l'enquête d'Art Basel et d'UBS, 70 % préfèrent assister aux expositions ou foires en personne ou hors ligne, contre 30 % qui optent pour des expositions en ligne ou d'autres plates-formes numérique.
En dépit des restrictions actuellement imposées, environ 82 % des collectionneurs ont exprimé leur intention d'assister à des expositions, des foires et des événements au cours des douze prochains mois. Si les formats numériques ont gagné du terrain durant la pandémie, il ne faut pas s'attendre à voir disparaître de sitôt le monde physique des galeries et des ventes aux enchères.
Twitter : @rebeccaaproctor
Ce texte est la traduction d'un article paru sur Arabnews.com