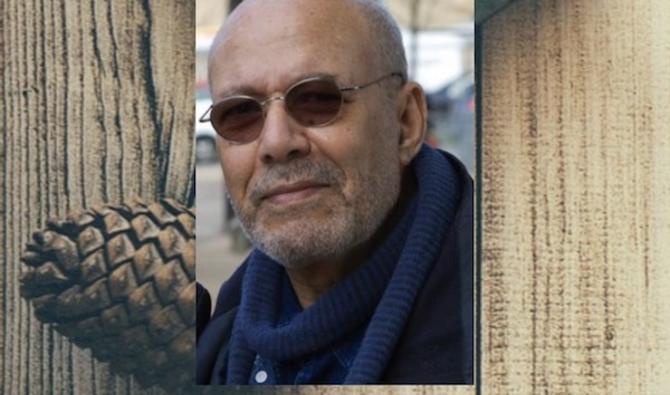PARIS : Chaque mot est un voyage. Vestige du passé ou marqueur de l’évolution des mœurs, chacun des mots de notre vocabulaire est né des soubresauts et voltiges de l’histoire.
Le français, langue romane issue du peuple germain, n’est autre que le fruit d’un merveilleux métissage. En ce 20 mars 2020, à l’occasion de la journée de la Francophonie, Salah Guemriche, essayiste et romancier algérien dévoile à Arab News en Français des facettes insoupçonnées de la langue de Molière.
Après un rigoureux travail de recherche qui a duré 4 ans, l’auteur a fait un constat étonnant : sur les 35 000 mots du français courant, 10% sont issus de l’arabe. Une donnée surprenante qui illustre le caractère hybride de cette langue parlée dans plus de 50 pays.
En effet, comme l’explique M. Guemriche dans son livre « Dictionnaire des mots français d’origine arabe», 4192 mots du français viennent des langues étrangères «25% de l’anglais, 16% de l’italien, 13% du germanique et 10% de l’arabe».
Dans son recueil, l’auteur recense 400 mots d’origine arabe employés dans la vie de tous les jours. Cet état de fait indique qu’il existe plus de mots arabes que de mots d’origine gauloise ou espagnole dans le français, qui est pourtant une langue indo-européenne !
Dans cet entretien exclusif, Salah Guemriche partage sa vision de la francophonie et ses futurs projets, et explique avec passion et minutie l’évolution des mots, leur étymologie et leur origine lexicographique, tout en dévoilant la poésie qui se cache derrière chaque signification.
Quel regard portez-vous sur la francophonie ? Par rapport au passé, pensez-vous que l’usage du français a effectivement régressé au Maghreb ?
Toute langue est la bienvenue, puisqu’elle constitue une ouverture sur le monde. Le français a été mon arme, mon moyen d’expression. C’est cette langue qui m’a permis de rencontrer Simone de Beauvoir en 1971, c’est grâce à elle et à sa palette de mots que j’exprime mes idées avec nuance et précision. Il est vrai que l’arabe recule dans les pays du Moyen-Orient. Au Maghreb, spécifiquement en Algérie, ceci s’explique par le lourd passé qui lie ce pays à la France.
Il y a une volonté toujours visible de se détacher des anciens colons. Moi je pense qu’il faut dépasser ces différends, aller de l’avant, tourner la page. Comme le disait l’écrivain Kateb Yacine, «le français est notre butin de guerre». L’arabisation qui a été menée au lendemain de l’indépendance n’a pas suffi à enrayer l’usage du français, même 50 ans plus tard. En 2019, la politique d’arabisation a été durcie. Je pense que c’est une erreur, deux langues peuvent coexister. Et comme je l’ai prouvé avec l’aide de l’éminente linguiste Henriette Walter, les langues s’entremêlent et se complètent. L’arabe a, d’une certaine façon, permis au français de se réinventer. Je suis convaincu que lorsque le travail sur la mémoire collective de la guerre d’Algérie sera achevé, et donc que les esprits rancuniers seront apaisés, le français retrouvera sa place… Même si l’anglais devient la langue internationale de référence, je pense que la francophonie a encore de beaux jours devant elle… !
Que pensez-vous des déclinaisons de la langue française dans le monde (québécois, belge, français mélangé à la «darija» etc.) ?
Je considère qu’il y a «des» français, et non pas un seul français. Toutes les déclinaisons du «français de France» sont légitimes.
Saviez-vous que face à l’anglicisme, les plus fervents défenseurs de la francophonie sont les Québécois ? Ils disent «envoyer un courriel» (contraction de e-mail et courrier) et non pas un «mél» ou «mail».
L’arabe, emprunte lui aussi, des mots au français et à l’anglais. Surtout pour des termes techniques et – ou informatiques. Pourtant l’arabe a cette richesse de vocabulaire qui lui permet de créer ses propres néologismes. Les linguistes arabes ne sont pas allés au bout de leurs travaux, il faudrait effectivement vivifier le langage. C’est la «darija», les dialectes qui jouent aujourd’hui ce rôle. J’estime que chaque dialecte, du libanais à l’algérien, en passant par le mauritanien constitue une langue à part.
Votre livre, «Dictionnaire des mots français d’origine arabe» a permis de reconsidérer le lien entre le français et l’arabe. Qu’est-ce qui vous a poussé à travailler sur cette problématique ?
Je voulais d’abord rédiger un petit répertoire ludique pour mon fils, et plus je plongeais dans l’histoire des mots plus je me suis rendu compte que l’on nous cachait des choses…
Bien avant le 19ème siècle, siècle des colonisations, Rabelais qui avait appris l’arabe dans le cadre de ses études en médecine, avait déjà pointé du doigt la présence de mots arabes dans langue française.
Nous pouvons situer le début de l’influence de l’arabe dans le français avec la conquête de l’Andalousie. Ces territoires ont été sous domination musulmane de 711 à 1492.
Les mots se sont donc diffusés avec les échanges commerciaux et académiques, ce qui explique pourquoi la plupart d'entre eux appartient au champ lexical de la gastronomie et du textile.
Les étymologistes ont-ils amoindri l’influence de l’arabe sur la langue française ?
Oui. Tout à fait. Il y a une volonté d’occulter l’origine de certains mots. L’origine persane des mots est par ailleurs davantage mise en avant que l’origine arabe, pour des questions idéologiques, puisque le perse fait partie des langues indo-européennes.
Les étymologistes ont fait des tours et des détours, en passant par le latin et l’italien, pour expliquer l’origine des mots. Or, dans certains cas, ils camouflent les origines arabes.
Le mot magasin en est le parfait exemple. Il ne vient pas du latin ou de l’italien comme certains experts l’avaient démontré, mais directement de l’arabe, spécifiquement du mot «makhāzin» qui signifie «dépôt». L’histoire de ce mot est d’ailleurs fabuleuse, puisqu’il a également donné naissance au terme «magazine» (publication périodique), en passant par l’anglais ! Jeanne Marie Le Prince de Beaumont (auteur de la Belle et La Bête) publie en 1750-51 des traités d’éducation qu’elle appelle «magasin» : «Le Magasin des enfants», et «Le Magasin des adolescentes». En se faisant connaître au Royaume-Uni, elle popularise le mot «magasin», qui à l’anglaise, se prononce «magasine»… et c’est ainsi que le concept de magazine tel qu’on le connaît aujourd’hui a vu le jour. En 2021, en France, vous pourrez lire sur des enseignes «magasin de discount». Dans cette phrase, c’est uniquement la préposition «de», qui est issue du français ! Les mots voyagent, ils se bousculent, se refaçonnent et se réinventent…
Voici quelques exemples intéressants …
- Abricot : le suffixe a- vient de l'article arabe «al», et le reste vient de de «al-barquq» qui veut dire en arabe «fruit précoce».
- Baroudeur : vient du mot arabe «barud», qui signifie poudre explosive. Ce mot a pour ancêtre de l’expression «baroud d'honneur», qui est un combat livré pour conserver l'honneur.
- Sirop : vient de l’arabe «šarab» qui veut dire «boisson»
- Chiffre : en arabe, le chiffre zéro se prononce «sifr». Avec le latin, «sifr» est devenu chiffre, pour d’abord désigner le zéro, puis tous les autres chiffres.
- Matelas : vient de l’arabe «matrah» qui désigne les coussins de sol utilisés pour s’asseoir ou se coucher.
- Jupe : vient de l’arabe «jubbah», qui désigne un vêtement de laine pour homme. Le mot arrive en France XIIe siècle avec le mot italien «jupa», pour ensuite se transformer en jupe.
- Nouba : vient du dialecte algérien «nuba» qui veut dire «à tour de rôle». Cette expression était couramment utilisée par les officiers lors de leurs services de garde. Ce mot a ensuite désigné la musique jouée lors d’évènements importants.
- Café : vient du mot «qahwa» (café en arabe) qui a aussi donné les versions italienne «caffè», et turc «qahve»
Aujourd’hui, en France, environ un jeune sur trois utilise des mots arabes «remis au goût du jour». Que pensez-vous de ce phénomène ?
Je pense que ces mots sont essentiels, et j’estime qu’il faudrait les intégrer dans nos dictionnaires ! Ils sont le miroir du temps et de son évolution.
Ces nouveaux mots sont inventifs. Dans le langage des jeunes, 69% des mots employés sont créés de toute pièce, 18% sont en verlan, et l’arabe occupe la troisième place du podium à égalité avec le gitan, avec 3,5% des mots. L’anglais représente quant à lui 2,5%, l’argot français 1,5%, et l’africain 0,5%.
Je trouve les expressions dérivées de l’arabe spécialement intéressantes, puisqu’elles sont très imagées. «Avoir le seum» par exemple… C’est presque poétique ! Cette expression qui manifeste le ras le bol veut littéralement dire «avoir/injecter du venin». Il y a aussi «rabzouz» et toutes ses drôles de déclinaisons utilisées pour qualifier les «arabes», rabzouille (avec le suffixe français -ouille) rabzouzette, ou rabza, pour la version plus affectueuse. «Chouïa» qui signifie «un peu» vient tout simplement du mot arabe «chwayya» porteur du même sens, toubib vient de «tabib» et veut dire médecin dans les deux langues, «ça me fait dahak» pour dire «ca me fait rire», vient du verbe «dahaka» qui veut tout simplement dire «rire» en «rebeu» (arabe)! Et enfin, le très répandu verbe «kiffer», qui exprime le fait d’aimer quelque chose, d’y prendre du plaisir. Ce dernier est une déclinaison mélodieuse du mot arabe «kayf» qui signifie bien-être.
De plus en plus de jeunes issus de l’immigration souhaitent apprendre l’arabe. Que révèle le retour de cette langue sur le devant de la scène française ?
Comme l’a souligné Assia Djebar de l’Académie Française dans la préface de mon livre, «les jeunes, conscients d'être les héritiers d'un passé inventif, pourraient vivre décomplexés par rapport à leur société d'accueil.» C’est important, voire primordial, parce que ce constat devrait permettre aux jeunes de voir que la France a toujours été intimement liée au monde arabe.
Dans le contexte actuel où la question des identités est au cœur des débats, cette réalité doit être mise en avant. Je tiens d’ailleurs à souligner l’importance d’enseigner l’arabe dans les écoles, et je trouve la polémique autour de cette question complètement vaine. L’arabe est une langue étrangère comme les autres. Elle est d’ailleurs parlée dans de nombreux pays. Toute langue est une richesse, et doit être la bienvenue.
Sous l’impulsion du président Emmanuel Macron, le château de Villers-Cotterêts sera rénové et transformé en Cité de la Francophonie d'ici 2022. En quoi consiste ce projet auquel vous participez ?
Il s’agit d’un projet formulé par l’État français pour faire du château de Villers-Cotterêts, une ville située à 80 km au nord-est de Paris, «un lieu de création, d’innovation et de diffusion de la culture en langue française dans le monde». Pourquoi Villers-Cotterêts ? Il faut rappeler que ce nom est attaché à une ordonnance royale de François 1er qui, en 1539, décréta que le français devait être la langue de la Justice et de l’Administration pour tout le royaume. En remplacement, donc, des langues régionales et du latin. On peut dire que la langue française comme langue nationale et officielle date de cette ordonnance. Pour la réalisation de ce qui s’appellera la «Cité de la francophonie», plusieurs associations et personnalités francophones ont travaillé à l’élaboration de projets structurants qui feront de Villers-Cotterêts une sorte de musée vivant et ouvert au monde, à tous les publics intéressés par l’histoire et l’évolution de la langue française, dans tous les domaines de la création. Ce projet associera les 88 pays membres de l’Organisation internationale de la Francophonie, ce qui représente 300 millions de francophones dans le monde. Ma participation sera axée sur les mots français venus d’ailleurs et ceux passés à d’autres langues, y compris dans le langage des « djeun’s » !
En plus de mon implication dans les projets liés à la francophonie, j’aimerais partager mon savoir et toucher plusieurs générations. Je vais donc lancer ma chaîne YouTube. J’y partagerai un contenu exclusif et ludique. Je parlerai aussi bien de la bataille de Poitiers, que de mes découvertes en matière de sémantique.