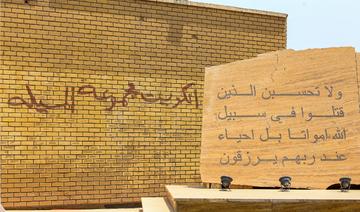BAGDAD: C'est une pieuvre dont les tentacules recouvrent des milliers de kilomètres de frontière, chaque dock ou terminal terrestre : en Irak, un cartel de partis politiques et de groupes armés siphonne droits de douane et importations, pour des montants vertigineux.
« C'est pire qu'une jungle parce qu'au moins, dans la jungle, quand les animaux sont repus, ils s'arrêtent. Ces gens-là n'en ont jamais assez », affirme un responsable des douanes.
Comme tous les fonctionnaires, officiels ou hommes d'affaires interrogés ces six derniers mois, l'homme accepte de parler uniquement si son identité n'est pas révélée car tous affirment risquer leur vie en s'exprimant.
Dans le 21e pays le plus corrompu au monde selon l'ONG Transparency International, les deux mamelles du système sont connues : froide bureaucratie et corruption endémique, deux phénomènes qui se sont amplifiés après l'invasion américaine ayant renversé Saddam Hussein en 2003.
Et le cadre est des plus adaptés : dans une économie pétrolière, sans industrie ni agriculture ou presque, les taxes douanières sont l'une des rares richesses à accaparer. Quant à l'Etat central irakien, il est régulièrement débordé par d'autres acteurs, politiques ou miliciens.
La « collusion entre officiels, partis politiques, gangs et hommes d'affaires véreux aboutit au pillage des fonds publics », reconnaît le ministre des Finances Ali Allawi.

Autant d'acteurs « imbriqués dans les rouages de l'Etat », renchérit Renad Mansour, chercheur de Chatham House. Et donc impossible à déraciner.
Directement chez les milices
En 2019 - le dernier chiffre officiel disponible -, l'Irak a importé pour 21 milliards d'euros de produits hors hydrocarbures, majoritairement d'Iran, de Turquie et de Chine.
Dans leur grande majorité, ces biens ont transité par les cinq terminaux officiels parsemant les 1 600 km de frontière avec l'Iran, par le seul poste-frontière couvrant tout aussi officiellement les 370 km de frontière avec la Turquie et par l'unique port d'Irak, Oum Qasr, à la pointe sud.
Là, selon la Banque mondiale, règnent « délais interminables, taxes élevées et abus ».
« Même en faisant tout dans les règles, ça dure un mois et on se retrouve à payer des frais de stationnement à trois zéros », rapporte un importateur basé au Moyen-Orient.
Alors, pour contourner la bureaucratie, les importateurs vont « directement voir les milices ou les partis » politiques, explique un agent du renseignement irakien. « Ils se disent qu'il vaut mieux perdre 100 000 dollars (en pot-de-vin) que toute une cargaison. »
En recoupant de longs entretiens avec différents acteurs, l’enquête est parvenue à établir que ce sont principalement des groupes du Hachd al-Chaabi, une coalition de paramilitaires pro-Iran intégrés à l'Etat, qui tiennent les terminaux terrestres et les docks d'Oum Qasr --l'endroit le plus corrompu d'Irak, selon ces sources.
Selon tous les acteurs irakiens rencontrés, c'est par exemple l'organisation Badr, puissante faction armée créée par d'ex-opposants à Saddam Hussein, qui tient Mandali, un poste-frontière avec l'Iran, pays où ils ont vécu en exil.
D'autres terminaux avec l'Iran sont tenus par d'autres factions du Hachd, comme Assaïb Ahl al-Haq et les brigades du Hezbollah, ajoutent-ils.
Des cigarettes ou des mouchoirs ?
Dans tous ces postes-frontières, partis et factions placent des douaniers, des inspecteurs ou des policiers. Ils facilitent le passage des cargaisons lorsque des importateurs les ont payés au préalable ou bloquent ceux qui ne seraient pas passés à la caisse, affirment les différents responsables.
Officiellement, le Hachd dément. Mais des sources proches d'Assaïb et des brigades du Hezbollah racontent le système de répartition, évoquant les mêmes docks ou terminaux cités par le douanier et l'agent du renseignement.
« Pour importer des cigarettes par exemple, il faut passer par le bureau des brigades du Hezbollah à Jadriya (un quartier de Bagdad, NDLR) et dire qu'on veut coopérer », avance cette source du renseignement.
Le maître des horloges de ce système huilé, c'est le « moukhalles », l'agent assermenté des douanes censé contrôler chaque cargaison. Or, « il n'y a aucun moukhalles sans affiliation » à un parti ou groupe armé, poursuit la même source.
Une fois soudoyés, ces agents doubles trafiquent les documents pour changer nature, quantité ou prix des produits et réduire ainsi les taxes.
Pour l'importateur interrogé, certains réalisent jusqu'à 60% d'économies. Un gain particulièrement intéressant sur les cigarettes --taxées à 30% sur leur valeur puis à 100% supplémentaires, pour protéger officiellement la production locale.
Souvent, les containers de cigarettes sont donc étiquetés « mouchoirs » ou « plastique », pour payer « 50 000 dollars au lieu de 65 000 » en taxes, rapporte le douanier.
Ecrasé par la «pyramide» de la corruption en Irak, Hassanein rêve de s'exiler
Pendant des mois, il a manifesté contre la corruption, déposé plaintes et recours, en vain. De guerre lasse, Hassanein Mohsen ne pense désormais plus qu'à une chose : quitter son pays, l'Irak.
« Ce n'est pas possible de vivre ici sans payer des pots-de-vin », assène ce père de quatre enfants dans sa maison de Kerbala, à 100 km au sud de Bagdad.
« J'ai fait tout ce que j'ai pu mais ce pays coule de plus en plus », affirme ce chômeur de 36 ans, alors que l'Irak est désormais à la 21ème place des pays les plus corrompus au monde selon Transparency International.
Il assure avoir déboursé plus de 1 000 dollars (environ 836 euros) en pots-de-vin pour renouveler son passeport, régulariser ses impôts ou simplement faire corriger des coquilles sur des documents d'identité.
Quand il s'est essayé à l'importation de meubles jordaniens, il a dû donner un lit, une armoire, des tables de chevet à un garde-frontière pour faire entrer en Irak sa cargaison --pourtant légalement enregistrée.
En Irak, toutes les étapes de la vie sont rythmées par la corruption : pour la naissance d'un enfant, il vaut mieux offrir un bakchich aux soignants pour être bien traité, pour construire sa maison, il faut s'assurer d'avoir graissé la patte de militaires pour qu'ils laissent passer béton et autres briques au check-point installé à l'entrée de chaque quartier...
Tout en haut, « des politiciens volent depuis des années l'argent destiné aux services publics », accuse Hassanein qui, lui, doit payer des compagnies privées « pour l'eau potable, l'électricité ou les soins médicaux ».
Dans ce pays, aux infrastructures détruites par les guerres à répétition ou tombées en ruines faute d'entretien, les générateurs pallient depuis des années aux longues heures de la journée où l'électricité nationale ne fonctionne pas. La santé, gratuite sous le régime du dictateur déchu Saddam Hussein, s'y paie à prix d'or dans des cliniques privées.
« Parfois je regrette, je me demande pourquoi je suis allé manifester », dit Hassanein, qui ne cache pas sa peur après l'assassinat et l'enlèvement de dizaines de militants ayant dénoncé le clientélisme et le népotisme dans le pays.
« Je reçois des appels menaçants de gens qui se présentent comme des agents du renseignement. Maintenant, je ne sors plus sans un pistolet. »
« Ce n'est pas normal »
Les moukhalles ont aussi le pouvoir de modifier la valeur d'une cargaison sur la licence d'importation.
Un responsable à Oum Qasr rapporte avoir vu passer une cargaison de barres métalliques tellement sous-évaluée que les taxes de plus d'un million de dollars avaient été ramenées à 200 000 dollars.
« On donne beaucoup trop de pouvoir aux douaniers, ce n'est pas normal », s'emporte l'importateur.
Parfois, rétorque l'agent des douanes, la pression est trop forte. « Je ne suis pas corrompu mais j'ai dû laisser passer des cargaisons sans inspection sous l'injonction de partis très puissants. »
Dans ce paysage, il arrive que la cargaison n'existe même pas. Des documents falsifiés sont présentés à la Banque centrale, qui autorise des paiements en dollars à des compagnies fantômes hors d'Irak.
De quoi alimenter le blanchiment d'argent, affirment le douanier et plusieurs responsables du secteur bancaire irakien.
Les pots-de-vin servent aussi à faire entrer des biens normalement interdits.
Un importateur avoue avoir payé 30 000 dollars à un douanier d'Oum Qasr pour faire entrer un équipement électrique reconditionné --alors qu'importer des produits d'occasion est illégal.
Il reconnaît également payer régulièrement un officier de police du port pour être prévenu des inspections « surprises ». Cet officier lui a même offert, en échange de plus d'argent, d'envoyer ces inspections chez la concurrence.

« Une vraie mafia »
De telles opportunités d'empocher des pots-de-vin... se vendent cher, commente le ministre Allawi.
« L'attribution de postes subalternes dans certains terminaux se négocie à 50 000 ou 100 000 dollars, parfois beaucoup plus », disait-il récemment lors d'une conférence publique.
Pour parvenir à leurs fins, élus et miliciens ont deux atouts : l'influence politique et la violence.
Un douanier de Mandali en a fait les frais. Il raconte avoir dû lever les scellés qu'il avait fait poser sur une cargaison venue d'Iran parce qu'un moukhalles faisait valoir son appartenance au Hachd pour l'obliger à obtempérer.
L'agent du renseignement confirme : même ses meilleurs informateurs craquent. L'un d'eux a cédé après de multiples suspensions administratives pour avoir bloqué des marchandises en provenance d'Iran au terminal de Zerbatiya, tenu par Assaïb Ahl al-Haq.
« Quand on est revenu, il était devenu membre d'Assaïb », témoigne-t-il.
Un haut responsable de l'Autorité des frontières raconte recevoir régulièrement des appels de numéros inconnus menaçant nommément ses proches.
« On ne peut rien dire parce qu'ils nous tueraient, tout le monde a peur », renchérit le douanier. « C'est une vraie mafia ».
Car il en va de la survie pour des partis et surtout des groupes armés qui ne peuvent plus allègrement piocher dans le budget de la Défense comme au temps de la guerre antijihadistes, affirme le chercheur Renad Mansour.
Comme la plupart sont pro-Iran, ils souffrent en outre des sanctions américaines contre le grand voisin.
Siphonner l'Etat
En mars, Washington a mis sur sa liste noire Al Khamael Maritime Services (AKMS), une compagnie de transport maritime opérant à Oum Qasr, l'accusant d'aider les Gardiens de la Révolution, l'armée idéologique d'Iran, à « échapper aux protocoles d'inspection » grâce à des paramilitaires chiites.
Les Etats-Unis ont également sanctionné deux Irakiens et deux Iraniens liés à AKMS, pour contrebande et aide aux brigades du Hezbollah irakiennes et au Hezbollah libanais.
Pour siphonner les caisses de l'Etat, les groupes concurrents se serrent les coudes « parce qu'ils savent que si l'un d'eux tombe, tout le monde tombe », assure Mansour.
« Un poste-frontière, c'est jusqu'à 120 000 dollars par jour que se partagent plein de groupes qui, si on élargit le champ, sont parfois ennemis », explique le chercheur.
Parfois, il y a des morts. En février, deux membres d'Assaïb ont été assassinés pour « des motifs commerciaux », assurent des sources proches du Hachd.
Mais, généralement, les règles tacites du cartel empêchent ces violences.
C'est l'Etat qui paie le prix de cette entente : il ne perçoit que « 10 à 12% des recettes douanières qui devraient atteindre sept milliards de dollars » par an, déplore le ministre Allawi.
Car, outre les acteurs irakiens, Transparency affirme dans son rapport 2020 que les principaux partenaires commerciaux de l'Irak, la Turquie et la Chine, sont parmi les pays contrôlant le moins la corruption sur leurs exportations.
En bout de chaîne, loin des échanges internationaux, la répercussion des pots-de-vin est palpable.
« Le consommateur irakien paie plus à la caisse à cause de la corruption », assure un responsable gouvernemental. Et les écoles, hôpitaux et autres infrastructures ne sont jamais construits faute de fonds.
« On paie le double »
Dès ses premières semaines, en mai 2020, le Premier ministre Moustafa al-Kazimi a fait des taxes douanières son cheval de bataille pour renflouer les caisses, avec un pétrole au plus bas.
A Oum Qasr ou Mandali, celui qui est également le chef du renseignement a annoncé déployer de nouvelles troupes avec plus de roulement pour éviter la formation de réseaux de corruption.
Depuis, chaque jour, l'Autorité des frontières annonce la saisie de cargaisons pour non-paiement des taxes et elle affirme avoir récolté 818 millions de dollars en 2020. Mais l'augmentation est bien faible : en 2019, elle récoltait 768 millions.
Pour importateurs, intermédiaires et même responsables gouvernementaux, ces mesures sont de la poudre aux yeux.
Pire, assurent des importateurs, leurs frais ont augmenté puisqu'ils paient maintenant les taxes mais aussi des intermédiaires pour éviter des mesures de rétorsion des barons de la corruption --possibles même avec tous les documents légaux en main.
« En fait, on paie double », résume un homme d'affaires arabe qui importe en Irak depuis plus de dix ans.
Les seuls pour lesquels rien n'a changé, ce sont ceux qui ont les bons contacts.
« On peut ramener des armes, tout ce qu'on veut à Mandali. Sans autorisation et sans payer les douanes », affirme un importateur qui a lui-même fait passer des matériaux de construction sans payer de taxes après les annonces de Kazimi.
Les nouvelles troupes dépêchées sur place n'ont aucun pouvoir, assure un soldat posté un temps à Mandali.
« Tous les policiers sont impliqués, les importateurs les inondent d'argent. Une fois, on a arrêté un corrompu et ils ont réussi à le faire sortir », raconte-t-il.
Et, ajoute le responsable de l'Autorité des frontières, il arrive que « les nouvelles troupes n'arrivent jamais » ou en nombre insuffisant.
« Fruit pourri »
Surtout, la nouvelle campagne ignore totalement le nœud du problème : les moukhalles.
Ils sont « toujours là et ce fruit pourri va corrompre tous les autres », assure le responsable.
De fait, la corruption s'est déplacée : des guichets elle est passée derrière des portes fermées et des appels téléphoniques vers des applications sécurisées.
A Mandali, « il y a un préfabriqué où tout peut se régler », affirme l'importateur.
Pour l'agent du renseignement, la récente campagne n'a fait que compliquer sa tâche : « maintenant, ils prennent plus de précautions ».
A l'aéroport de Bagdad, les brigades du Hezbollah --accusées par Washington de tirer régulièrement des roquettes sur son ambassade-- ont été formellement forcées de quitter leurs locaux, rapporte un haut gradé américain.
« Mais leurs hommes peuvent toujours accéder aux avions et faire ce qu'ils veulent » dans la zone hors taxe, poursuit-il.
In fine, les intermédiaires pourraient bientôt éviter les terminaux officiels pour faire passer les importations ailleurs le long des frontières.
Plus facile encore, ils peuvent se replier au Kurdistan irakien, où l'opacité règne sur les droits de douane et leur versement à Bagdad, affirment les différents acteurs interrogés.
« On parle de millions de dollars. Un seul dock à Oum Qasr vaut le budget d'un Etat tout entier », assène l'agent du renseignement.
« Ils ne cèderont pas facilement ».