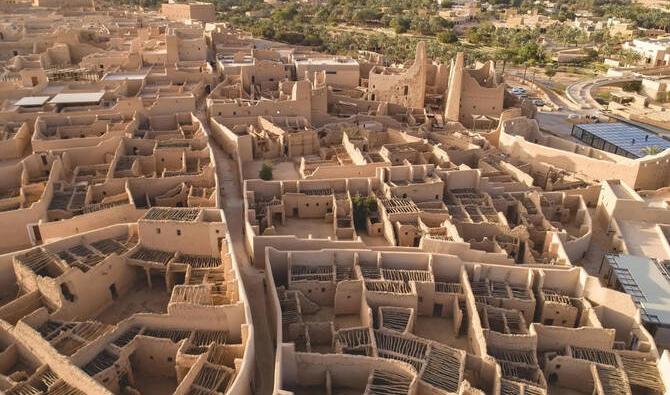DUBAÏ: La menace était une évidence. Les pays du Moyen-Orient à fiscalité faible devraient rejoindre les économies d'Europe et d'Amérique du Nord à fiscalité élevée et à fortes dépenses, et imposer de fortes hausses d'impôts qui mettraient en péril leur compétitivité mondiale.
Cependant, bien que les récentes mesures proposées par le Groupe des Sept (G7) en faveur d'un système mondial harmonisé de taxation des entreprises aient été qualifiées d' « historiques », les experts et les décideurs politiques, lorsqu'ils sont entrés dans le vif du sujet, semblaient plus enclins à se demander à quoi rimait toute cette agitation.
Cette réalité est particulièrement frappante au Moyen-Orient. Le plan du G7 est apparu au départ comme une menace pour les régimes à faible imposition existant dans la plupart des pays du Conseil de coopération du Golfe (CCG), dans la mesure où cette faible imposition était cruciale pour leurs stratégies de croissance économique.
Les experts financiers ont pris conscience, sans tarder, de la menace implicite qui pesait sur les économies du Conseil de coopération du Golfe. « On peut avancer que les propositions du G7 illustrent le fait que les pays riches développés cherchent à imposer leurs systèmes économiques et fiscaux au reste du monde, alors que de nombreux pays, dont ceux du CCG, se sont jusqu'à présent très bien tiré d'affaire grâce aux pratiques qu'ils appliquent », explique à Arab News, Tarek Fadlallah, directeur général de Nomura Asset Management Middle East, dont le siège est à Dubaï.
C'est l'Arabie Saoudite qui est jugée la plus vulnérable aux retombées d'une taxe mondiale. En effet, le Royaume est membre du groupe « Groupe des 20 » (G20) et est donc tenu de se conformer aux décisions prises par cet organisme lors de ses réunions annuelles. La prochaine démarche envisagée par le G7 consiste à appliquer son plan fiscal au G20 dans son ensemble. Là, les responsables politiques saoudiens seront amenés à se prononcer sur ces propositions.
Selon Nasser Saïdi, consultant économique, la phase de mise en œuvre des propositions du G7 entraînera des négociations ardues. « Elles devront être approuvées par le G20, ce qui mettra à nu les divergences entre le besoin de hausser les impôts des pays développés du G7, confrontés à des déficits budgétaires inédits – en partie en raison de la couverture par ces derniers des coûts de relance et de la baisse des revenus –. Ces propositions doivent également être validées par les pays en développement, qui réclament de faibles taux d'imposition sur leurs sociétés leur permettant d'attirer les investissements, la technologie et le savoir-faire », explique M. Saidi à Arab News.
Asad Khan est responsable de la gestion des actifs à la Emirates Investment Bank (EIB) des Émirats arabes unis. Il estime lui aussi que le diable résidera dans les détails des propositions en ce qui concerne les décideurs de la politique de la région. « Pour que l'accord du G7 constitue un succès mondial durable, le G20, qui regroupe des économies de premier plan comme la Chine, l'Inde, la Russie et l'Arabie saoudite, devra adhérer à l'accord et le ratifier », déclare-t-il à Arab News.
« Les détails épineux continueront de faire l'objet de controverses, telles que la mention ‘au moins 15 % de la taxe minimale’ et ‘plus de 10 % de la marge bénéficiaire’. Toutefois, le fond de l'accord est jugé satisfaisant et le G20 pourrait bien l'approuver, hormis quelques exceptions ».
Mais peu importe le compromis que les responsables politiques mondiaux élaboreront, les propositions du G7 braquent une nouvelle fois les projecteurs sur le sujet sensible de la fiscalité au Moyen-Orient. En effet, cette région apparaît systématiquement sur la liste des paradis fiscaux dans le monde, où des « hommes louches installés dans des régions ensoleillées » peuvent échapper aux obligations fiscales.
Ainsi, le groupe de pression Tax Justice Network a placé, en début d'année, les Émirats arabes unis dans le top 10 des paradis fiscaux où les entreprises peuvent s'installer dans un contexte d' «évasion fiscale des sociétés à l'échelle mondiale ».
En outre, les EAU ont lancé une campagne pour obtenir leur retrait des « listes noires » compilées par les autorités financières internationales.
Pour certains experts, il s'agit d'une idée erronée du rôle que la fiscalité a joué dans la région. Bien que le Golfe ne soit pas encore familier avec l'impôt sur le revenu des personnes physiques, bon nombre de pays du Golfe ont introduit une taxe sur la valeur ajoutée applicable à la consommation. Ainsi, l'Arabie saoudite a multiplié par trois le taux de cette taxe, qui est passée à 15 % l'année dernière, pour répondre aux exigences économiques de la récession liée à la pandémie.
L'impôt sur les entreprises est également obligatoire dans plusieurs secteurs, en particulier les secteurs pétrolier et bancaire, dans de nombreux pays du Conseil de coopération du Golfe. Les gouvernements de ces pays imposent de nombreux impôts et taxes sur l'ensemble des secteurs d'activité.
Le Fonds monétaire international a constamment proposé d'instaurer une forme d'impôt sur le revenu des personnes physiques dans la région. Cet appel a, jusqu'à présent, été rejeté par les responsables de la politique économique, conscients de la nécessité d'inciter les expatriés à vivre et à travailler dans les pays du Conseil de coopération du Golfe.
Un avocat spécialisé dans la fiscalité a déclaré à Arab News, sous couvert d'anonymat que « les EAU et les autres pays du CCG ne constituent pas des paradis fiscaux à l'instar des îles Caïmans ou du Lichtenstein. Ce sont des juridictions réticentes, historiquement, à imposer des taxes, et ils ont effectivement utilisé cette pratique comme outil au service de leur politique économique ».
Les zones franches (ZF) et les zones économiques spéciales (ZES), ayant émergé dans la région pour attirer les investissements directs étrangers, en sont le meilleur exemple.
Les propositions du G7 pourraient-elles donc compromettre cette recette à succès ?
« Les pays qui se sont appuyés sur l'exonération d'impôts dans leurs ZF et ZES pour attirer des capitaux et diversifier leur économie seront désormais accusés de favoriser l'évasion fiscale et de susciter de plus en plus de revendications relatives à l'échange d'informations à des fins fiscales, mais aussi en faveur de normes plus strictes en matière de gouvernance d'entreprise, de transparence et de divulgation », soutient M. Saïdi.
Dans le cadre de sa stratégie visant à faire de la ville de Riyad le centre financier du Golfe, le Royaume a récemment promis une série de primes, notamment des allégements de taxes, aux multinationales qui installeraient leur siège dans cette ville.
Les détails de ce plan, qui devrait entrer en vigueur en 2024, sont encore en cours d'élaboration. « Il reste à déterminer comment un taux d'imposition sur les sociétés à hauteur de 15 % dans l'ensemble du CCG influencerait la compétitivité des différents centres financiers qui rivalisent pour dominer la région », explique M. Fadlallah.

M. Khan, de la Emirates Investment Bank (EIB), estime que la politique fiscale n'est qu'un des facteurs déterminant la compétitivité de la région. « Pour nous, les gouvernements du CCG ont sans cesse essayé de rivaliser pour attirer les capitaux étrangers à travers des arguments autres que les impôts réduits », confie-t-il à Arab News.
« Nous sommes conscients que la clause d'impôt minimum obligera les pays à fiscalité nulle de la région à revoir leur stratégie afin d'attirer et de retenir les investissements étrangers directs. Cependant, nous sommes persuadés que le Moyen-Orient reste un centre stratégique pour les entreprises mondiales et les puissances occidentales ».
« La région est fière de sa main-d'œuvre jeune et dynamique et de sa démographie particulièrement favorable, associée à un revenu plus élevé. En outre, cette région offre une source de financement importante et stable pour les start-ups de la nouvelle ère, grâce aux fonds souverains ».
Au final, les propositions du G7 ont fait les gros titres pour les pays développés qui taxent et dépensent. Elles constitueront un atout pour les avocats spécialisés en fiscalité et les comptables dans le monde entier. Mais il y a peu de chances qu'elles jouent un rôle significatif dans le raisonnement à long terme des responsables de la politique économique au Moyen-Orient.
Twitter: @frankkanedubai
Ce texte est la traduction d’un article paru sur Arabnews.com.