LONDRES: En novembre 1914, on aurait pu pardonner au dernier dirigeant de l'État arabe autonome d'Arabistan, cheikh Khaz’al, de penser que les problèmes de son peuple voyaient leur fin.
Le pétrole, qui devait faire la fortune du peuple ahwazi, avait été découvert sur ses terres, et la Grande-Bretagne était prête à garantir son droit à l'autonomie. En réalité, les difficultés des Ahwazis ne faisaient que commencer.
En moins d'une décennie, cheikh Khaz’al était arrêté à Téhéran, le nom «Arabistan» était rayé de la carte et les Arabes ahwazis d'Iran étaient victimes d'une oppression brutale qui perdure.
Pendant des siècles, les tribus arabes ont régné sur une vaste étendue de terre dans l'ouest de l'Iran d'aujourd'hui. Al-Ahwaz, tel que leurs descendants le connaissent aujourd'hui, s'étendait vers le nord sur 600 km le long de la rive est du Chatt el-Arab et sur tout le littoral oriental du Golfe, jusqu'au sud du détroit d'Ormuz.
Cependant, le statut d'indépendance de l'Arabistan est remis en question en 1848 par les manœuvres géopolitiques de ses puissants voisins. Avec le traité d'Erzurum, l'Empire ottoman accepte de reconnaître «les pleins droits souverains du gouvernement persan» à l'Arabistan. Les tribus arabes dont les terres ont été si négligemment cédées n'ont pas été consultées.
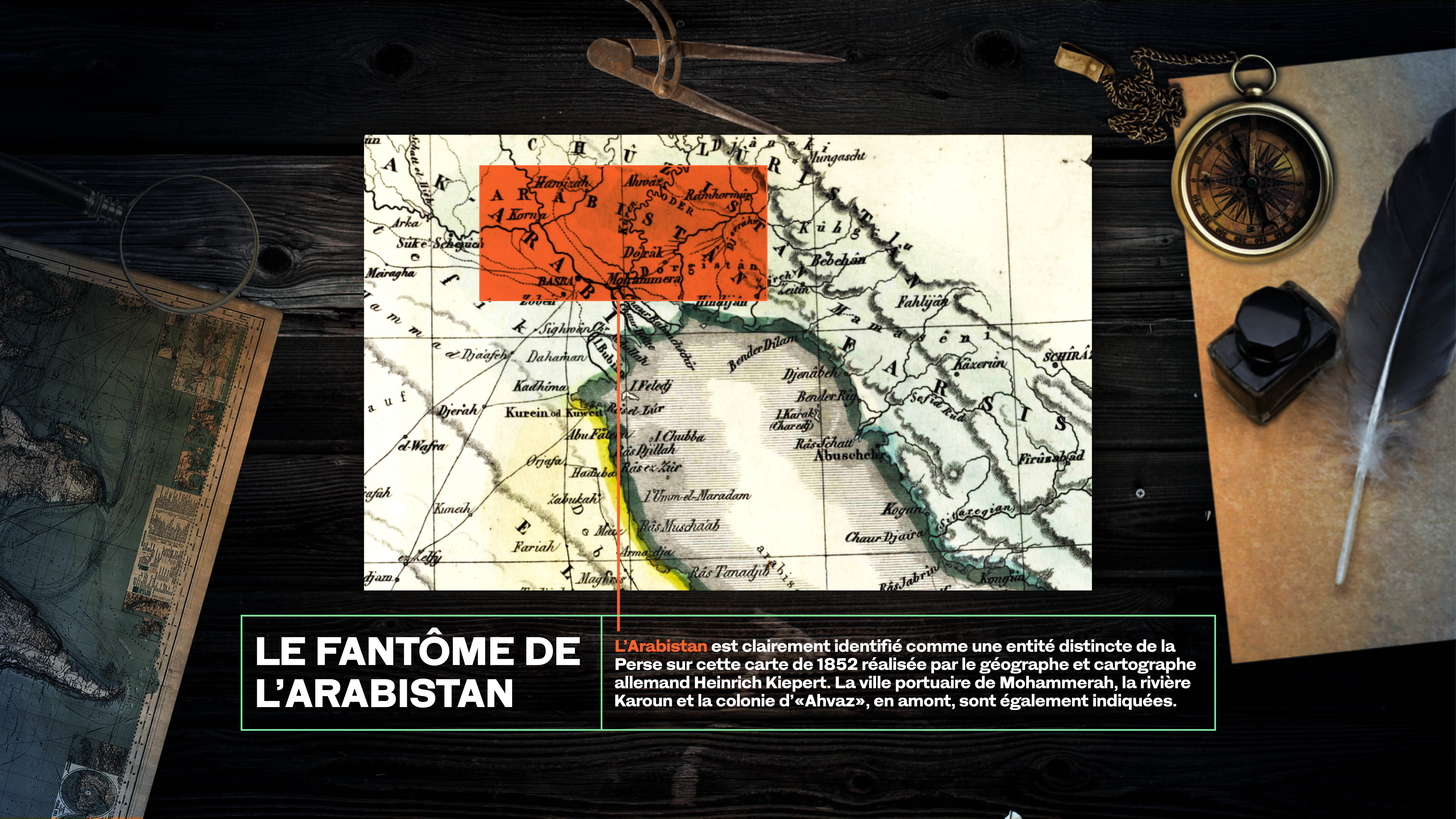
En dix ans, cependant, cheikh Jabir, le prédécesseur de cheikh Khaz’al, s'était trouvé un ami puissant: l'Empire britannique.
Le commerce dans le Golfe était vital pour les intérêts britanniques en Inde et cheikh Jabir était considéré comme un allié précieux. Surtout après son soutien aux Britanniques pendant la courte guerre anglo-perse de 1856-1857 au cours de laquelle la Grande-Bretagne avait repoussé les tentatives de Téhéran pour s'emparer de Hérat, en Afghanistan.
Soucieux de faire de l'Afghanistan une zone tampon, les Britanniques avaient soutenu l'indépendance de l'émir de Hérat. Désormais, semblait-il, le gouvernement de la reine Victoria avait l'intention de faire de même pour le cheikh d'Arabistan.
Les Britanniques ont ouvert un vice-consulat à Mohammerah en 1888. En 1897, lorsque cheikh Khaz’al est devenu le dirigeant de ce que les Britanniques appelaient «le Sheikhdom de Mohammerah», la Grande-Bretagne impériale était fortement investie dans l'Arabistan.
Comme le précise un résumé du ministère britannique des Affaires étrangères sur les relations avec cheikh Khaz’al, «une partie essentielle de la politique britannique dans le Golfe consistait dans l'établissement de bonnes relations et la conclusion de traités avec les différents dirigeants arabes; et les cheikhs de Mohammerah, qui contrôlaient le territoire à la tête du Golfe, étaient très influents».
Cheikh Khaz’al, avec l’appui des Britanniques, semblait diriger l'Arabistan vers un avenir brillant et indépendant.
Mais, en 1903, le chah d'Iran, Muzaffar al-Din, a officiellement reconnu les terres comme siennes à perpétuité. Puis, en 1908, de vastes réserves de pétrole ont été découvertes sur les terres du cheikh à Masjed-e Soleiman.

En 1910, après un affrontement mineur entre l'Arabistan et les forces ottomanes sur le Chatt el-Arab, la Grande-Bretagne envoie un navire de guerre à Mohammerah «pour contrer l’atteinte faite au prestige du cheikh, mais aussi pour se livrer à une démonstration de force face aux ambitions turques croissantes dans la région du golfe Persique.
À bord se trouvait sir Percy Cox, résident politique britannique dans le Golfe. Lors d'une cérémonie au palais de Fallahiyah le 15 octobre 1910, il présente au cheikh l'assurance du soutien indéfectible de la Grande-Bretagne, ainsi que l'insigne et le titre de chevalier commandeur de l'ordre de l'Empire indien.
En 1914, dans une lettre de sir Percy, le cheikh obtient ce qui équivaut à un engagement de la plus grande puissance impériale de l'époque: la possibilité de préserver son autonomie et de protéger l'Arabistan du gouvernement persan.
Le 22 novembre 1914, les Britanniques écrivent à leur envoyé qu'il est désormais autorisé à assurer personnellement «à Votre Excellence que, quel que soit le changement qui pourrait avoir lieu dans la forme du gouvernement de la Perse, le gouvernement de Sa Majesté sera prêt à vous fournir le soutien nécessaire pour trouver une solution, à la fois pour vous et pour nous, au cas où le gouvernement persan empiéterait sur votre juridiction et vos droits reconnus, ou sur votre propriété en Perse.
Dans les faits, toutes les assurances la Grande-Bretagne s'avéreront sans valeur et, dix ans plus tard, les espoirs d'indépendance de l'Arabistan seront anéantis.
Le problème, c’était le pétrole… Les Arabes l'avaient, les Perses le voulaient. Et quand la crise a éclaté, les Britanniques, malgré toutes leurs promesses, ont choisi de soutenir les Perses.
Le revirement de la Grande-Bretagne est motivé par la révolution russe de 1917, après laquelle il est clair que les bolcheviks ont des visées sur la Perse. En 1921, craignant que la dynastie perse Qajar défaillante ne se range du côté de Moscou, la Grande-Bretagne conspire avec Reza Khan, le chef de la brigade cosaque de Perse, pour fomenter un coup d'État.
Comme un rapport britannique le reconnaîtra en 1946, Reza Khan «était en fin de compte personnellement responsable de la chute complète du cheikh».
En 1922, Reza Khan menace d'envahir l'Arabistan, désormais considéré comme la province persane du Khouzistan. La raison en était claire, comme l'a conclu l'historienne américaine Chelsi Mueller dans son livre de 2020 Les Origines du conflit arabo-iranien.

«Il a des visées sur l'Arabistan non seulement parce que c'est la seule province qui n'a pas encore été investie par l'autorité du gouvernement central, mais aussi parce qu'il en est venu à apprécier le potentiel de l'industrie pétrolière de l'Arabistan à fournir des revenus indispensables», écrit Mueller.
Cheikh Khaz’al demande la protection de la Grande-Bretagne, invoquant les nombreuses promesses qui lui ont été faites. Au lieu de cela, il est écarté et rappelé à ses «obligations envers le gouvernement persan».
Le temps presse pour les Arabes. Dans une dépêche envoyée à Londres le 4 septembre 1922, sir Percy Loraine, envoyé britannique en Iran, écrit qu'il serait «préférable de traiter avec une autorité centrale forte plutôt qu'avec un certain nombre de dirigeants locaux en Perse. Cela impliquerait un relâchement de nos relations avec ces dirigeants locaux».
En août 1924, le gouvernement persan informe cheikh Khaz’al que le serment d'autonomie qu'il avait obtenu de Muzaffar al-Din en 1903 n'est plus valable. Le cheikh fait appel aux Britanniques pour obtenir de l'aide, mais il est de nouveau repoussé.
Reza Khan exige la reddition inconditionnelle du cheikh. Il est clair, concluent les Britanniques, que l'ancien régime a pris fin et qu'il est peu probable que Reza Khan, ayant établi une mainmise sur le Khouzistan, y renonce volontairement.
Le gouvernement britannique est «alors dans une position embarrassante» en raison des «services que le cheikh lui a rendus dans le passé». Néanmoins, par crainte d'une incursion russe en Perse, la Grande-Bretagne décide de soutenir fermement le gouvernement central de Téhéran.
Les Ahwazis se retrouvent seuls.
Le 18 avril 1925, cheikh Khaz’al et son fils, Abdel Hamid, sont arrêtés et emmenés à Téhéran, où le dernier souverain de l'Arabistan passera les onze dernières années de sa vie en résidence surveillée. Le nom «Arabistan» a été rayé de l'histoire et des territoires des Ahwazis et a finalement été intégré aux provinces persanes.
Les derniers jours de Khaz’al ont été consacrés à de vaines négociations avec Téhéran, marquées, notent les Britanniques, par «un manque de confiance envers le gouvernement central, qui n'avait aucune intention de tenir les promesses faites au cheikh».
Les Perses, concluent les Britanniques, «n'attendent manifestement que la mort du cheikh», événement qui aura lieu dans la nuit du 24 mai 1936.
Au cours du siècle qui s’est écoulé depuis que le peuple ahwazi a perdu son autonomie, il a subi des persécutions culturelles dans presque tous les domaines de la vie. Des barrages détournent l'eau du Karun et d'autres fleuves au profit des provinces persanes d'Iran, l'arabe est interdit dans les écoles, tandis que les noms de villes et de villages sont «persanisés». Sur les cartes du monde, le port arabe historique de Mohammerah est devenu Khorramchahr.
Les protestations se heurtent à une répression violente. D'innombrables citoyens qui s'efforcent d'entretenir la flamme de la culture arabe disparaissent, sont arrêtés, torturés, exécutés ou abattus à des postes de contrôle.
De nombreux Ahwazis qui ont cherché refuge à l'étranger s'efforcent d’attirer l’attention du monde sur le sort des Ahwazis. Cependant, même en exil, ils ne sont pas en sécurité.

En 2005, Ahmed Mola Nissi, l'un des fondateurs du Mouvement de lutte arabe pour la libération d'Ahwaz, a fui l'Iran avec sa femme et ses enfants et a demandé l'asile aux Pays-Bas. Le 8 novembre 2017, il est abattu devant son domicile à La Haye par un assassin inconnu.
En juin 2005, Karim Abdian, directeur de la Fondation Ahwaz pour l'éducation et les droits de l'homme, une ONG située en Virginie, fait appel à la sous-commission des Nations unies pour la promotion et la protection des droits de l'homme.
Les Ahwazis, dit-il, ont été soumis à «un assujettissement politique, culturel, social et économique, et ont été traités comme des citoyens de deuxième et troisième classes», à la fois par la monarchie iranienne dans le passé et par le régime actuel des mollahs. Néanmoins, ils ont toujours «foi dans la capacité de la communauté internationale à présenter une solution juste et viable pour résoudre ce conflit de manière pacifique».
Seize ans plus tard, Abdian désespère de voir les conditions de vie de son peuple s’améliorer de quelque façon. «Je ne vois aucune issue actuellement», déclare-t-il à Arab News, alors qu'il rêve d'une autodétermination pour les Ahwazis dans un Iran fédéraliste.
En attendant, «en tant qu'Arabe ahwazi, vous ne pouvez même pas donner à votre enfant un nom arabe. Ainsi, cette nation, qui possède la terre qui produit actuellement 80% du pétrole, 65% du gaz et 35% de l'eau d'Iran, vit dans une pauvreté révoltante».
Lire l'enquête d'Arab News ici
Ce texte est la traduction d’un article paru sur Arabnews.com

















