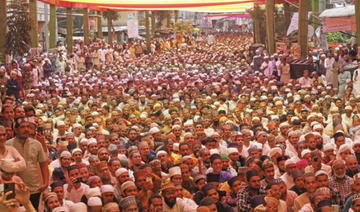PARIS: Promotion de remèdes dangereux, accusations de fraudes... Pour lutter contre les abus de certaines stars des réseaux sociaux, le Parlement a définitivement adopté jeudi un texte transpartisan pour réguler la jungle des influenceurs.
Après l'Assemblée mercredi, c'est une nouvelle unanimité jeudi de 342 sénateurs de tous bords politiques qui a marqué l'adoption du texte des députés Arthur Delaporte (Parti socialiste) et Stéphane Vojetta (apparenté Renaissance, majorité présidentielle).
"Nous pouvons nous féliciter de cet accord inédit", a salué la rapporteure au Sénat Amel Gacquerre (Union centriste).
Pour le gouvernement, qui soutient l'initiative, la ministre déléguée au Commerce Olivia Grégoire a salué "l'engagement des parlementaires" et "la qualité de ce travail".
Les influenceurs sont estimés à 150 000 en France, mais les agissements d'une partie d'entre eux, les ont placés sous le feu des critiques.
Des plaignants ont lancé des actions collectives, une étude accablante a été publiée par la Direction générale de la concurrence, de la consommation et de la répression des fraudes (DGCCRF), et le rappeur Booba a également joué un rôle de caisse de résonance par ses offensives sur les réseaux sociaux.
Promotion de produits dangereux, accusations de fraude: la pression est montée pour réguler le marché.
Depuis mercredi les influenceurs Illan Castronovo et Simon Castaldi sont contraint d'afficher sur les réseaux sociaux un message de la DGCCRF alertant contre certains de leurs contenus.
Beaucoup d'influenceurs ont une audience modeste, mais certaines stars aux millions d'abonnés peuvent peser sur les comportements de consommation, notamment des jeunes.
"Les influenceurs continueront d'exercer. Les +influvoleurs+ existeront toujours mais sauront que la loi est là pour les punir", insiste Arthur Delaporte. Le texte "protégera les consommateurs, notamment les plus jeunes", promet Stéphane Vojetta.
des moyens pour les «shérifs»
Le texte propose de définir légalement les influenceurs comme des "personnes physiques ou morales qui, à titre onéreux, mobilisent leur notoriété auprès de leur audience" pour promouvoir en ligne des biens et des services.
Il prohibe la promotion de certaines pratiques - chirurgie esthétique, abstention thérapeutique - et interdit ou encadre fortement la promotion de plusieurs dispositifs médicaux. Il rappelle la soumission à la loi Evin et interdit la promotion de produits contenant de la nicotine.
Il s'attaque aussi aux paris sportifs et aux jeux de hasard: les influenceurs ne pourront plus faire la promotion d'abonnements à des pronostics sportifs, et la promotion de jeux de hasard et d'argent sera cantonnée aux plateformes qui permettent techniquement d'interdire l'accès à la vidéo aux mineurs.
Les peines prévues en cas de manquement iront jusqu'à deux ans de prison et 300 000 euros d'amende.
La proposition de loi interdit aussi les mises en scène avec des animaux dont la détention est prohibée.
Lorsque des images de promotion, pour des cosmétiques par exemple, sont retouchées via un filtre pour les rendre plus attrayantes, il devra en être fait mention.
Jeudi, plusieurs sénateurs ont insisté sur le besoin de renforcer à l'avenir les moyens des autorités de contrôle, notamment ceux de la DGCCRF et de l'Autorité des marchés financiers. "Les shérifs sont multiples et doivent avoir les moyens de travailler correctement", a appelé Amel Gacquerre.
Les "agents d'influenceurs" seront aussi encadrés. Un contrat écrit sera obligatoire quand les sommes en jeu dépassent un certain seuil. Le texte prévoit aussi des mesures de responsabilisation des plateformes.
Alors que beaucoup d'influenceurs à succès opèrent depuis l'étranger le texte veut imposer à ceux qui exercent depuis l'extérieur de l'Union européenne, la Suisse ou l'espace économique européen de souscrire une assurance civile dans l'Union. Le but affiché est de créer un pactole pour indemniser des victimes potentielles. Ils devront également désigner un représentant légal dans l'UE.
Fin mars, l'Union des métiers de l'influence et des créateurs de contenus (Umicc), qui représente depuis peu les agences du secteur, avait salué "des propositions louables et indispensables". Mais elle avait alerté les parlementaires contre le risque de "discriminer ou sur-réguler" certains acteurs.