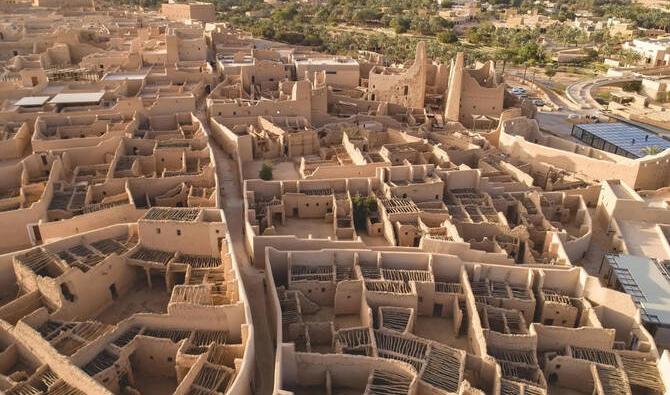PARIS: Rester malgré l'opprobre international et le flou juridique ou partir, quitte à essuyer une perte sèche ? Dix-huit mois après le début de la guerre en Ukraine, nombre d'entreprises occidentales continuent à évaluer la viabilité de leur présence en Russie.
Coût financier important
Même si une centaine d'entreprises des pays du G7 poursuivent largement leurs activités en Russie, selon un décompte de l'université américaine de Yale, "on continue d'observer une tendance à la réduction des activités des entreprises occidentales sur le territoire russe", rapporte à l’AFP Julien Vercueil, économiste spécialiste de la Russie.
Le 21 août, face à un "contexte de plus en plus difficile", c'est la chaîne de restauration rapide Domino's Pizza qui a décidé de jeter l'éponge, annonçant le dépôt de bilan de ses activités russes qu'elle tentait de vendre depuis décembre et actant ainsi la fermeture de 142 établissements à travers le pays.
"La guerre crée des conditions défavorables aux entreprises étrangères en Russie, quelle que soit leur décision", pointe M. Vercueil, et en cas d'abandon des activités russes, ou de départ précipité, ces sociétés "peuvent perdre beaucoup, mais ce sera une fois pour toutes", ajoute-t-il.
Ainsi, selon une analyse du Financial Times, qui a épluché les comptes annuels de 600 multinationales européennes, ces dernières ont perdu au moins 100 milliards d'euros "à la suite de la vente, de la fermeture ou de la réduction de leurs activités russes".
Renault a par exemple subi une perte sèche de 2,2 milliards d'euros et lâché un de ses principaux marchés lors de son départ de Russie en mai 2022.
Mais ce sont les majors pétrolières qui ont le plus perdu, comme BP, l'un des premiers à se désengager pleinement de Russie dès le 27 février 2022, pour une charge estimée à plus de 22 milliards d'euros.
Mauvaise image et boycott
Rester, c'est toutefois s'exposer à "des coûts réputationnels importants", relève Julien Vercueil.
"Les Ukrainiens - et en particulier Volodymyr Zelensky - ont beau jeu d'insister dès qu'ils le peuvent sur le financement que ces entreprises apportent à la guerre russe par les bénéfices qu'elles réalisent sur le territoire russe", ajoute l'économiste.
Les géants de l'agroalimentaire et de la distribution, restés en nombre en Russie, sont par exemple souvent ciblés.
"Auchan poursuit son travail en Russie, paie des impôts, finance la guerre et subit les attaques russes. Cynisme, masochisme ou stupidité ? Quittez la Russie: cet argent est trop sanglant", a écrit mercredi sur X (ex-Twitter) le ministère ukrainien de la Défense alors qu'un centre commercial du groupe a été touché par des fragments d'obus russes.
"Ces entreprises expliquent continuer leurs activités pour des raisons humanitaires mais c'est un mensonge cynique", tonne Jeffrey Sonnenfeld, professeur spécialisé dans la responsabilité sociale des entreprises à l'université de Yale, à l'origine d'une liste répertoriant les entreprises quittant la Russie (ou non).
Selon lui, non seulement ces grands groupes contribuent à faire fonctionner l'économie russe, mais en plus ils font le jeu de Vladimir Poutine en rassurant les consommateurs par leur présence.
Autant de raisons susceptibles de déclencher des boycotts chez les alliés de l'Ukraine, comme dans les pays scandinaves, où le géant américain des biscuits et friandises Mondelez n'est plus vendu par de nombreuses entreprises et institutions.
Incertitude
Pour les entreprises, continuer à exercer des activités en Russie, c'est aussi s'exposer à un cadre juridique incertain.
"Rester alors que l'environnement juridique est désormais ouvertement caractérisé par l'arbitraire et la prédation d'Etat au détriment des intérêts étrangers est dangereux", assure Julien Vercueil.
Selon un décret, la Russie peut "temporairement prendre le contrôle d’entreprises" issues de pays considérés comme "non-amicaux", indique à l'AFP Vladimir Tchikine, avocat spécialiste du droit des entreprises en Russie, rappelant qu'officiellement ces sociétés restent aux mains de leurs propriétaires étrangers.
Cet été, Danone et Carlsberg ont fait les frais de cette politique de rétorsion. Alors que les deux géants industriels étaient en passe de vendre leurs activités russes, ils ont été pris de court par l'Etat russe, qui s'est octroyé unilatéralement le contrôle de leurs actifs dans le pays.
Signe que le cadre législatif change parfois au bénéfice des sociétés, alors que les entreprises étrangères devaient obtenir une autorisation pour transférer les dividendes de leurs filiales russes à leur maison mère, cette obligation a été largement enterrée fin août.