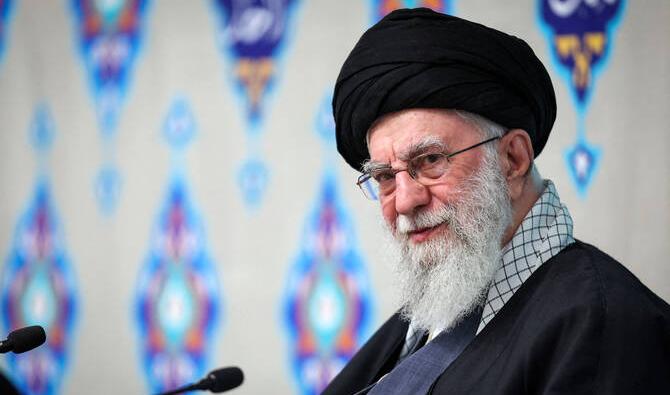NEW YORK: Israël n’a pas encore fourni de preuves permettant d’étayer les accusations selon lesquelles des membres du personnel de l’Office de secours et de travaux des nations unies pour les réfugiés de Palestine dans le Proche-Orient (Unrwa) seraient affiliés à des groupes terroristes, révèle un examen indépendant dirigé par l’ancienne ministre française des Affaires étrangères, Catherine Colonna.
Son enquête, qui a duré neuf semaines, a commencé après qu’Israël a accusé, en janvier, douze employés de l’Unrwa d’avoir participé aux attaques du Hamas contre Israël, le 7 octobre. Les enquêteurs ont également constaté qu’Israël n’avait jamais exprimé de préoccupations au sujet des personnes figurant sur les listes de personnel de l’agence qu’il recevait depuis 2011.
«En l’absence d’une solution politique entre Israël et les Palestiniens, l’Unrwa continue de jouer un rôle central dans la fourniture d’une aide humanitaire vitale et de services sociaux essentiels, notamment dans les domaines de la santé et de l’éducation, aux réfugiés palestiniens à Gaza, en Jordanie, au Liban, en Syrie et en Cisjordanie», souligne le rapport de quarante-huit pages publié lundi et consulté par Arab News.
«Ainsi, l’Unrwa est irremplaçable et indispensable au développement humain et économique des Palestiniens. En outre, nombreux sont ceux qui considèrent l’Unrwa comme une bouée de sauvetage humanitaire.»
L’agence, qui fournit de l’aide et des services aux réfugiés palestiniens à Gaza et dans toute la région, a été plongée dans une crise à la suite des allégations israéliennes. En réaction, les États-Unis, principal bailleur de fonds de l’Unrwa, et plusieurs autres donateurs importants ont suspendu leur financement de l’organisation. Au total, seize États membres de l’ONU ont suspendu ou interrompu leurs dons, tandis que d’autres ont imposé des conditions, ce qui a semé le doute sur l’avenir de l’agence.
Le secrétaire général de l’ONU, Antonio Guterres, en concertation avec le commissaire général de l’Unrwa, Philippe Lazzarini, a ordonné un examen indépendant des allégations afin d’évaluer l’adhésion de l’agence au principe de neutralité et sa réponse aux accusations de non-respect de ce principe, en particulier dans le contexte difficile de la situation à Gaza.
Par ailleurs, M. Guterres a ouvert une enquête distincte menée par le Bureau des services de contrôle interne de l’ONU afin de déterminer l’exactitude des allégations formulées contre le personnel de l’Unrwa. L’agence a également rompu ses liens avec les travailleurs nommés par Israël.
Selon le rapport Colonna, le montant des sommes retenues pendant les interruptions de financement s’élevait à près de 450 millions de dollars (1 dollar = 0,93 euro). À la suite des mesures prises par l’ONU en réponse aux allégations israéliennes, plusieurs États membres ont rétabli leur financement. Ils ont toutefois demandé des précisions sur les événements en question et ils ont appelé au renforcement des mécanismes et procédures de l’Unrwa pour garantir la neutralité de ses travailleurs, notamment en ce qui concerne le contrôle et la surveillance du personnel.
Le groupe chargé de l’examen avait pour mission de «déterminer si l’Unrwa fait tout ce qui est en son pouvoir pour garantir la neutralité et répondre aux allégations graves de non-respect du principe de neutralité lorsqu’elles sont formulées».
«Toutes les parties ont fait preuve d’une excellente coopération, y compris le gouvernement israélien», déclare Mme Colonna à Arab News.
Son rapport rappelle que «l’Unrwa et son personnel ont l’obligation fondamentale de rester neutres afin de garantir l’intégrité de la mission de l’agence et l’efficacité de ses opérations.»
«La neutralité fait partie des engagements de l’ONU. Il s’agit de l’un des quatre principes humanitaires officiellement adoptés par l’Assemblée générale et soutenus par d’autres agences de l’ONU lorsqu’elles opèrent dans des contextes humanitaires. La neutralité signifie que les acteurs humanitaires ne doivent pas prendre parti dans les hostilités ou être impliqués dans des controverses de nature politique, raciale, religieuse ou idéologique.»
Le rapport Colonna propose plus de cinquante recommandations en vue d’améliorer les efforts visant à garantir la neutralité des trente-deux mille employés de l’Unrwa, notamment le développement du service de contrôle interne, l’augmentation du nombre de formations en présentiel et le renforcement du soutien des pays donateurs. Le rapport reconnaît toutefois que les mesures actuelles de l’Unrwa sont déjà plus strictes que celles de nombreuses organisations similaires.
«Les défis de l’Unrwa en matière de neutralité diffèrent de ceux d’autres organisations internationales en raison de l’ampleur de ses opérations, la plupart du personnel étant recruté localement et bénéficiant des services de l’Unrwa», note le rapport.
M. Guterres a indiqué qu’il acceptait les conclusions du rapport de Mme Colonna et qu’il était d’accord avec M. Lazzarini pour que l’Unrwa «établisse un plan d’action pour mettre en œuvre les recommandations figurant dans le rapport final».
Stéphane Dujarric, porte-parole du secrétaire général, a précisé que M. Guterres «compte sur la communauté des donateurs, les pays hôtes et le personnel pour coopérer pleinement à la mise en œuvre des recommandations».
«Le secrétaire général appelle toutes les parties prenantes à soutenir activement l’Unrwa, qui est une bouée de sauvetage pour les réfugiés palestiniens dans la région.»
Mme Colonna a déclaré lundi à New York que «la communauté internationale a la responsabilité d’aider et de soutenir l’Unrwa dans ses efforts pour résoudre les problèmes relatifs à la neutralité».
Au cours des neuf semaines d’enquête, son groupe a minutieusement examiné les mécanismes et protocoles existants de l’agence pour maintenir la neutralité et faire face aux violations potentielles. Les membres du groupe ont visité le siège et les bureaux de l’Unrwa à Amman, à Jérusalem et en Cisjordanie, et se sont entretenus avec diverses parties prenantes, notamment des responsables de l’agence et des représentants des États donateurs, des pays hôtes, d’Israël, de l’Autorité palestinienne, de l’Égypte, d’autres agences de l’ONU et d’organisations non gouvernementales.
Au total, le groupe chargé de l’examen a rencontré ou interrogé plus de 200 personnes, dont plusieurs membres du personnel de l’Unrwa à Gaza. Des contacts directs ont été établis avec des responsables de 47 pays et organisations.
L’examen révèle que l’Unrwa a mis en place un nombre important de mécanismes et de procédures pour garantir le respect des principes humanitaires, en mettant l’accent sur la neutralité, et qu’il a adopté une approche plus développée de la question de la neutralité que beaucoup d’autres agences similaires de l’ONU ou d’organisations non gouvernementales.
Malgré ces efforts considérables, des problèmes relatifs à la neutralité de l’agence et de son personnel persistent. Plusieurs allégations de violation des règles de neutralité ont été formulées et des mesures disciplinaires ont été prises en conséquence, note le rapport. Cependant, aucune des allégations antérieures n’était aussi grave que celles formulées par les autorités israéliennes en janvier de cette année.
Israël reproche souvent à l’Unrwa d’utiliser dans les écoles de la région des manuels de l’Autorité palestinienne dont le contenu serait antisémite. Toutefois, des études internationales n’ont trouvé que peu de preuves à l’appui de ces allégations.
«Trois évaluations internationales des manuels scolaires de l’Autorité palestinienne réalisées ces dernières années donnent une vision nuancée», indique le rapport. «Deux d’entre elles ont identifié la présence de préjugés et de contenus antagonistes, mais elles n’ont pas fourni de preuves d’un contenu antisémite. La troisième évaluation, réalisée par l’Institut Georg Eckert (basé en Allemagne), a étudié cent cinquante-six manuels scolaires de l’Autorité palestinienne et en a identifié deux qui, selon elle, présentaient des motifs antisémites. Elle a cependant noté que l’un de ces manuels avait déjà été retiré et que l’autre avait été modifié.»
Selon un porte-parole du ministère israélien des Affaires étrangères, le rapport de Mme Colonna est «insuffisant», ne tient pas compte de la gravité du problème et propose des solutions cosmétiques qui ne tiennent pas compte de l’ampleur de l’infiltration de l’Unrwa par le Hamas.
Ce texte est la traduction d’un article paru sur Arabnews.com