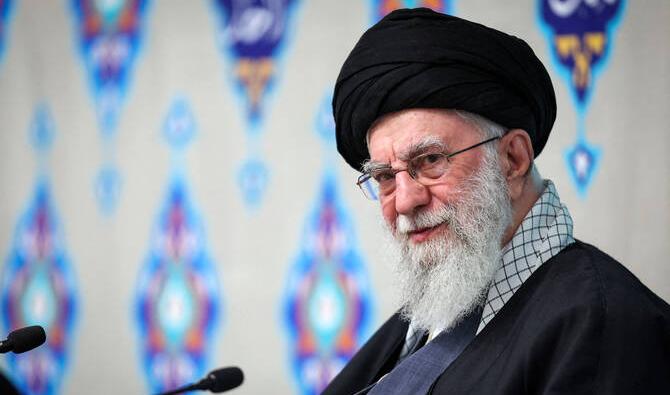JERUSALEM: Tout se précipite autour d'Adnane : les jets de pierre fusent, les bennes à ordure s'embrasent et les balles en caoutchouc sifflent. Mais pourtant, le jeune Palestinien reste là, sans peur, dans les rues de Jérusalem-Est, théâtre d'affrontements violents ces dernières semaines.
« Depuis des années, les colons nous attaquent et prennent nos terres mais le silence n'est plus une option », lance ce Palestinien âgé de 20 ans, jean serré, cheveux un brin gominés.
Comme d'autres, il refuse de donner son nom complet par crainte, disent-il, d'être arrêtés par les policiers israéliens qui quadrillent le secteur ou par les « mustaravim », une unité secrète qui se fait passer pour des Arabes.
« Nous sommes ici dans la rue pour dire (...) que nous ne partirons pas », assure Adnane au milieu d'une énième manifestation nocturne à Jérusalem-Est, partie palestinienne de la Ville sainte occupée et annexée par Israël.
Depuis le début du mois de ramadan, la police israélienne et des Palestiniens s'affrontent près de la porte de Damas, vaste porche de pierre couleur sable donnant sur le quartier musulman de la Vieille ville de Jérusalem.
En cause : la décision, depuis annulée, des autorités israéliennes d'empêcher les habitants palestiniens de s'asseoir sur les marches de l'agora en pierre, donnant sur la porte, où les uns et les autres passent leur soirée à palabrer après la rupture du jeûne.
Mais il y a un peu plus de deux semaines, un groupe de juifs d'extrême droite est venu chanter « Mort aux Arabes » à proximité. Les esprits se sont échauffés, les pierres, les bouteilles ont fusé et de jeunes Palestiniens se sont battus avec les policiers pour une nuit de heurts ayant fait plus de 120 blessés.
DES PAYS ARABES CONDAMNENT LES AGISSEMENTS D' ISRAËL
Des réactions critiques d'Israël ont afflué du Soudan, du Maroc, des Emirats arabes unis et de Bahreïn, qui ont annoncé l'année dernière la normalisation de leurs relations avec l'Etat hébreu.
Khartoum a qualifié les mesures prises contre les Palestiniens à Jérusalem de « répression » et d'« action coercitive », selon un communiqué du ministère soudanais des Affaires étrangères samedi soir.
Il a exhorté le gouvernement israélien à « s'abstenir de prendre des mesures unilatérales diminuant les chances d'une reprise des négociations de paix ».
Les Emirats et Bahreïn ont eux condamné la descente des forces de sécurité israéliennes vendredi dans la mosquée Al-Aqsa, et la répression à l'encontre de fidèles qui cherchaient à en sortir.
Et Abou Dhabi a appelé les autorités israéliennes à « assurer la responsabilité d'une désescalade » de la violence autour de l'esplanade des Mosquées, le troisième lieu saint de l’islam et le site le plus sacré des juifs.
Manama a de son côté exhorté le gouvernement israélien à « arrêter ces provocations contre les habitants de Jérusalem ».
Le Maroc a par ailleurs dit dimanche suivre avec une « profonde inquiétude » les violences, ajoutant que le roi Mohammed VI « considère ces violations comme inadmissibles et alimentant les tensions ».
L'annexion et l'occupation de Jérusalem-Est depuis 1967 sont contraires au droit international, tout comme l'occupation de la Cisjordanie.
Combats à Al-Aqsa
Ce vendredi, les échauffourées se sont déplacées sur l'esplanade des Mosquées - appelée Mont du Temple par les Juifs - où des policiers israéliens ont tiré des balles de caoutchouc et des grenades assourdissantes à quelques mètres du Dôme du Rocher.
Mohammed, qui ne veut pas donné son nom complet, était aux premières loges. « Il y avait des milliers de personnes qui rompaient le jeûne (...) tandis que d'autres priaient lorsque la police a commencé à nous attaquer », dit ce Palestinien de 26 ans de Jérusalem-Est.
La police israélienne, positionnée dans l'enceinte, a dit elle avoir été la cible de projectiles de la part de centaines, puis de « milliers » d'émeutiers, dans le troisième lieu saint de l'Islam qui a vu plus de 200 blessés, dans les pires violences en quatre ans à Jérusalem.
Pour Mohammed, si les heurts récents ont bien commencé avec l'interdiction de s'asseoir devant la porte de Damas, ils s'inscrivent dans une lutte plus large pour le contrôle même de Jérusalem-Est. « Les Israéliens veulent que l'on travaille pour eux, mais ils ne veulent pas que nous vivions ici », lance-t-il.
Au cours des dernières années, la colonisation de la Cisjordanie occupée mais aussi de Jérusalem-Est s'est intensifiée avec des projets immobiliers financés par le gouvernement israélien, ou des initiatives d'organisations de colons pour racheter des maisons de Palestiniens, voire les exproprier, comme c'est le cas ces jours-ci dans le quartier de Cheikh Jarrah, près de la Vieille ville.
En début d'année, un tribunal israélien y avait ordonné l'expulsion de quatre familles palestiniennes qui ont demandé à la Cour suprême de pouvoir interjeter appel. Et alors que cette instance a repoussé à lundi sa décision, les affrontements se multiplient dans ce quartier. « Le cas de Cheikh Jarrah est celui de toute la Palestine. Aujourd'hui c'est eux, demain ce sera nous », estime Malak Orok, 23 ans, venue avec des amies manifester à Jérusalem.
Mais ces « maisons sont à nous », rétorque le député d'extrême droite Itamar Ben Gvir --courtisé pour former un gouvernement avec le Premier ministre Benjamin Netanyahou-- qui s'est invité ces derniers jours à Cheikh Jarrah, où l'AFP a vu des colons armés de révolvers et de fusils d'assaut.
Et le député d'appeler le « pouvoir politique à autoriser l'utilisation d'armes à feu contre ceux qui jettent des pierres », à l'heure où le Quartette pour le Proche-Orient (USA, Russie, UE, ONU) appelle Israël à la « retenue »...
« Ma terre »
Ces affrontements interviennent dans un contexte de tensions politiques en Israël et dans les Territoires palestiniens. Des tractations se multiplient en Israël pour la formation d'un gouvernement, un ténor de la droite radicale, Naftali Bennett, ayant refusé de joindre Ben Gvir et Netanyahou qui l'accusent désormais de pactiser avec la « gauche », des attaques visant selon la presse à saper ses soutiens auprès notamment des colons.
Côté palestinien, le président Mahmoud Abbas a repoussé sine die les premières élections prévues en 15 ans invoquant le fait qu'Israël ne permettait pas la tenue du vote des Palestiniens de Jérusalem-Est, une décision qui a ulcéré le mouvement islamiste Hamas.
« Abbas est un traître », ont scandé ces derniers jours des Palestiniens à Jérusalem-Est, où des bannières du Hamas, mouvement qui a menacé de représailles dans l'affaire de Cheikh Jarrah, ont été aperçues vendredi à l'esplanade des Mosquées.
« Pourquoi les gens disent que Abbas est un traître ? Lorsque nous voyons certains qui se disent de son parti (...) on se dit qu'ils ont touché de l'argent, qu'ils collaborent avec les Israéliens », tonne Jaad Assad, 24 ans, un Palestinien de Jérusalem-Est. « Seul Dieu peut nous aider ».
Des scènes de chaos l'entourant, Adnane, lui, se tient droit sans broncher : « Je n'ai pas peur, tout ce que je veux c'est ma terre ».