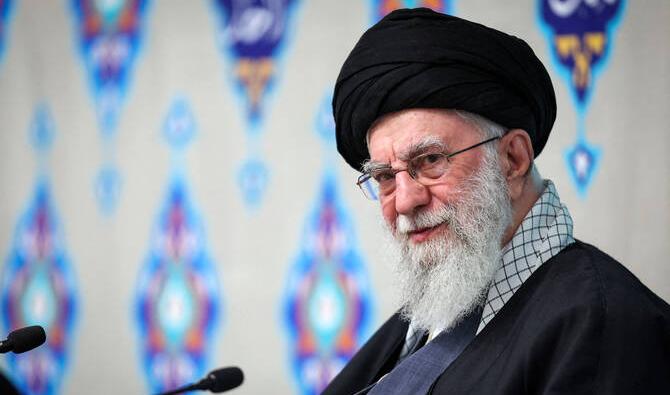PARIS : Depuis son expulsion en France par Israël le 18 décembre, l'avocat franco-palestinien Salah Hamouri dit souffrir plus souvent de sa cuisse droite, là où reste incrustée une balle israélienne récoltée en 2000, alors qu'il était adolescent.
"Quand il fait super froid, ça me fait un peu mal", explique-t-il à l'AFP mi-janvier à Paris, où les températures sont bien plus fraîches qu'à Jérusalem.
"J'y repense tout le temps. Ça fait partie des traces de l'occupation qui me poursuivent", poursuit cet homme longiligne au regard bleu intense, en désignant une petite cicatrice ronde.
Salah Hamouri a 15 ans en 2000 lorsque démarre la Seconde Intifada, le soulèvement palestinien qui durera jusque 2005. Alors que des Palestiniens font pleuvoir des pierres sur les soldats israéliens, il raconte sentir "quelque chose le toucher". "Il y avait beaucoup de sang. On m'a emmené à l'hôpital. Il n'ont pas pu enlever la balle."
L'épisode ancrera, affirme-t-il, sa détermination à défendre les droits des Palestiniens. Lui qui, à l'âge de "5-6 ans", s'était retrouvé pratiquement "toutes les nuits regroupé dans une pièce avec sa famille", alors que l'armée israélienne fouillait, en vain, sa maison à la recherche d'un oncle "accusé d'avoir participé à la Première Intifada" (1987-1993).
"A 6 ou 7 ans", Salah Hamouri dit découvrir la prison en rendant visite à cet oncle. Lui-même multipliera ensuite les séjours carcéraux. Aujourd'hui âgé de 37 ans, il en a vécu neuf, soit près d'un quart de sa vie passé en détention.
«Encore peur»
Cinq mois en 2001, quatre mois en 2004, treize mois en 2017, dix jours en 2020, puis neuf mois en 2022... "Ce qu'il fait n'est pas quelque chose de blâmable, donc on l’a toujours soutenu", assure sa mère Denise, venue le voir à Paris.
Ses plus courts séjours derrière les barreaux relevaient presque tous de la détention administrative, ce régime qualifié d'"illégal au niveau du droit international" par Nathalie Godard, une cadre d'Amnesty international, car ni l'accusé ni ses avocats ne connaissent les faits reprochés.
Entre 2005 et 2011, Salah Hamouri est emprisonné pour participation à la tentative d'assassinat d'Ovadia Yossef, ex-grand rabbin d'Israël et fondateur du parti ultra-orthodoxe Shass.
"Il s'est retrouvé à plaider coupable pour diminuer la peine qu'il risquait d'avoir, mais il était innocent", affirmait en novembre à l'AFP Elias Geoffroy, de l'ONG Association des chrétiens contre la torture (ACAT), qui lui a décerné son prix des droits humains 2022.
Le ministère israélien de l'Intérieur martèle toutefois que Salah Hamouri est "un terroriste" du Front populaire de libération de la Palestine (FPLP), une organisation considérée comme "terroriste" par l'Etat hébreu et l'Union européenne.
En 2016, le gouvernement israélien expulse sa femme Elsa Lefort, alors employée consulaire française et enceinte du premier de leurs deux enfants. Cinq ans plus tard, Amnesty international, après analyse de son téléphone portable, constate qu'il est piraté par le logiciel espion israélien Pegasus.
"Depuis son plus jeune âge, (Salah) Hamouri soutient des actes terroristes et a profité de son permis de résidence en Israël pour ces actes", affirmaient récemment les autorités israéliennes, qui le 18 décembre ont fini par l'expulser en France, qui appelait à ce que lui et sa famille puissent vivre ensemble à Jérusalem et a regretté son expulsion.
«Crime de guerre»
Une décision qualifiée de "crime de guerre" par l'ONU, car le droit international humanitaire "interdit l'expulsion de personnes protégées d'un territoire occupé", selon l'un de ses porte-paroles.
Né à Jérusalem-Est, partie de la Ville sainte annexée et occupée par l'Etat hébreu, où il a passé toute sa vie, l'avocat ne disposait pas de la nationalité israélienne mais uniquement d'un permis de résidence jérusalémite. En plus d'un passeport français, hérité de sa mère.
Salah Hamouri "est un emblème de la répression contre la société civile" menée par Israël, qui veut "faire taire les voix dissidentes dans sa politique d'apartheid contre la population palestinienne", estime Nathalie Godard.
Son expulsion constitue en ce sens "un précédent extrêmement dangereux pour les Palestiniens de Jérusalem, pour qui sera requise la loyauté à la puissance occupante" s'ils veulent rester vivre sur place, s'inquiète la palestinienne Milena Ansari, collègue de l'avocat à Addameer, une ONG défendant les droits des prisonniers palestiniens, qu'Israël qualifie également de "terroriste".
"En déportant Salah, (Israël) croit le réduire au silence, qu'il verra la beauté de la France et oubliera l'agonie de la Palestine. Mais je suis sûre que cela ne se produira pas", lance-t-elle.
De fait, l'avocat multiplie les interventions depuis cinq semaines qu'il est en France. Mercredi, il était reçu au Parlement européen.
"Israël n'a pas gagné dans sa volonté de me faire taire. Ma voix sera plus haute, plus forte. Mon combat va continuer", insiste-t-il. "Je ne donnerai pas cette occasion à l'occupant de sentir qu'il a gagné en me déportant de force de Palestine".