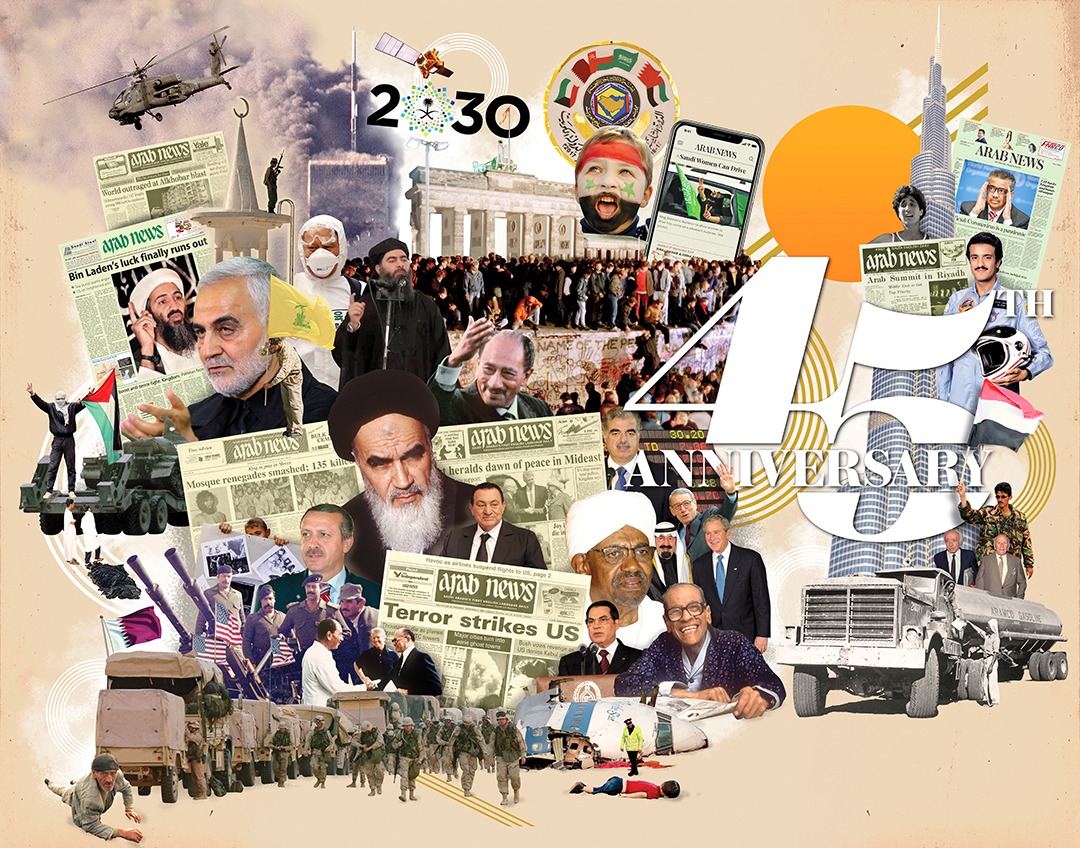Résumé
Le 5 Mars 1998, après des années de lutte pacifique vaine de la part des dirigeants du Kosovo pour obtenir plus d’autonomie, l’armée de libération du Kosovo lança une rébellion armée contre le régime serbe dans la province yougoslave à majorité musulmane. La réaction de Belgrade fut une répression violente qui ne fit aucune discrimination entre combattants et civils et déclencha un flux de réfugiés vers le pays voisin d’Albanie, causant une grave crise humanitaire.
Le 24 mars 1999, L’OTAN réagit à l’agression du président yougoslave Slobodan Milosevic contre les Albanais du Kosovo, en lançant des frappes aériennes contre des cibles militaires serbes. La campagne militaire de l’OTAN dura 11 semaines, causant des pertes civiles et des destructions matérielles lourdes.
La Yougoslavie accepta un accord de paix en juin 1999, à la suite duquel le secrétaire général de l’ONU ordonna l’arrêt des bombardements menés par l’OTAN. Suivit alors l’adoption de la Résolution 1244 par le Conseil de sécurité, autorisant la présence internationale de sécurité au Kosovo. La région du Kosovo déclara unilatéralement son indépendance en 2008, une décision encore contestée à ce jour.
DUBAI : Comparée à la durée moyenne des conflits les plus récents, la guerre au Kosovo de 1998 à 1999 fut brève. Elle débuta avec l’insurrection armée de l’Armée de libération du Kosovo (UCK), contre le régime serbe, autour de l’autonomie de la région du Kosovo, qui faisait partie de ce qui restait de la Yougoslavie. Le régime du président Slobodan Milosevic à Belgrade réagit avec une force démesurée, déclenchant une grave crise de réfugiés et ramenant à notre mémoire le spectre du massacre de musulmans en Bosnie.
L’intervention de l’OTAN, une longue campagne de bombardements aériens, permit de mettre un terme au conflit et de négocier un accord de paix. En février 2008, le Kosovo déclara son indépendance de la Serbie, une annonce accueillie par des scènes inédites de joie et de jubilation.
Les Etats-Unis et plusieurs membres de l’Union européenne ont reconnu le Kosovo comme un état indépendant, au contraire de la Serbie, soutenue par la Russie. Depuis lors, le Kosovo, une démocratie parlementaire avec une économie à revenu intermédiaire de la tranche inférieure, fait du surplace.
Ayant grandi à Sarajevo durant la guerre de Bosnie dans les années 1990, les événements dans le Kosovo voisin resteront gravés à jamais dans ma mémoire. Je sais malheureusement la haine et les antagonismes accumulés au fil du temps. Historiquement, le Kosovo est situé au cœur de l’empire serbe. C’est là que plusieurs rois serbes furent couronnés au Moyen-Âge.
Bien qu’ayant obtenu un certain degré d’autonomie sous l’ex-Yougoslavie en 1974, les habitants de la province, essentiellement des Musulmans albanais ethniques, étaient fatigués de subir la domination des Serbes ethniques. A la fin des années 1980, le chef kosovar Ibrahim Rugova initia une stratégie de résistance non-violente face à la suspension de l’autonomie constitutionnelle de la province, décrétée par Milosevic.
Le président et les membres de la minorité serbe du Kosovo s’étaient plaints depuis longtemps de la dominance démographique et politique des Albanais ethniques dans une région qui portait une signification historique pour les chrétiens orthodoxes serbes. Durant la guerre en Bosnie, entre 1992 et 1995, et même après l’éclatement de la Yougoslavie, les Serbes nationalistes jetaient un regard suspect sur les Kosovars.
Les dates clés :
- Le 5 mars 1998 : Le conflit débute au Kosovo suite à la rébellion armée de l’UCK
- 24 mars 1999 : L’OTAN lance des raids aériens contre la Serbie.
- Le 10 juin 1999 : Arrêt des bombardements de l’OTAN, 11 semaines après leur commencement.
- Le 4 février 2003 : La Yougoslavie cesse d’exister. Elle est rebaptisée Communauté étatique de Serbie-et-Monténégro (Le Monténégro deviendra plus tard indépendant, le 21 Mai 2006).
- Le 17 février 2008 : Le Kosovo déclare son indépendance de la Serbie, une décision controversée.
Le soutien populaire bascula du côté des Albanais ethniques radicaux qui étaient convaincus que leur volonté d’autonomie ne pourrait être satisfaite en suivant l’approche pacifique de Rugova. En 1996, l’UCK fit son entrée sur la scène kosovare à travers des attaques sporadiques sur la police serbe et les hommes politiques, une campagne qui s’intensifia durant les deux années qui suivirent.
La brutalité de la police serbe, des groupes paramilitaires et de l’armée mena à une crise grave de réfugiés, qui attira l’attention des médias et de la communauté internationale. Une coalition informelle regroupant les Etats-Unis, la Grande-Bretagne, l’Allemagne, la France, l’Italie et la Russie, nommé « le Groupe de contact », soumit ses conditions, incluant un cessez-le-feu immédiat
« Les Etats du Golfe, menés par l’Arabie Saoudite, se sont concentrés sur l’organisation de l’assistance humanitaire et la recherche d’une issue au conflit par la voie pacifique ».
Emina Osmandzikovic
Le Conseil de sécurité des Nations unies condamna ce qu’il qualifia d’usage excessif de la force, et imposa un embargo militaire. Mais cela ne suffit pas à mettre un terme aux violences. Le 24 mars, l’OTAN lança une série de raids aériens sur des cibles militaires serbes. La réaction des forces serbes ne se fit pas attendre, et poussa des centaines de milliers de Kosovars à fuir en Albanie, en Macédoine (maintenant la Macédoine du Nord) et au Monténégro.
Si les souffrances de la guerre des Kosovars ont suscité une certaine sympathie du monde musulman et un soutien pour leur cause, plusieurs dirigeants ont critiqué l’OTAN pour avoir contourné l’ONU et qualifié la campagne de ‘guerre humanitaire’.
La légitimité de la décision unilatérale de lancer des raids aériens était contestable, si l’on se réfère au droit international. Mais le secrétaire général de l’ONU de l’époque, Kofi Annan, a soutenu le principe de l’intervention, et déclaré : « Il y a des temps où l’usage de la force pour atteindre la paix peut être légitime ».
Des pays arabes tels que la Libye ou l’Irak, qui entretenaient alors des relations fortes avec la Yougoslavie, ont insisté pour trouver une solution politique. Les Etats du Golfe, menés par l’Arabie Saoudite, se sont concentrés sur l’organisation de l’assistance humanitaire et la recherche d’une issue au conflit par la voie pacifique. L’Arabie Saoudite a affrété deux avions pour transporter plus de 120 tonnes d’aide humanitaire sous la forme de tentes, dattes, couvertures et tapis, selon des communiqués officiels.

Extrait des archives de Arab News, le 6 Mars 1998.
Un avion humanitaire saoudien ‘C-130 Hercules’ transporta quotidiennement de l’aide humanitaire, de Djeddah ou Riyad vers la capitale albanaise Tirana, où le personnel de l’ambassade saoudienne et celui des forces aériennes déchargeaient le contenu. En plus d’un hôpital de campagne à Tirana, opérationnel dès le 24 mai 1999, l’Arabie Saoudite mit en place plus de 10 centres médicaux à travers l’Albanie et la Macédoine.
Un téléthon saoudien recueillit près de $19 millions le 16 avril 1999. L’Organisation de la coopération islamique, basée à Djeddah, qui contribua à l’organisation de ce téléthon, déclara qu’elle avait affrété une aide humanitaire d’une valeur de $12 millions. Une autre initiative lancée par une télévision koweitienne recueillit $7 millions en un seul jour, dont $1 million provenant du don personnel de l’émir, Cheikh Jaber Al-Ahmed Al-Sabah.
Des organisations des Emirats arabes unis installèrent l’un des camps de secours les plus larges, où près de 10 000 réfugiés kosovars eurent accès à de la nourriture, des services de première nécessité et un hôpital de campagne entièrement équipé. Le Croissant-Rouge mit en place des camps de réfugiés en Macédoine et en Albanie.
La campagne de bombardements de l’OTAN dura onze semaines et finit par atteindre Belgrade, causant de lourds dégâts aux infrastructures et la mort accidentelle de beaucoup de civils. En juin 1999, le gouvernement yougoslave accepta un accord de paix, sous la médiation conjointe de la Russie et la Finlande.
L’OTAN et la Yougoslavie ont signé un accord de paix comprenant un retrait des troupes et le retour de près d’un million de réfugiés et un demi-million de déplacés kosovars. La majorité des Serbes ethniques ont quitté la région. L’intervention militaire humanitaire de l’OTAN a permis de sauver des milliers de vies de kosovars innocents.
Emina Osmandzikovic, qui couvre les sujets liés aux réfugiés pour Arab News, a grandi à Sarajevo dans les années 1990 durant la guerre en Bosnie. Twitter : @eminaosmandzik